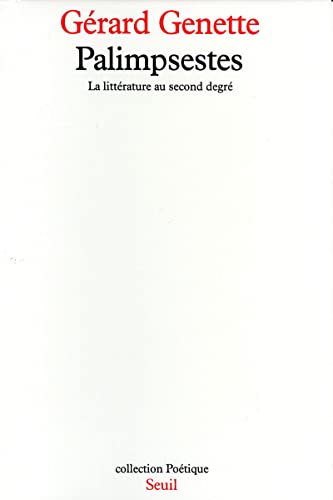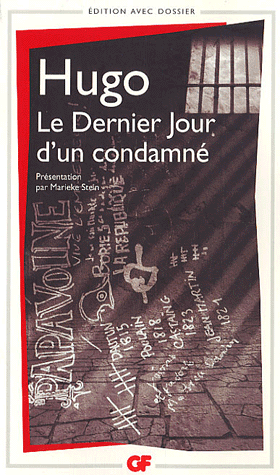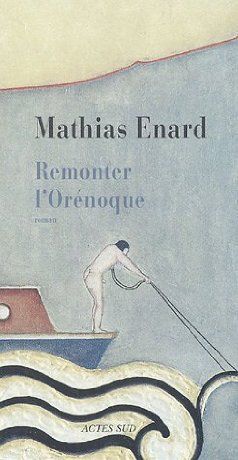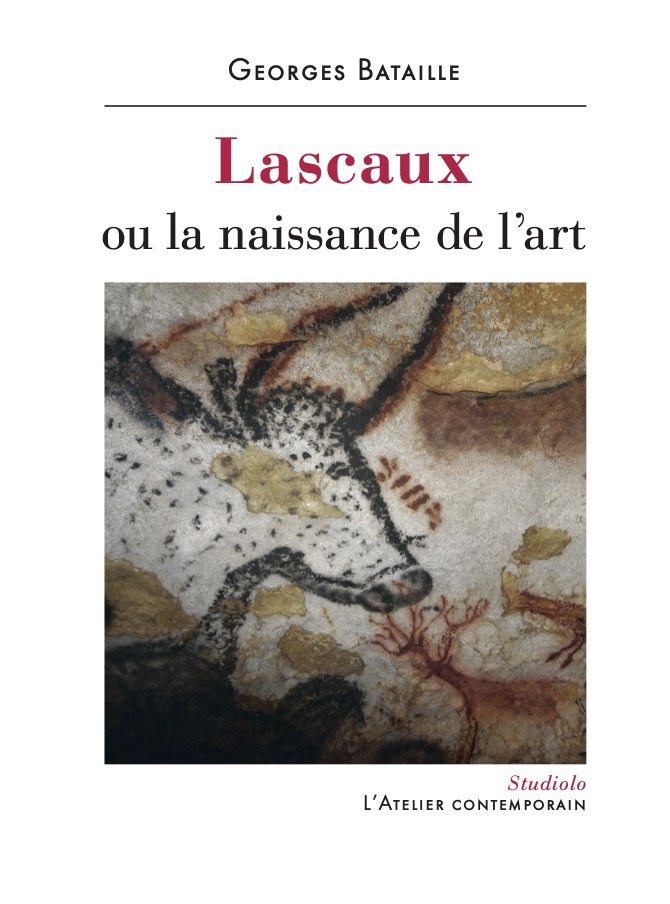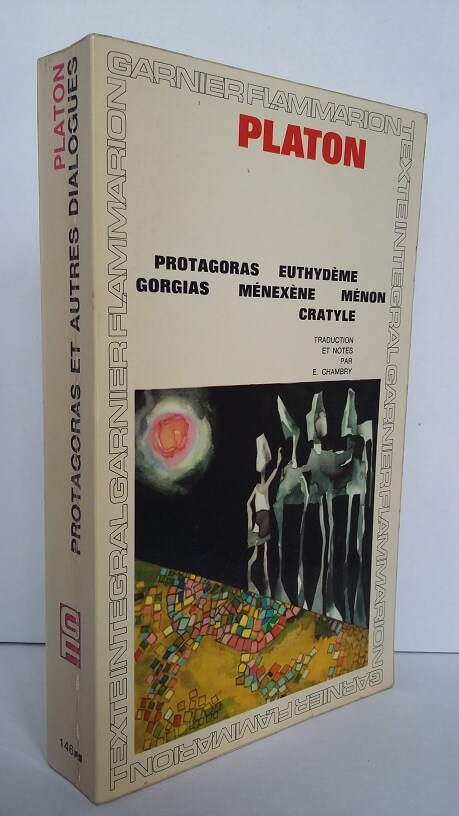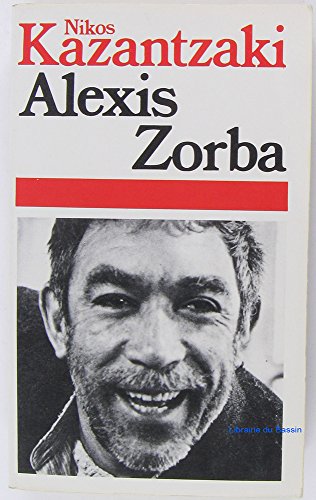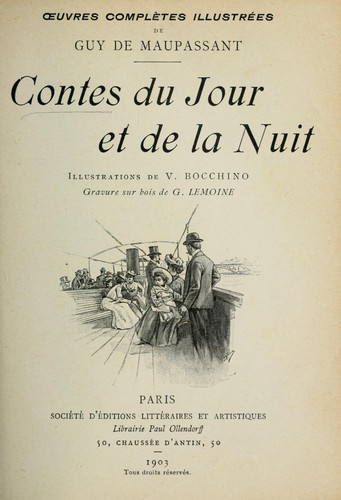
Illusions et pièges que l’Homme se prépare à lui-même
Maupassant (Guy de) 1882-1884, 1987 (1884, 1887), Contes du Jour et de la Nuit [in Œuvres complètes, t. 1 & 2], Gallimard, coll. « nrf La Pléiade », 1974 & 1979
Recueils :
– La Maison Tellier (1881)
– Mademoiselle Fifi (1882)
– Contes de la bécasse (1883)
– Clair de Lune (1883)
– Miss Harriet (1884)
– Les Sœurs Rondoli (1884)
– Yvette (1884)
– Contes du jour et de la nuit (1885)
– Monsieur Parent (1886)
– Toine (1886)
– La Petite Roque (1886)
– Le Horla (1887)
– Le Rosier de madame Husson (1888)
– La Main gauche (1889)
– Le Père Milon (1899)
– Le Colporteur (1900)
Sommaire
– Le Crime au père Boniface (1884) **** *
– Rose (1884) **** *
– Le Père (« Comme il habitait les Batignoles… ») (1883) *** *
– L’Aveu (1884) *** *
– La Parure (1884) *****
– Le Bonheur (1884) ****
– Le Vieux (1884) ****
– Un lâche (1884) ***
– L’Ivrogne (1884) **** *
– Une vendetta (1883) ****
– Coco (1884) *****
– La Main (1883) ***
– Le Gueux (1884) ****
– Un parricide (1882) ***
– Le Petit (1883) ****
– La Roche aux Guillemots (1882) ****
– Tombouctou (1883) ****
– Histoire vraie (1882) ****
– Adieu (1884) ***
– Souvenir (1884) ***
– La Confession (1883) ****
ajoutées ultérieurement à l’édition 1887 d’Ollendorf (et réédités dans le recueil posthume Le Colporteur en 1900)
– Le Fermier (1886) ****
– Jadis (1880) ****
– La Farce (Mémoires d’un farceur) (1883) ***
– Lettre trouvée sur un noyé (1884) ***
– L’Horrible (1884) ***
Le Crime au père Boniface **** *
Le pasteur Boniface, en livrant les journaux, s’abreuve de faits divers, de crimes atroces. Il entend un matin des gémissements, de « longs soupirs douloureux, une sorte de râle, un bruit de lutte » venant de l’intérieur de la maison du précepteur.
Usant de l’annonce par mise en abyme déceptrice – la lecture des faits-divers -, la farce grasse prend tout son intérêt humoristique augmenté par le jeu du brigadier qui retarde le dévoilement du mystère. Cette première nouvelle ou conte, tout en relevant du genre de la farce, évoque également le fantastique d’Hoffmann, avec la peur face à l’inconnu, l’incertitude, produite par l’homme lui-même qui se piège par les jeux retors de sa pensée vagabondant dans la fantasmagorie.
L’influence néfaste des faits-divers, ici moquée, si souvent exploitée par ailleurs dans la littérature (cf. notre article « atelier d’écriture d’après faits divers« ), nous lèvera peut-être le voile sur leur omniprésence à notre époque dans les médias, discrètement maquillée de l’air sérieux et sociétal de journalisme de l’immédiat…
p. 171 : « Qu’entendait-il ? sa figure impassible ne révélait rien, mais soudain sa moustache se retroussa, ses joues se plissèrent comme pour un sourire silencieux, et enjambant de nouveau la bordure de buis, il revint vers les deux hommes, qui le regardaient avec stupeur. »
Rose **** *
A la suite de la bataille de fleurs de Cannes, le cœur un peu alangui, Mme Margot conte une histoire à son amie pour la convaincre que rien n’est jamais parfait, « [qu’] il manque toujours quelque chose » pour le cœur. Une jeune fille parfaite, délicate et timide, est un jour rentrée à son service comme femme de chambre. Elle la considérait « en amie de condition inférieure »...
Le lien entre récit cadre et récit enchâssé repose sans doute sur l’insatisfaction capricieuse des classes supérieures, prenant la vie entière comme un jeu dont elles cherchent toujours à augmenter le plaisir jusqu’à la cruauté… La bataille des fleurs est un épisode typique des célébrations du Carnaval. Le travestissement bien-sûr l’est également mais davantage pratiqué par les pauvres, par désir de s’affranchir les barrières de classe. La réflexion autour du désir de ces « inférieurs » pour les femmes de hauts rangs est implicite. On peut toutefois tirer, par supposition, quelque hypothèse : est-ce que ce forçat malgré toute sa délicatesse, est devenu fou parce que sa maîtresse jouait avec lui, sachant très bien ce qu’elle faisait ?
On pourra aisément rapprocher ce conte (et quelques autres de ce recueil) de la pièce Les Bonnes, de Jean Genet, qui nous place à l’inverse du côté des domestiques qui se parent avec délice des habits de leur maîtresse, l’admirent, la jalousent et la haïssent.
p. 1169 : « Je t’assure que c’est très amusant d’être aimée par un domestique. Cela m’est arrivé deux ou trois fois. Ils roulent des yeux si drôles que c’est à mourir de rire. Naturellement, on se montre d’autant plus sévère qu’ils sont amoureux, puis on les met à la porte, un jour, sous le premier prétexte venu parce qu’on deviendrait ridicule si quelqu’un s’en apercevait. »
Le Père (« Comme il habitait les Batignoles… ») *** *
François Tessier avait autrefois fait céder une femme de basse condition nommée Louise, qu’il rencontrait chaque matin dans le bus et qu’il avait lâchement abandonnée enceinte. Mais voilà qu’il l’aperçoit dix ans plus tard, avec leur fils.
Pourquoi cet homme se lasse-t-il si vite de cette jeune femme qui lui plaisait tant ? Est-ce naturel ? à cause de la grossesse ? Est-ce parce que la femme s’est donnée trop facilement par rapport à ce qu’elle avait annoncé ? Ou plus simplement parce que l’homme de classe se fait la main sur des femmes de basse condition ? Parce qu’il ne peut être question que d’amusement cruel entre les deux classes, comme dans « Rose ».
On retrouve le thème de la répulsion pour la femme enceinte, développé dans Mont-Oriol, et celui de l’employé vieilli, seul, célibataire.
p. 1077 : « Il souffrait affreusement dans son isolement misérable de vieux garçon sans affections ; il souffrait une torture atroce, déchiré par une tendresse paternelle faite de remords, d’envie, de jalousie, et ce besoin d’aimer ses petits que la nature a mis aux entrailles des êtres. »
L’Aveu *** *
Céleste est grosse, elle vient de l’avouer à sa mère. C’est le cocher Polyte qui lui servait de taxi gratuitement en échange d’une « rigolade ».
Toujours cette personnalité innocente du paysan normand qui commet nombre d’actes inacceptables pour la bonne morale, sans s’en rendre compte. Mais la grossesse (illégitime) menace maintenant cet arrangement financier avec la morale. On reste ici dans le domaine de la farce.
p. 193 : « Céleste, une grande rousse aux cheveux brûlés, aux joues brûlées, tâchées de son comme si des gouttes de feu lui étaient tombées sur le visage, un jour qu’elle peinait au soleil. »
La Parure *****
Le fonctionnaire M. Loisel et sa femme, ménage plutôt modeste, sont invités à une réception donnée chez le ministre de l’instruction publique. Mais Mme Loisel est gênée de se montrer pauvre comme elle est au milieu de grandes dames. Son mari lui offre une belle robe et elle emprunte à une amie une rivière de diamants.
Ce conte part sur une situation inversée (homme-femme) du « Parapluie ». Mais au lieu de porter l’attention sur le ridicule du bourgeois trop économe, Maupassant attire l’attention sur une femme qui aspire et se sent d’une condition supérieure et souffre de ne pouvoir être elle-même. Cette situation rappelle un peu la scène du bal de Madame Bovary. De plus, la Mme Forestier y rappelle un personnage de Bel-Ami, roman reposant également sur une problématique d’ascension sociale, ou de transgression sociale qui risque d’être sanctionnée…
« La Parure » offre aussi une révélation renversée des « Bijoux ». Ce sacrifice forcé du ménage pour rembourser la parure est montré comme une destruction du corps et de l’intelligence, un vieillissement accéléré dû à une seule soirée d’amusement, de plaisir et d’écart pour une vie de droiture – le tout dans sa durée, sa dureté, laissées dans le hors-texte, à l’imagination du lecteur, bien épuisé d’imaginer une telle traversée du désert, et le choc du renversement douloureusement comique de la chute.
p. 1204 : « Mme Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti, d’ailleurs, tout d’un coup, héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable. Elle payerait. On renvoya la bonne ; on changea de logement ; on loua sous les toits une mansarde. »
Le Bonheur ****
Lors d’un voyage en Corse, un vieux Monsieur de Nancy est hébergé dans une petite chaumière perdue seule dans un vallon. Il se trouve que ce ménage vient de Nancy.
Bien qu’improbable hasard, ce conte illustre un « ovni » (auquel on a du mal à croire), une exception de réussite de l’amour, de la géographie, que cette petite idylle isolée, loin de tout, sauvage. Le bonheur semble possible uniquement en retrait de la société (comme dans Tristan et Iseult, mais de façon ici durable), là où ni la femme ni l’homme ne sont tentés, là où l’instinct animal efface l’ennui et les envies artificielles insatiables. Cette idylle rare se double de l’acceptation tout à fait surprenante d’un « recul de classe ». Il y a là quelque chose de très christique ou de franciscain dans l’abandon de la richesse et dans cet amour né dans le voeu de pauvreté, comme si c’était là l’antidote, connu mais jamais accepté, au malheur annoncé de l’ambition de Bel-Ami.
p. 1244 : « Cette fille riche avait suivi cet homme, ce paysan. Elle était devenue elle-même une paysanne. Elle s’était faite à sa vie sans charmes, sans luxe, sans délicatesse d’aucune sorte, elle s’était pliée à ses habitudes simples. Et elle l’aimait encore. Elle était devenue une femme de rustre, en bonnet, en jupe de toile. Elle mangeait dans un plat de terre sur une table de bois, assise sur une chaise de paille, une bouillie de choux et de pommes de terre au lard. Elle couchait sur une paillasse à son côté. »
Le Vieux ****
On a prévenu M. et Mme Chicot que le vieux pé ne passerait pas la nuit, alors ils ont tout prévu, pour ne pas perdre de temps précieux, et ont déjà planifié la cérémonie et l’enterrement.
Figure du dégoût (ou nonchalance ?) réussie mais raccourcie psychologiquement. Maupassant tirerait cet épisode, de sa propre enfance. Cependant, on ne voit pas bien ici, pourquoi cet homme, contrairement à tant d’autres, a été traumatisé à ce point. Cette scène obsédante qui se répète de très nombreuses fois dans l’oeuvre, de deuil bourgeois, symbolise la perte d’humanité de l’homme qui compte, qui économise, sur la mort (on pourra faire le lien avec le fameux titre de Céline, Mort à crédit). Sans doute que cette malsaine anticipation de la mort, la rend présente à l’esprit et pourrit donc le moment présent… l’homme encore se piège lui-même par son imagination… En contraste total avec l’humanité retrouvée du conte « Bonheur » qui précédait.
p.1133 : « « Il [le pé] est quasiment passé. C’est samedi l’imunation, à sept heures, vu les cossards qui pressent. »
Le voisin répliqua :
« Entendu. Bonne chance ! Portez-vous bien. »
Elle répondit à sa politesse :
« Merci, et vous d’même. »
Puis elle se remit à cueillir ses pomes. »
Un lâche ***
Le beau Signoles, qui passe pour un expert en épée et revolver, gifle un homme qui regardait avec insistance une de ses amies. Un duel est engagé entre les deux hommes.
Repris, sans la conclusion, dans Bel-Ami (chapitre VII), ce conte décrit la déroute progressive d’un esprit livré à la peur, encore une fois l’esprit de l’homme et son imaginaire qui se détruit lui-même. Malgré cela, la fin est peu crédible. On pourrait rapprocher ce conte de textes comme le Dernier jour d’un condamné de Victor Hugo, cherchant à plonger le lecteur dans un moment de torture de l’esprit.
p. 1163 : « Après-demain à cette heure-ci, je serais peut-être mort,. Cette personne en face de moi, ce moi que je vois dans la glace, ne sera plus. Comment ! me voici, je me regarde, je me sens vivre, et dans vingt-quatre heures je serais couché dans ce lit, mort, les yeux fermés, froid, inanimé, disparu. »
L’Ivrogne **** *
Jérémie se laisse saouler par son ami et collègue Mathurin. Rentrant titubant dans les rues de leur petit village de pêcheurs, il finit par appeler sa femme tout en frappant à la porte de chez lui. La porte s’ouvre et il s’écroule sur le palier. Quelqu’un passe au dessus de lui et disparaît dans la nuit.
Encore une fois, tout se passe hors du champ raconté. C’est le propre de l’ivrogne de ne pas voir sa réalité. Ici, cet aveuglement farcesque tourne à l’horrible tragique. Et son ampleur est d’autant plus terrible que le lecteur la constitue d’un flash, au moment de la chute de la nouvelle. C’est au lecteur de se constituer des explications en cherchant des bribes d’indices au détour d’une expression étrange laissée par la narration, traces d’un arrière-récit effacé. Il s’agit bien encore ici d’un piège psychologique que cet homme s’est tendu à lui-même et à sa vie en cédant à l’alcool…
p. 97 : « Jérémie fit trois pas, puis oscilla, étendit les mains, rencontra un mur qui le soutint debout et se remit en marche en trébuchant. Par moments une bourrasque, s’engouffrant dans la rue étroite, le lançait en avant, le faisait courir quelques pas ; puis quand la violence de la trombe cessait, il s’arrêtait net, ayant perdu son pousseur, et il se remettait à vaciller sur ses jambes capricieuses d’ivrogne.
Il allait, d’instinct, vers sa demeure, comme les oiseaux vont au nid. Enfin, il reconnut sa porte et il se mit à la tâter pour découvrir la serrure et placer la clef dedans. Il ne trouva pas le trou et jurait à mi-voix. Alors il tapa dessus à coups de poing, appelant sa femme pour qu’elle vînt l’aider : « Mélina ! Eh ! Mélina ! » »
Une Vendetta ****
La mère Saverini a juré de venger son fils tué par Nicolas Ravolati. Sa chienne Sévillante hurle à la mort et ne semble pas non plus oublier son jeune maître.
Superbe pièce sur la vengeance corse, ce conte offre de beaux tableaux psychologiques sur la mère corse que seule tient sa volonté de venger son fils, et sur la chienne qui apprend à tuer (l’animal domestique devenant le prolongement de la folie des hommes, comme dans Chien blanc).
p. 1031 : « Va, va, tu seras vengé, mon petit, mon garçon, mon pauvre enfant. Dors, dors, tu seras vengé, entends-tu ? C’est la mère qui le promet ! Et elle tient toujours sa parole, la mère, tu le sais bien. »
Coco *****
Le petit Zidore doit s’occuper chaque jour de Coco, un très vieux cheval blanc. Mais Zidore ne comprend pas qu’on gaspille autant pour une bête devenue inutile et il la maltraite.
Évoquant à nouveau la cruauté de l’homme envers l’animal, Maupassant y mêle cette fois un autre thème récurrent, parallèle avec la vie humaine, le boulet social (comme dans « L’Aveugle ») : un individu incapable (ici par vieillesse) a-t-il encore une place dans la société ? Le vieillard qui ne travaille pas a-t-il encore droit à son pain ? Maupassant montre ici une jeunesse qui ne se rend pas compte parce qu’elle n’était pas, qu’avant d’être inutile, le vieux a été jeune et travailleur. C’est la question de l’entraide (au sens large de L’Entraide de Krpotkine), de la solidarité sociale et intergénérationnelle, qui est en question mais qui n’est pas évidente pour l’œil de l’inexpérience, qui n’est pas en accord avec le bon sens du présent, par l’économie à courte terme…
p.1150 : « Depuis longtemps déjà, il s’étonnait qu’on gardât Coco, s’indignant de voir perdre du bien pour cette bête inutile. Du moment qu’elle ne travaillait plus, il lui semblait injuste de la nourrir, il lui semblait révoltant de gaspiller de l’avoine, de l’avoine qui coûtait si cher, pour ce bidet paralysé. […] Et une haine grandissait en son esprit confus d’enfant, une haine de paysan rapace, de paysan sournois, féroce, brutal et lâche. »
p.1151 : « Il lui semblait que cette misérable rosse volait le manger des autres, volait l’avoir des hommes, le bien du bon Dieu, le volait même aussi, lui, Zidore, qui travaillait. »
La Main ***
M. Bermutier, juge d’instruction à Ajaccio, fait la connaissance d’un Anglais du nom de John Rowell, chasseur peu bavard, qui possède chez lui la main desséchée d’un homme qu’il a tué.
Reprise du premier conte de Maupassant : « La Main d’écorché » (1875).
Bien que l’idée d’un fantastique juste inexplicable mais non farfelu soit suggérée, le principe n’est pas encore vraiment appliqué. Seule la vengeance surnaturelle de la main est possible. Avoir placé cette vengeance étrange en Corse fait bien-sûr le lien avec la célèbre pratique incorrigible de la vendetta qui serait donc inscrite dans le corps même des Corses (dans le sang, dans le gène dirait-on). Cependant l’exposition explicative remplace ce qui l’aurait été davantage : la mise en place d’une atmosphère tendue. L’original était finalement plus vivant bien que maladroit.
p. 1117 : « Mais si, au lieu d’employer le mot surnaturel pour exprimer ce que nous ne comprenons pas, nous nous servions simplement du mot inexplicable, cela vaudrait beaucoup mieux. »
Le Gueux ****
Un estropié fait la manche entre trois hameaux. Mais tous les paysans en ont assez de nourrir ce bon à rien.
Recoupant les thèmes de « L’Aveugle » et de « Coco », Maupassant montre comment l’individu inactif devient inévitablement exclu, inhumain, pour les autres. Misère, souffrance physique, débilité morale, difformité, sont réunies en un seul être : le mendiant. Reflet en négatif, cauchemar du bourgeois. Faire disparaître, cacher, éliminer, cette incarnation de la peur de l’échec social…
p. 1225 : « Il ne voulait point s’en aller cependant, parce qu’il ne connaissait pas autre chose sur la terre que ce coin de pays, ces trois ou quatre hameaux où il avait traîné sa vie misérable. Il avait mis des frontières à sa mendicité et il n’aurait jamais passé les limites qu’il était accoutumé de ne point franchir. »
Un parricide ***
Un enfant abandonné, devenu menuisier, découvre ses vrais parents et la raison qui les force à ne pas le reconnaître. Il les tue.
Démonstration contre l’abandon d’enfant, et critique des convenances absurdes qui détruisent des enfants. À la manière du Dernier Jour d’un condamné, Maupassant confronte le lecteur – bon bourgeois – avec le « je » du criminel – il lui impose une conversation avec un être qu’il enterrerait volontiers sans écouter sa version, par volonté de repousser tout ce qui touche à l’horreur loin de lui, ce qui touche à sa propre ombre, double potentiel de lui-même ayant échoué dans son ascension sociale…
p. 556 : « Vous allez parler de parricide ! Étaient-ils mes parents, ces gens pour qui je fus un fardeau abominable, une terreur, une tâche d’infamie ; pour qui ma naissance fut une calamité et ma vie une menace de honte ? Ils cherchaient un plaisir égoïste ; ils ont eu un enfant imprévu. Ils ont supprimé l’enfant. Mon tour est venu d’en faire autant pour eux. »
Le Petit ****
M. Lemonnier, commerçant plutôt riche, épouse sa voisine pauvre par amour. Elle meurt en couche et lui laisse un petit que son ami M. Duretour gâte autant que son propre fils.
Il est dommage que le secret soit si vite éventé. Ce conte donnera par la suite la longue nouvelle « Monsieur Parent » (1885). Il annonce aussi le thème particulièrement développé dans Fort comme la mort (1889) de la reproduction comme prolongation de soi, comme étrange possibilité de dépassements des limites de la vie.
p. 958 : « Il l’aima d’un amour passionné et douloureux, d’un amour malade où restait le souvenir de la mort, mais où survivait quelque chose de son adoration pour la morte. C’était la chair de sa femme, son être continué, comme une quintessence d’elle. Il était, cet enfant, sa vie même tombée en un autre corps : elle était disparût pour qu’il existât. – Et le père l’embrassait avec fureur. – Mais aussi il l’avait tuée, cet enfant, il avait pris, volé cette existence adorée, il s’en était nourri, il avait bu sa part de vie. »
La Roche aux Guillemots ****
R.D.V. annuel de vieux amis pour la chasse aux guillemots à Étretat, mais voilà que M. d’Arnelles est un peu bizarre et maladroit cette année. Aurait-il un cadavre au placard ?
Cette passion pour la chasse qui ici prend le pas sur le devoir et sur la bienséance pose une question essentielle : est-ce que le chasseur conserve une notion de la mort ? Encore une fois, le comique normand prend appui sur le bon vivant, l’insouciance, que la mort et les règles traditionnelles n’effraient pas plus que ça, et sur le fait que le mort s’avère n’être que le gendre…
p. 411 : « Pourquoi ne vont-ils jamais ailleurs, ne choisissent-ils aucun autre point de cette longue falaise blanche et sans cesse pareille qui court du Pas-de-Calais au Havre ? Quelle force, quel instinct invincible, quelle habitude séculaire poussent ces oiseaux à revenir en ce lieu ? Quelle première émigration, quelle tempête peut-être a jeté leurs pères sur cette roche ? Et pourquoi les fils, les petits-fils, tous les descendants des premiers y sont-ils toujours retournés ? »
Tombouctou ****
Pendant la guerre, un grand noir prospère, s’abreuve à même les vignes et ouvre, après la guerre, un restaurant de cuisine militaire.
Tombouctou, avec son enrichissement sur les cadavres prussiens, est symbole d’une revanche affreuse, terrible, qui compense la défaite. La farce reste comme un retour de bâton du colonialisme, le mythe de la nécrophagie des Africains que le personnage incarne comme un cauchemar. Là encore, un piège que l’homme, par son action immorale gavée à l’ambition sociale, s’est tendu lui-même.
p. 927 : « C’est que Tombouctou ne faisait point la guerre pour l’honneur, mais bien pour le gain. Tout ce qu’il trouvait, tout ce qui lui paraissait avoir une valeur quelconque, tout ce qui brillait surtout, il le plongeait dans sa poche ! Quelle poche ! un gouffre qui commençait à la hanche et finissait aux chevilles. Ayant retenu un terme de troupier, il l’appelait sa « profonde », et c’était sa profonde, en effet. »
Histoire vraie ****
M. de Varnetot s’est octroyé les services d’une belle petite. Mais voilà qu’elle est grosse de lui… Il faut bien qu’il s’en débarrasse maintenant !
Maupassant a choisi de confier le récit à un personnage sordide, mauvais noble, ancien fainéant devenu alcoolique. Cette convenance qu’il respecte, alors qu’il n’en respecte aucune autre, en devient d’autant plus cruelle qu’il en parle comme d’une obligation indépendante de sa volonté. Il y a là une inversion homme-femme de la nouvelle « Rose », pour une même cruauté.
Le parallèle femme et animal domestique – la jument qui sert de monnaie d’échange, Mirza, chienne revendue on ne sait pour quel caprice – est d’autant plus insupportable. Les « grands » décident des vies de leurs serfs comme d’objets jetables. Thème obsédant du recueil.
p. 461 : « Elle faisait un bruit du diable. Je la consolai comme je pus et je la reconduisis à la barrière. J’appris en effet que son mari la battait ; et que sa belle-mère lui rendait la vie dure, la vieille chouette.
Deux jours après elle revenait. Et elle me prit dans ses bras, elle se traîna par terre :
« Tuez-moi, mais je n’veux pas retourner là-bas. »
Tout à fait ce qu’aurait dit Mirza si elle avait parlé !
Ça commençait à m’embêter, toutes ces histoires; et je filai pour six mois encore. Quand je revins… Quand je revins, j’appris qu’elle était morte trois semaines auparavant, après être revenue au château tous les dimanches… toujours comme Mirza. L’enfant aussi était mort huit jours après. »
Adieu ***
Après douze ans, un homme rencontre par hasard la femme avec laquelle il avait eu sa plus belle histoire. Elle est la grosse mère de quatre filles.
Déformation du corps de la femme, déformation du temps… On pourrait comparer le sujet avec « Je suis un voyou » de Georges Brassens. Reprenant le principe global de « Rencontre », Maupassant inverse certaines composantes : l’ancien temps est le temps idéal. Le temps nouveau est commun, médiocre. Ce cheminement esthétique et conceptuel qui sera perfectionné dans Fort comme la mort, est juste ici une étincelle de révolte. Car il n’est ici question que de temps passé et de l’adieu à une jeunesse révolue.
p. 1249 : « C’était elle ! cette grosse femme commune, elle ? Et elle avait pondu ces quatre filles depuis que je ne l’avais vue. Et ces petits êtres m’étonnaient autant que leur mère elle-même. Ils sortaient d’elle ; ils étaient grands déjà, ils avaient pris place dans la vie. Tandis qu’elle ne comptait plus, elle, cette merveille de grâce coquette et fine. Je l’avais vue hier, me semblait-il, et je la retrouvais ainsi ! Était-ce possible ? Une douleur violente m’étreignait le cœur, et aussi une révolte contre la nature même, une indignation irraisonnée contre cette œuvre brutale, infâme de destruction. »
Souvenir ***
Se baladant dans la forêt de Saint-Cloud, notre conteur fait la rencontre d’un couple un peu perdu. Il les escorte mais l’homme finit par retourner en arrière chercher son porte-feuilles et son chien…
Reprise de la « Première sortie » des Dimanches d’un bourgeois de Paris. Cependant, ici, l’aventure est un succès et prend une coloration de « souvenir » (bon souvenir assumé par le conteur) alors qu’elle n’était que récit-fiction au présent. Ce conte est finalement juste le récit d’une aventure amoureuse amusante (l’allégorie du bourdon est particulièrement frappante).
p. 122 : « Devant moi, s’ouvrit une ravissante allée, dont le feuillage un peu grêle laissait pleuvoir partout sur le sol des gouttes de soleil qui illuminaient des marguerites blanches. Elle s’allongeait interminablement, vide et calme. Seul, un gros frelon solitaire et bourdonnant la suivait, s’arrêtant parfois pour boire une fleur qui se penchait sous lui, et repartant presque aussitôt pour se reposer encore un peu plus loin. Son corps énorme semblait en velours brun rayé de jaune, porté par des ailes transparentes et démesurément petites. »
La Confession ****
Marguerite, sur son lit de mort, se confesse devant sa grande sœur : elle aimait et a provoqué la mort du fiancé de Suzanne, à la suite de laquelle toutes deux avaient décidé de ne point se marier.
Un des grands thèmes de Maupassant : un choix qui à un moment a déterminé une vie entière. La petite bêtise d’une enfance gâtée a gâché deux existences. Une minute d’aveu change la signification de toute une vie, transforme la grande tragédie en une comédie pitoyable… Et c’est à nouveau tout le non-dit qui surgit brutalement à l’imagination du lecteur : une vie entière remplie de pensées, de sentiments, de rêveries, qui brutalement se vide de contenu. Une vie humaine qui une fois déshabillée de ses illusions n’est plus qu’absurde et dont on ne peut plus extraire qu’un rire nerveux de dérision…
p. 1039 : « Elle pensait à lui qu’elle aurait pu aimer si longtemps ! Quelle bonne vie ils auraient eue ! Elle le revoyait, dans l’autrefois disparu, dans le vieux passé à jamais éteint. Morts chéris ! comme ils vous déchirent le cœur ! Oh ! ce baiser, son seul baiser ! Elle l’avait gardé dans l’âme. Et puis plus rien, plus rien dans toute son existence !… »