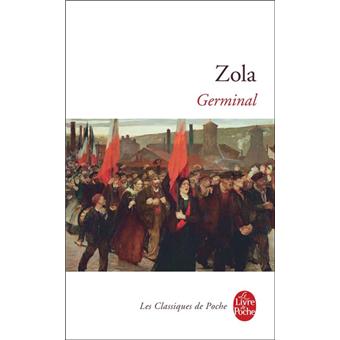
Sommet du roman expérimental ou pourquoi les révoltes ouvrières ne cesseront jamais.
Zola (Émile) 1885, Germinal (Les Rougon-Macquart, vol. 13), Le Livre de Poche, 2000
Résumé
Étienne Lantier, ancien cheminot licencié pour avoir giflé son employeur, vagabonde dans le nord à la recherche d’un travail. Il arrive aux mines de Montsou et est pris dans l’équipe du Maheu. Le travail est horriblement éprouvant mais la camaraderie de Maheu et la gentillesse de sa fille Catherine le font rester. Au contact de l’aubergiste, ancien syndicaliste, et de l’anarchiste Souvarine, Lantier cultive sa conscience politique et lance une caisse de prévoyance. Les dirigeants de la mine veulent récupérer le contrôle de cette caisse et font pression sur les salaires. À la suite d’un accident qui manque de tuer un fils Maheu, la grève est décidée.
Commentaires
Roman de la formation politique par excellence, Germinal est peut-être aussi l’un de ceux qui met le plus en application les principes naturalistes. Lantier représente le lecteur, et même l’auteur, découvrant l’univers des mines et la dureté du travail ouvrier, pour les corps, pour la santé, mais aussi la camaraderie, l’abrutissement des esprits par la fatigue, ouvriers qui ne sont plus que des corps érotisés par l’effort, l’ensauvagement imagé par le charbon qui colore les corps et les faces. De ce choc, Zola tire les plus beaux effets littéraires : cette gigantesque mine avec ses machines hurlantes, ses grandes lumières et son trou qui fume, ses galeries intestines, apparaît comme un gigantesque monstre. Ce charbon qui entre même dans les corps, jusqu’à presque leur servir de sang, les rendant malades ou fous violents. Chaval est-il encore homme ou bien est-il devenu un animal-mineur ? Zola montre bien comment s’appliquent facilement les thèses marxistes sur le salaire minimum assurant la reproduction de la force de travail. Les mineurs vivent correctement dans les corons, mais complètent tout de même leur pécule par la culture de leur jardinet. Ils sont dépendants aussi du travail des enfants, et donc de la bonne santé de chaque travailleur. La perte d’un travailleur – mariage, accident, retraite incomplète – rompt l’équilibre fragile des familles. Dans ces conditions, le mouvement social, la grève, s’avère très difficile. La famille Maheu se dégrade rapidement. Le mouvement social, pour de simples ouvriers peut ainsi être considéré comme un sacrifice pour l’avenir d’une classe sociale dans son ensemble.
C’est ainsi que l’échec de la grève n’en est un que pour les personnages, mais l’épopée tragique pose les graines de mouvements sociaux à venir. Sans manquer de dénoncer certaines dérives des ouvriers et de leur lutte (violences, vengeances), de noter les répercussions négatives comme la faillite du petit patron qui traitait le plus correctement ses employés, Zola s’inscrit bien dans la pensée marxiste : la révolte ouvrière est inévitable face à l’accaparement capitaliste croissant.
Devant les événements, la violence subie par les ouvriers, la révolte de Lantier et du lecteur sont inévitables. Celle-ci ne peut être seulement intellectuelle : face à la souffrance, à l’urgence, elle doit devenir action. Mais quelles limites à donner à cette action ? La pensée socialiste, qui privilégie les négociations et en fin de compte n’arrive à rien ; la pensée anarchiste violente qui pense à laisser exprimer la colère quitte à tout détruire… Lantier navigue entre ces pôles découvrant que chaque position a des conséquences cruelles. La première d’entre elles est de faire du Maheu un martyr et de lui-même un objet de détestation par ses collègues. L’action politique est destruction de soi, ou bien se transforme en machiavélisme détestable. Par l’exemple de son personnage, Zola propose cette réflexion au lecteur.
À côté des sources de théories politiques, le roman est traversé, alimenté, par une véritable enquête documentaire, et de terrain : visites de mines et des corons, croquis, entrevues avec les habitants, les syndicalistes, les patrons, suivi des mouvements dans les journaux, des événements… De plus, Zola y applique ses techniques naturalistes : patrimoines génétiques (alcoolisme, dérèglement du désir charnel, violence…) déterminant les personnages et leurs actions, tempérées par leur éducation, plus que par leurs sentiments qui tendent à renforcer leurs instincts ; fiches personnages développant la complexité et l’épaisseur des personnages et leur créant une vie en dehors des pages ; ébauches, plans et premiers jets… Le tout pouvant être retrouvé dans les dossiers préparatoires, scannés par la BNF (Gallica), parfois édités mais souvent incomplets.
Ce travail sur la matière du réel ne fait pas de Zola un écrivain-journaliste, car il fictionnalise ce qu’il trouve. Le but est bien autre que documentaire : les croquis sont déjà orientés fiction. Le but pour Zola est de faire un roman qui porte un reflet de la vie des hommes, ici des ouvriers, mais surtout qui laisse transparaître leurs croyances, leurs émotions, leurs espoirs… L’action politique, les convictions, ne sont pas décidées par un raisonnement raisonnable mais par le sensuel, le rapport aux sens. On éprouve par le corps, la souffrance et l’envie de révolte.
Passages retenus
Le cheval au bas de l’échelle ouvrière, p. 107 :
C’était Bataille, le doyen de la mine, un cheval blanc qui avait dix ans de fond. Depuis dix ans, il vivait dans ce trou, occupant le même coin de l’écurie, faisant la même tâche le long des galeries noires, sans avoir jamais revu le jour. Très gras, le poil luisant, l’air bonhomme, il semblait y couler une existence de sage, à l’abri des malheurs de là haut. Du reste, dans les ténèbres, il était devenu d’une grande malignité. La voie où il travaillait avait fini par lui être si familière, qu’il poussait de la tête les portes d’aérage, et qu’il se baissait, afin de ne pas se cogner, aux endroits trop bas. Sans doute aussi il comptait ses tours, car lorsqu’il avait fait le nombre réglementaire de voyages, il refusait d’en recommencer un autre, on devait le reconduire à sa mangeoire. Maintenant, l’âge venait, ses yeux de chat se voilaient parfois d’une mélancolie. Peut-être revoyait-il vaguement, au fond de ses rêvasseries obscures, le moulin où il était né, près de Marchiennes, un moulin planté près de la Scarpe, entouré de larges verdures, toujours éventé par le vent. Quelque chose brûlait en l’air, une lampe énorme, dont le souvenir exact échappait à sa mémoire de bête. Et il restait la tête basse, tremblant sur ses vieux pieds, faisant d’inutiles efforts pour se rappeler le soleil.
Cependant, les manœuvres continuaient dans le puits, le marteau des signaux avait tapé quatre coups, on descendait le cheval ; et c’était toujours une émotion, car il arrivait parfois que la bête, saisie d’épouvante, débarquait morte. En haut, lié dans un filet, il se débattait éperdument ; puis, dès qu’il sentait le sol manquait sous lui, il restait comme pétrifié, il disparaissait sans un frémissement de la peau, l’oeil agrandi et fixe. Celui-ci étant trop gros pour passer entre les guides, on avait dû, en l’accrochant au-dessus de la cage, lui rabattre et lui attacher la tête sur le flanc. La descente dura près de trois minutes, on ralentissait la machine par précaution. Aussi, en bas, l’émotion grandissait-elle. Quoi donc ? Est-ce qu’on allait le laisser en route, pendu dans le noir ? Enfin, il parut, avec son immobilité de pierre, son œil fixe, dilaté de terreur. C’était un cheval bai, de trois ans à peine, nommé Trompette.
— Attention ! Criait le père Mouque, chargé de le recevoir. Amenez-le, ne le détachez pas encore.
Bientôt, Trompette fut couché sur les dalles de fonte, comme une masse. Il ne bougeait toujours pas, il semblait dans le cauchemar de ce trou obscur, infini, de cette salle profonde, retentissante de vacarme. On commençait à le délier, lorsque Bataille, dételé depuis un instant, s’approcha, allongea le cou pour flairer ce compagnon, qui tombait ainsi de la terre. Les ouvriers élargirent le cercle en plaisantant. Eh bien, quelle bonne odeur lui trouvait-il ? Mais Bataille s’animait, sourd aux moqueries. Il lui trouvait sans doute la bonne odeur du grand air, l’odeur oubliée du soleil dans les herbes. Et il éclata tout à coup d’un hennissement sonore, d’une musique d’allégresse, où il semblait y avoir l’attendrissement d’un sanglot. C’était la bienvenue, la joie des choses anciennes dont une bouffée lui arrivait, la mélancolie de ce prisonnier de plus qui ne remonterait que mort.
Ah ! Cet animal de Bataille ! criaient les ouvriers, égayés par ces farces de leur favori. Le voilà qui cause avec le camarade.
Trompette, délié, ne bougeait toujours pas. Il demeurait sur le flanc, comme s’il eut continué à sentir le filet l’étreindre, garrotté par la peur. Enfin, on le mit debout d’un coup de fouet, étourdi, les membres secoués d’un grand frisson. Et le père Mouque emmena les deux bêtes qui fraternisaient.
La nuit des prolétaires, p. 218 :
Maintenant, chaque soir, chez les Maheu, on s’attardait une demi-heure, avant de monter se coucher. Toujours Étienne reprenait la même causerie. Depuis que sa nature s’affinait, il se trouvait blessé davantage par les promiscuités du coron. Est-ce qu’on était des bêtes, pour être ainsi parqués, les uns contre les autres, au milieu des champs, si entassés qu’on ne pouvait changer de chemise sans montrer son derrière aux voisins ! Et comme c’était bon pour la santé, et comme les filles et les garçons s’y pourrissaient forcément ensemble !
Dame, répondait Maheu, si l’on avait plus d’argent, on aurait plus d’aise… Tout de même, c’est bien vrai que ça ne vaut rien pour personne, de vivre les uns sur les autres. Ça finit toujours par des hommes saouls et par des filles pleines.
Et la famille partait de là, chacun disait son mot, pendant que le pétrole de la lampe viciait l’air de la salle, déjà empuantie d’oignon frit. Non, sûrement, la vie n’était pas drôle. On travaillait en vraies brutes à un travail qui était la punition des galériens autrefois, on y laissait la peau plus souvent qu’à son tour, tout ça pour ne même pas avoir de la viande sur sa table, le soir. Sans doute on avait sa pâtée quand même, on mangeait, mais si peu, juste de quoi souffrir sans crever, écrasé de dettes, poursuivi comme si l’on volait son pain. Quand arrivait le dimanche, on dormait de fatigue. Les seuls plaisirs, c’était de se saouler ou de faire une enfant à sa femme ; encore la bière vous engraissait trop le ventre, et l’enfant, plus tard, se foutait de vous. Non, non, ça n’avait rien de drôle.
Alors, la Maheude s’en mêlait.
L’embêtant, voyez-vous, c’est lorsqu’on se dit que ça ne peut pas changer… Quand on est jeune, on s’imagine que le bonheur viendra, on espère des choses ; et puis, la misère recommence toujours, on reste enfermé là-dedans… Moi, je ne veux du mal à personne, mais il y a des fois où cette injustice me révolte. »
Le cauchemar du grand soir, p. 410 :
C’était la vision rouge de la révolution qui les emporterait tous, fatalement, par une soirée sanglante de cette fin de siècle. Oui, un soir, le peuple lâché, débridé, galoperait ainsi sur les chemins, ; et il ruissellerait du sang des bourgeois, il promènerait des têtes, il sèmerait l’or des coffres éventrés. Les femmes hurleraient, les hommes auraient ces mâchoires de loups, ouvertes pour mordre. Oui, ce serait les mêmes guenilles, le même tonnerre de gros sabots, la même cohue effroyable, de peau sale, d’haleine empestée, balayant le vieux monde, sous leur poussée débordante de barbares. Des incendies flamberaient, on ne laisserait pas debout une pierre des villes, on retournerait à la vie sauvage dans les bois, après le grand rut, la grande ripaille, où les pauvres, en une nuit, efflanqueraient les femmes et videraient les caves des riches. Il n’y aurait plus rien, plus un sou des fortunes, plus un titre des situations acquises, jusqu’au jour où une nouvelle terre repousserait peut-être. Oui, c’étaient ces choses qui passaient sur la route, comme une force de la nature, et ils en recevaient le vent terrible au visage.
Mort d’un cheval, p. 485 :
Et, un quart d’heure plus tard, comme la bande de grévistes, peu à peu grossie, devenait menaçante, une large porte se rouvrit au rez-de-chaussée, des hommes parurent, charriant la bête morte, un paquet lamentable, encore serré dans le filet de corde, qu’ils abandonnèrent au milieu des flaques de neige fondue. Le saisissement fut tel, qu’on ne les empêcha pas de rentrer et de barricader la porte de nouveau. Tous avaient reconnu le cheval, à sa tête repliée et raidie contre le flanc. Des chuchotements coururent.
— C’est Trompette, n’est-ce pas ? c’est Trompette.
C’était Trompette, en effet. Depuis sa descente, jamais il n’avait pu s’acclimater. Il restait morne, sans goût à la besogne, comme torturé du regret de la lumière. Vainement, Bataille, le doyen de la mine, le frottait amicalement de ses côtes, lui mordillait le cou, pour lui donner un peu de la résignation de ses dix années de fond. Ces caresses redoublaient sa mélancolie, son poil frémissait sous les confidences du camarade vieilli dans les ténèbres ; et, tous deux, chaque fois qu’ils se rencontraient et qu’ils s’ébrouaient ensemble, avaient l’air de se lamenter, le vieux d’en être à ne plus se souvenir, le jeune de ne pouvoir oublier. À l’écurie, voisins de mangeoire, ils vivaient la tête basse, se soufflant aux naseaux, échangeant leur continuel rêve du jour, des visions d’herbes vertes, de routes blanches, de clartés jaunes, à l’infini. Puis, quand Trompette, trempé de sueur, avait agonisé sur sa litière, Bataille s’était mis à le flairer désespérément, avec des reniflements courts, pareils à des sanglots. Il le sentait devenir froid, la mine lui prenait sa joie dernière, cet ami tombé d’en haut, frais de bonnes odeurs, qui lui rappelaient sa jeunesse au plein air. Et il avait cassé sa longe, hennissant de peur, lorsqu’il s’était aperçu que l’autre ne remuait plus.
Mouque, du reste, avertissait depuis huit jours le maître-porion. Mais on s’inquiétait bien d’un cheval malade, en ce moment-là ! Ces messieurs n’aimaient guère déplacer les chevaux. Maintenant, il fallait pourtant se décider à le sortir. La veille, le palefrenier avait passé une heure avec deux hommes, ficelant Trompette. On attela Bataille, pour l’amener jusqu’au puits. Lentement, le vieux cheval tirait, traînait le camarade mort, par une galerie si étroite, qu’il devait donner des secousses, au risque de l’écorcher ; et, harassé, il branlait la tête, en écoutant le long frôlement de cette masse attendue chez l’équarrisseur. À l’accrochage, quand on l’eut dételé, il suivit de son œil morne les préparatifs de la remonte, le corps poussé sur des traverses, au-dessus du puisard, le filet attaché sous une cage. Enfin, les chargeurs sonnèrent à la viande, il leva le cou pour le regarder partir, d’abord doucement, puis tout de suite noyé de ténèbres, envolé à jamais en haut de ce trou noir. Et il demeurait le cou allongé, sa mémoire vacillante de bête se souvenait peut-être des choses de la terre. Mais c’était fini, le camarade ne verrait plus rien, lui-même serait ainsi ficelé en un paquet pitoyable, le jour où il remonterait par là. Ses pattes se mirent à trembler, le grand air qui venait des campagnes lointaines l’étouffait ; et il était comme ivre, quand il rentra pesamment à l’écurie.
Cheval, fin, p. 562 :
Alors, Étienne et Catherine, comme il arrivait près d’eux, l’aperçurent qui s’étranglait entre les roches. Il avait buté, il s’était cassé les deux jambes de devant. D’un dernier effort, il se traîna quelques mètres ; mais ses flans ne passaient plus, il restait enveloppé, garrotté par la terre. Et sa tête saignante s’allongea, chercha encore une fente, de ses gros yeux troubles. L’eau le recouvrait rapidement, il se mit à hennir, du râle prolongé, atroce, dont les autres chevaux étaient morts déjà, dans l’écurie. Ce fut une agonie effroyable, cette vieille bête, fracassée, immobilisée, se débattant à cette profondeur, loin du jour. Son cri de détresse ne cessait pas, le flot noyait sa crinière, qu’il le poussait plus rauque, de sa bouche tendue et grande ouverte. Il y eut un dernier ronflement, le bruit sourd d’un tonneau qui s’emplit. Puis un grand silence tomba.
2 commentaires sur « Ramasse tes lettres : Germinal, de Zola »