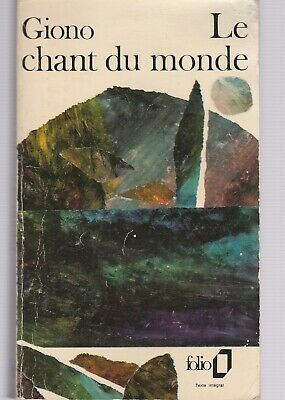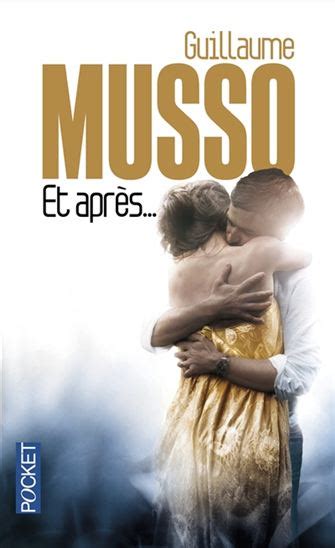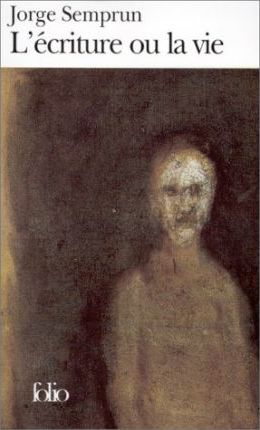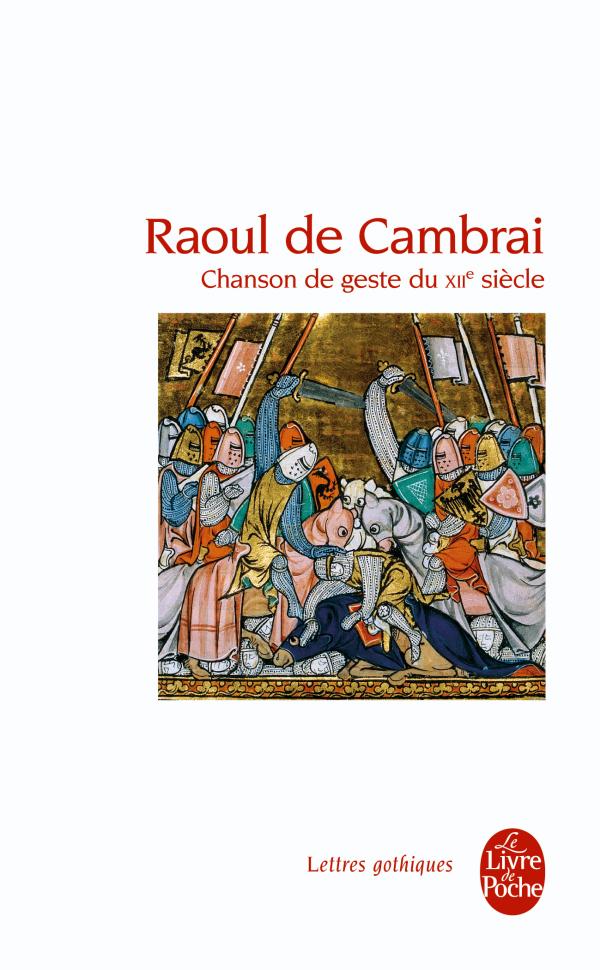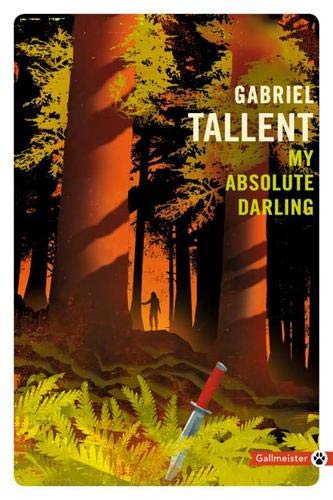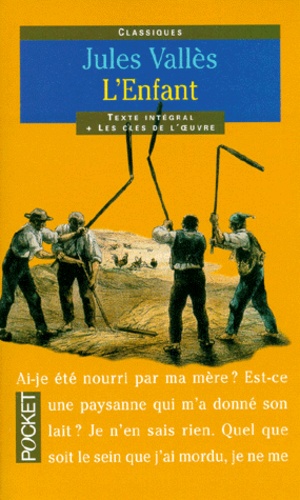
Faire exploser le corset idéologique de l’éducation bourgeoise
Vallès (Jules) 1878, L’Enfant, Pocket, 1998
Résumé
Le petit Jacques Vingtras a bien de la chance, ses parents se sont extraits de la condition paysanne. Le père est enseignant à Puy-en-Velay, Saint-Étienne, puis Nantes et espère que son fils aille loin également dans son parcours universitaire. Sa mère a aussi ses idées sur la bonne éducation et veut que son fils acquiert les bonnes manières, elle l’habille avec soin et l’empêche d’aller jouer et faire des bêtises avec les autres enfants. Le principe étant de ne jamais le gâter et de corriger chaque écart.
Jacques s’ennuie terriblement à l’école, d’autant qu’il n’est pas apprécié de ses camarades en tant que fils d’enseignant. Il regarde avec envie la joie simple de son oncle compagnon du devoir, et les paysans qui travaillent dans les champs, le vin et les rires qui viennent des échoppes. Un jour qu’il est en retenue, il découvre un Robinson Crusoé caché dans un casier…
Premier tome de la trilogie autobiographique Mémoires d’un révolté :
1. L’Enfant (1878)
2. Le Bachelier (1881)
3. L’Insurgé (1886)
Commentaires
Reprise-réécriture de son roman autobiographique Testament d’un blagueur paru en feuilletons en 69-70, Jules Vallès prend encore plus de distance avec lui-même en temps que sujet (il utilisait déjà un procédé littéraire pour attribuer les propos et la vie racontée à un autre), se raconte désormais par le biais de l’auto-fiction (sans toutefois cacher qu’il s’agit d’une autobiographie). Jacques est un alter-égo qui a une vie semblable, les mêmes initiales, mais nullement superposable. À la manière de ce que feront Proust et Céline, Vallès prend ses libertés avec l’exactitude des souvenirs et de la chronologie… L’important est de rendre la charge émotionnelle, d’un passé déformé tel que le voit l’adulte, d’en faire ressentir la pesanteur par le lecteur. Il ne s’agit pas de réinterpréter le passé en lui donnant un sens prémonitoire expliquant le présent (comme Sartre dans Les Mots qui se voit écrivain dans son berceau), mais de donner une forme à ce passé, vrai ou non, une forme et une puissance à la hauteur de ce qu’il représente pour la personne qui l’a vécu, ou subit…Pour ce faire, c’est dans l’écriture même, dans le style, plus que dans les faits racontés, que se situe l’émotion. L’écriture, plutôt réaliste en apparence et intégrant un parler-peuple à la manière de Zola (L’Assommoir obtient un grand succès deux ans plus tôt), tient plutôt du symbolisme car ce parler-peuple contamine la voix et la narration, et la voix néglige la structure académique de la langue pour suivre une sorte de folie personnelle, l’emportement de la pensée, procédé typique du symbolisme décrit notamment par Rémy de Gourmont dans L’Idéalisme en 1893. C’est dans la gradation hyperbolique (énumération de plus en plus incroyable) que cet aspect est le plus flagrant. Vallès trouve et procure un réel plaisir de la succession rapides de mots évocateurs et exagérés qui rappelle inévitablement le style de Céline à partir de Mort à crédit. La proximité entre les deux est d’ailleurs évidente. Dans le style entremêlant finement tournures classiques de l’écrit et parler-peuple pour donner cet effet de langue orale. Si Céline prendra le contre-pied politique de Vallès, son Ferdinand enfant toujours maltraité qu’on trimbale à droite à gauche, avec sa merde qui lui colle aux fesses, est une évidente reprise de Jacques Vingtras, tout comme ce narrateur mi-naïf mi-malin qui entremêle voix de l’enfant vivant les choses et celle cachée de l’adulte qui les commente. Comme si l’adulte racontant jouait à l’enfant (à la manière de Gosciny dans Le Petit Nicolas par exemple), imitait sa voix, sa bêtise, sa naïveté, la parodiait, pour mieux faire ressortir les incohérences du monde des adultes, les injustices. En cela, l’écriture de Vallès agit un peu à la manière de l’ironie socratique (analysée dans L’Ironie, de Jankélévitch), qui fait mine d’adopter un discours, une position, le pousse jusqu’à sa radicalité pour en voir éclater les contradictions. Car le discours de l’enfant est traversé des discours des adultes, parents et professeurs. Les jouer à outrance, c’est les montrer dans ce qu’ils ont de pervers.
La déformation du passé permet aussi de l’essentialiser, de lui donner une portée symbolique et idéologique. Alors qu’il n’y a pas ou peu d’argumentation. C’est le discours de l’émotion, du ressenti qui prime et qui agit dans l’imaginaire et dans la représentation du lecteur. Le corps maltraité de Jacques Vingtras, la fantaisie empêchée, les envies toujours frustrées, l’injustice… c’est cela qui reste dans l’esprit du lecteur là où une dissertation aurait immédiatement fait face à la résistance idéologique. Pour cela, le pathos de l’enfant malheureux est traité avec beaucoup de dérision. Et la voix de l’adulte – le Jules Vallès, justement – est dissimulée tant que possible, fondue dans ce personnage imaginaire de la mémoire, cette voix de l’enfant reconstruite, ce Jacques Vingtras. Le lecteur n’a pas besoin d’argumentation, il tire lui-même les conséquences de ce qui arrive au personnage. Ce procédé de rhétorique, de proposer au regard du lecteur un personnage pathétique, victime, pleine d’autodérision, et sa voix conviviale, populaire, proche, sera bien-sûr le ressort le plus flagrant des romans de Céline et de leur charge idéologique – souvent indirecte.
Le roman propose évidemment une critique radicale de l’éducation « à la dure », par la punition, par la privation, par la rigidité, par l’imitation des adultes… Un type d’éducation (déjà démonté par Locke dans ses Pensées sur l’éducation) qui ne cesse de revenir encore et encore jusqu’au XXIe siècle à la bouche et à l’idée des maîtres, parents, dirigeants, comme solution ultime, malgré les recherches et les témoignages, malgré les avancées des pédagogies progressistes et alternatives : l’importance absolue de la discipline dans l’éducation outrepasse et rend caduques les questions de motivation, d’adaptation des contenus, de relation humaine de confiance et d’émulation, de construction collective… Ce principe éducatif, totalement illustré par le roman, est non seulement violent pour le corps, mais aussi abrutissant pour l’esprit. L’enfant doit se taire, obéir et se conformer à un modèle préconçu. C’est un mode d’éducation qui rend impossible toute découverte et expérimentation personnelle du monde ; éducation plutôt fascisante puisqu’il s’agit de diriger la conscience. L’enfant doit adopter les jugements sur les choses, tels qu’ils sont prononcés par les adultes. Ainsi, les opinions négatives des parents – celles d’une société bourgeoise hiérarchisée – sur les paysans, artisans et ouvriers, oeuvrant de leurs mains, leur langage, leurs manières d’être, leur rire et leurs fêtes, leurs danses et leurs valeurs collectives, leur peau bronzée… ces jugements idéologiques sont transmis par l’éducation (Jacques doit ainsi reprendre les critères esthétiques de ses maîtres et de la tradition académique dans ses thèmes). Le caractère fondamentalement idéologique de l’éducation est encore au coeur de l’Éducation nationale du XXIe siècle et révèle toujours ce manque total de confiance en la jeunesse, en sa faculté de déterminer ce qui est bon, cette peur de les voir aller à l’encontre des principes des parents, de choisir un nouveau modèle de société. Le rejet de la carrière de professeur, la volonté de retourner au peuple, marque la rupture entre Jacques et son père, et le rejet de l’idéologie bourgeoise. Et cette idéologie, et le mode de vie correspondant, rend également malheureux les parents qui ont gagné en fierté, mais qui en réalité vivent dans un inconfort certain, n’obtenant pas le respect social, ni la richesse aristocratique, forcés de se conformer, d’obéir à un directeur dictateur, de porter un costume emprisonnant les mouvements du corps, de se couper des voisins… C’est cette illusion bourgeoise de l’ascension sociale par l’éducation que dénonce finalement tout le roman, ascenseur social qui n’a jamais amené ses passagers qu’à des étages illusoires mais qu’on fantasme encore de nos jours. C’est ce caractère idéologique de l’éducation qui va à l’encontre d’une pédagogie libertaire, anarchiste et alternative, et rend impossible l’avènement d’une société basée sur des principes d’entraide, d’égalité, de travail collectif… Ce roman est bien la première pierre d’une rééducation idéologique, d’une renaissance de la révolte étouffée de la Commune.
Dans l’écriture, Vallès apparaît en précurseur du symbolisme, mais plus proche des Lettres du voyant de Rimbaud (écrites pendant la Commune) que de l’écriture artiste de Huysmans. Les formules rimbaldiennes de « Je est un autre », « j’assiste à l’éclosion de ma pensée », « La première étude de l’homme qui veut se faire poète est sa propre connaissance, entière ; il cherche son âme, il l’inspecte, il la tente, il l’apprend. Dès qu’il la sait, il doit la cultiver. » ont une étrange résonance à la lecture de L’Enfant qui semble un début d’application de cet art poétique. Si Vallès n’avait évidemment pas connaissance de cette lettre publiée bien plus tard, on sait aussi que le gamin poétique tenta de contacter Vallès à l’époque la Commune, qui empêche qu’il lui tint à peu près ce langage ?… De plus, le gamin fugueur, giflé par sa mère, révolté admirant la Commune, les travailleurs, et rejetant l’académisme, la bien-pensance, l’éducation rigide et conformante, fuyant la littérature pour aller vers la vie concrète, a tout d’un cousin du petit Jacques Vingtras.
Passages retenus
Naissance du désir de la chair, p. 42
Il y a aussi ma cousine Apollonie ; on l’appelle la Polonie.
C’est comme ça qu’ils ont baptisé leur fille, ces paysans !
Chère cousine ! Grande et lente, avec des yeux bleu de pervenche, de longs cheveux châtains, des épaules de neige ; un cou frais, que coupe de sa noirceur luisante un velours tenant une croix d’or ; le sourire tendre et la voix traînante, devenant rose dès qu’elle rit, rouge dès qu’on la fixe. Je la dévore des yeux quand elle s’habille – je ne sais pas pourquoi – je me sens tout chose en la regardant retenir avec ses dents et relever sur son épaule ronde sa chemise qui dégringole, les jours où elle couche dans notre petite chambre, pour être au marché la première, avec ses blocs de beurre fermes et blancs comme les moules de chair qu’elle a sur sa poitrine. On s’arrache le beurre de la Polonie.
Elle vient quelques fois m’agacer le cou, me menacer les côtes de ses doigts longs. Elle rit, me caresse et m’embrasse ; je la serre en me défendant, et je l’ai mordue une fois ; je ne voulais pas la mordre, mais je ne pouvais pas m’empêcher de serrer les dents, comme sa chair avait une odeur de framboise… Elle m’a crié : Petit méchant ! En me donnant une tape sur la joue, un peu fort ; j’ai cru que j’allais m’évanouir et j’ai soupiré en lui répondant ; je me sentais la poitrine serrée et l’oeil plus doux.
Elle m’a quitté pour se rejeter dans son lit, en me disant qu’elle avait attraper froid. Elle ressemble par derrière au poulain blanc que monte le petit du préfet.
J’ai pensé à elle tout le temps, en faisant mes thèmes.
Le respect du pain, p. 53 :
J’ai le respect du pain.
Un jour je jetais une croûte, mon père est allé la ramasser. Il ne m’a pas parlé durement comme il le fait toujours.
« Mon enfant, m’a-t-il dit, il ne faut pas jeter le pain, c’est dur à gagner. Nous n’en avons pas trop pour nous, mais si nous en avions trop, il faudrait le donner aux pauvres. Tu en manqueras peut-être un jour, et tu verras ce qu’il vaut. Rappelle-toi ce que je te dis là, mon enfant ! »
Je ne l’ai jamais oublié.
Cette observation, qui, pour la première fois peut-être dans ma vie de jeunesse, me fut faite sans colère, mais avec dignité, me pénétra jusqu’au fond de l’âme ; et j’ai eu le respect du pain depuis lors.
Les moissons m’ont été sacrées, je n’ai jamais écrasé une gerbe, pour aller cueillir un coquelicot ou un bleuet ; jamais je n’ai tué sur sa tige la fleur du pain !
Ce qu’il me dit des pauvres me saisit aussi et je dois peut-être à ces paroles, prononcées simplement ce jour-là, d’avoir toujours eu le respect, et toujours pris la défense de ceux qui ont faim.
« Tu verras ce qu’il vaut. »
Je l’ai vu.
Paysans et professeurs, p. 76 :
Mais les grands domestiques aussi sont plus heureux que mon père !
Ils n’ont pas besoin de porter des gilets boutonnés jusqu’en haut pour couvrir une chemise de trois jours ! Ils n’ont pas peur de mon oncle Jean comme mon père a peur du proviseur ; ils ne se cachent pas pour rire et pour boire un verre de vin, quand ils ont des sous ; ils chantent de bon coeur, à pleine voix, dans les champs, quand ils travaillent ; le dimanche, ils font tapage à l’auberge.
Ils ont, au derrière de leur culotte, une pièce qui a l’air d’un emplâtre : verte, jaune ; mais c’est la couleur de la terre, la couleur des feuilles, des branches et des choux.
Mon père, qui n’est pas domestique, ménage, avec des frissonnements qui font mal, un pantalon de casimir noir, qui a avalé déjà dix écheveaux de fil, tué vingt aiguilles, mais qui reste grêlé, fragile et mou !
À peine il peut se baisser, à peine pourra-t-il saluer demain…
S’il ne salue pas, celui-ci…, celui-là… (il y a à donner des coups de chapeau à tout le monde, au proviseur, au censeur, etc.), s’il ne salue pas en faisant des grâces, dont le derrière du pantalon ne veut pas, mais alors on l’appelle chez le proviseur !
Et il faudra s’expliquer ! – pas comme un domestique, – non ! – comme un professeur. Il faudra demander pardon.
On en parle, on en rit, les élèves se moquent, les collègues aussi. On lui paie ses gages (ma mère nomme ça les « appointements ») et on l’envoie en disgrâce quelque part faire mieux raccommoder ses culottes, avec sa femme, qui a toujours l’horreur des paysans ; avec son fils… qui les aime encore…
Le plaisir des jouets et des gourmandises, p. 82 :
« Rien qu’aujourd’hui, maman, laisse-moi jouer avec, j’irai dans la cour, tu ne m’entendras pas ! Rien qu’aujourd’hui, jusqu’à ce soir, et demain je serai bien sage !
– J’espère que tu seras bien sage demain ; si tu n’es pas sage, je te fouetterai. Donnez donc de jolies choses à ce saligaud, pour qu’il les abîme. »
Ces points vifs, ces tâches de couleur joyeuse, ces bruits de jouets, ces trompettes d’un sou, ces bonbons à corset de dentelle, ces pralines comme des nez d’ivrognes, ces tons crus et ces goûts fins, ce soldat qui coule, ce sucre qui fond, ces gloutonneries de l’oeil, ces gourmandises de la langue, ces odeurs de colle, ces parfums de vanille, ce libertinage du nez et cette audace du tympan, ce brin de folie, ce petit coup de fièvre, ah ! Comme c’est bon, une fois l’an ! – Quel malheur que ma mère ne soit pas sourde !
Ce qui me fait mal, c’est que tous les autres sont si contents ! Par le coin de la fenêtre, je vois dans la maison voisine, chez les gens d’en face, des tambours crevés, des chevaux qui n’ont qu’une jambe, des polichinelles cassés ! Puis ils sucent, tous, leurs doigts ; on les a laissés casser leurs jouets et ils ont dévorés leurs bonbons.
Et quel boucan ils font !
Je me suis mis à pleurer.
C’est qu’il m’est égal de regarder des jouets, si je n’ai pas le droit de les prendre et d’en faire ce que je veux ; de les découdre et de les casser, de souffler dedans et de marcher dessus, si ça m’amuse…
Je ne les aime que s’ils sont à moi et je ne les aime pas s’ils sont à ma mère. C’est parce qu’ils font du bruit et qu’ils agacent les oreilles qu’ils me plaisent ; si on les pose sur la table comme des têtes de mort, je n’en veux pas. Les bonbons, je m’en moque, si on m’en donne un par an comme une exemption, quand j’aurai été sage. Je les aime quand j’en ai trop.
« Tu as un coup de marteau, mon garçon ! » m’a dit ma mère un jour que je lui contais cela, et elle m’a cependant donné une praline.