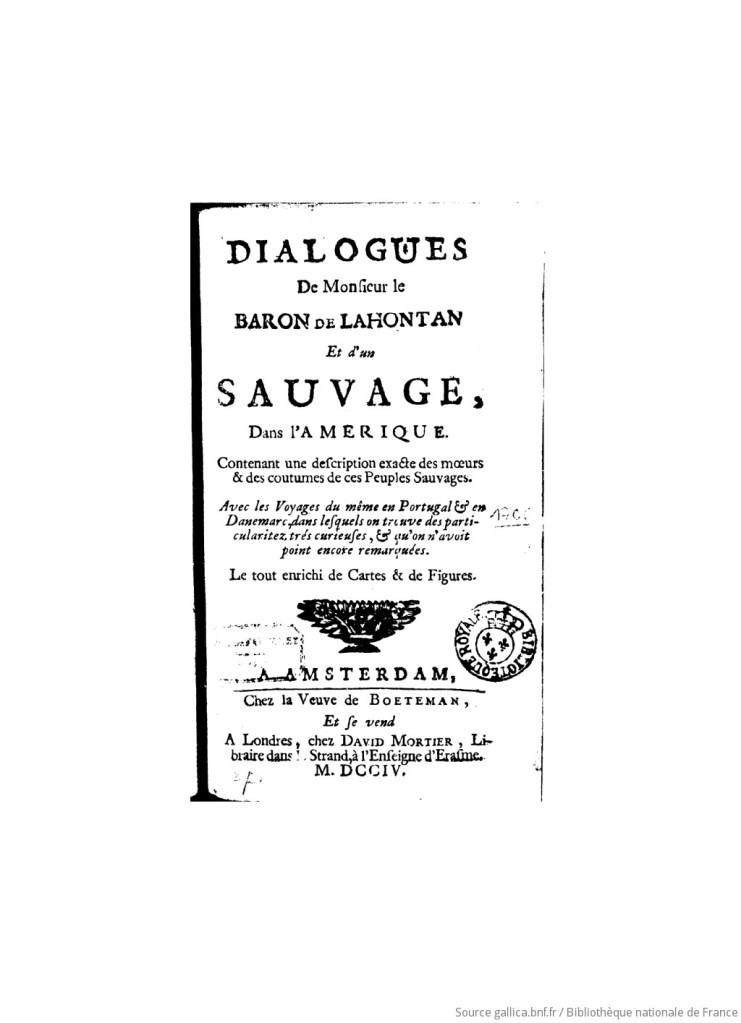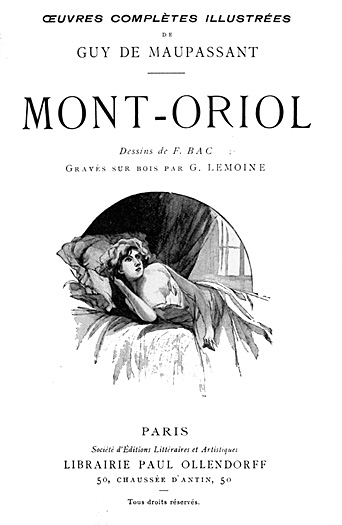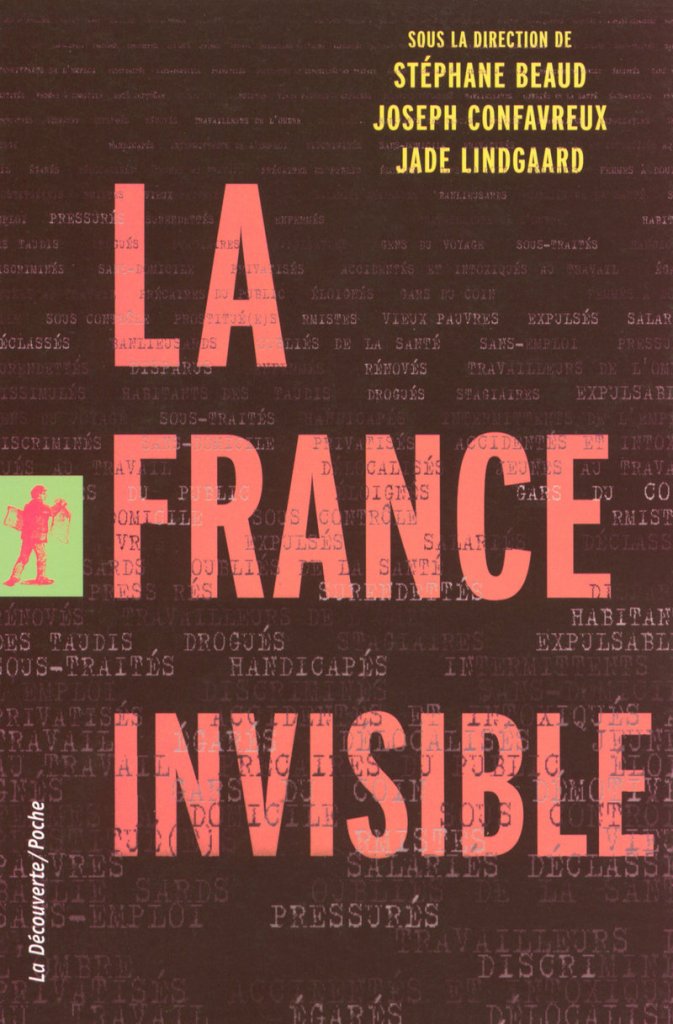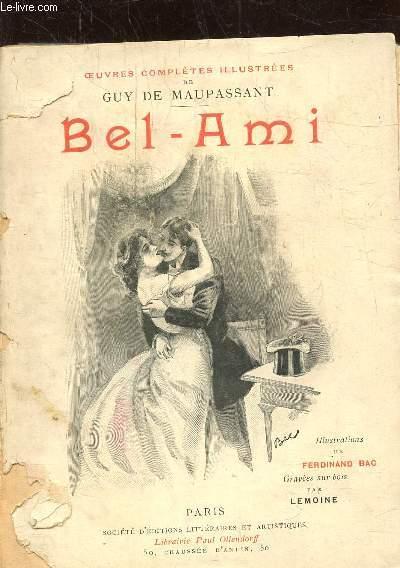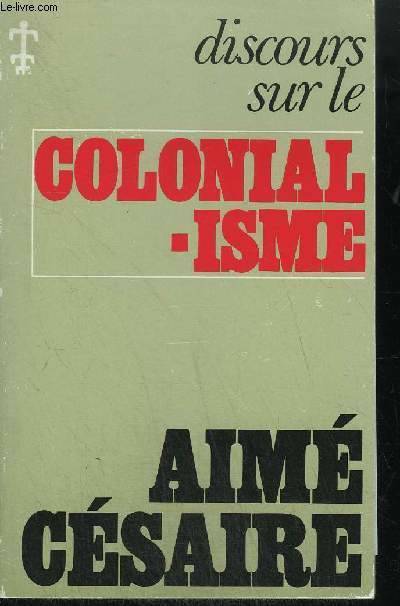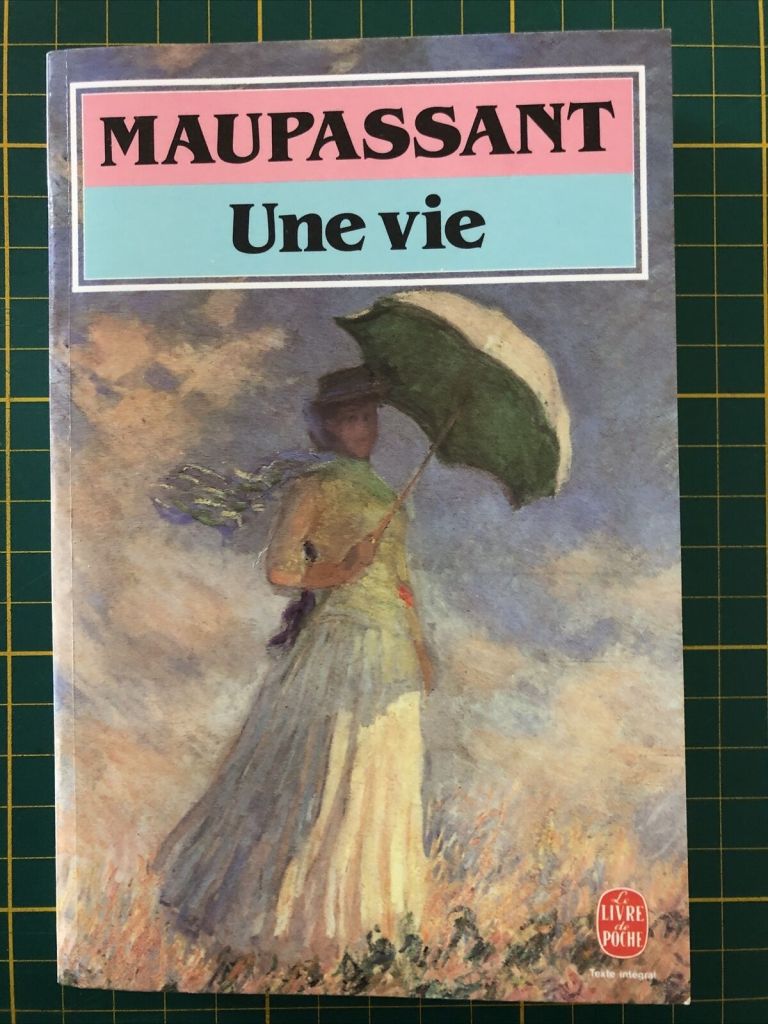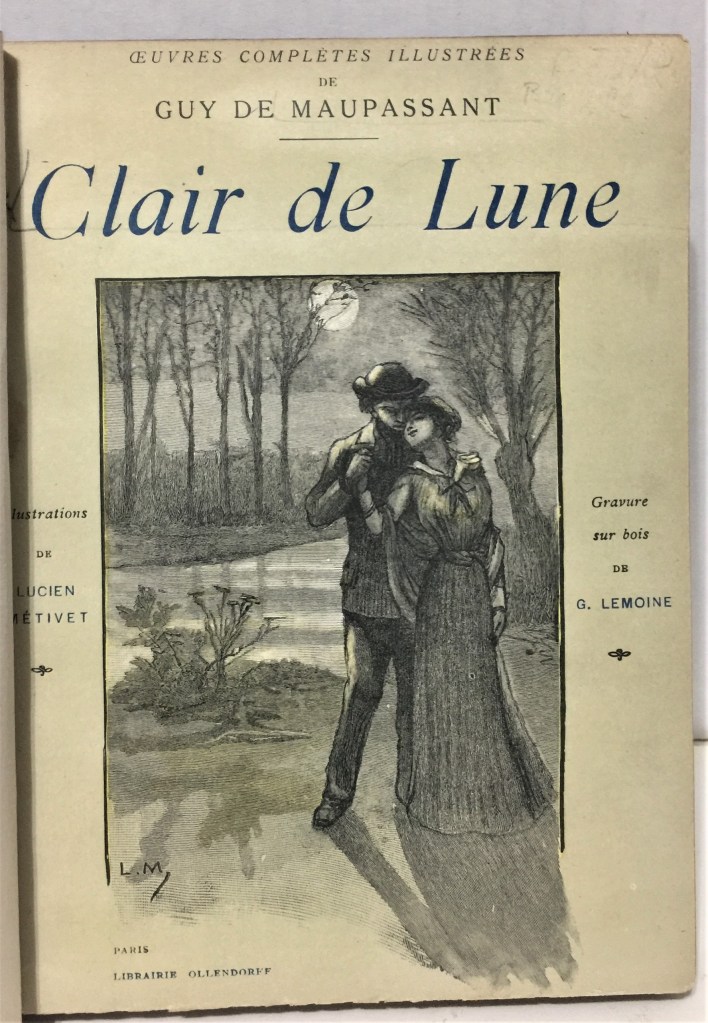
C’est à la lumière faible de la Lune, qu’on distingue quelques traits de la vraie nature humaine, ses grandeurs secrètes et son vide vertigineux…
Maupassant (Guy de) 1882-1883, 1988 (1883, 1988), Clair de lune, in [Oeuvres complètes, t. 1 & 2], Gallimard, coll. « nrf La Pléiade », 1974 & 1979
Recueils :
– Boule de Suif (nouvelle : 1880 ; recueil : 1899)
– La Maison Tellier (1881)
– Mademoiselle Fifi (1882)
– Contes de la bécasse (1883)
– Clair de Lune (1883)
– Miss Harriet (1884)
– Les Sœurs Rondoli (1884)
– Yvette (1884)
– Contes du jour et de la nuit (1885)
– Monsieur Parent (1886)
– Toine (1886)
– La Petite Roque (1886)
– Le Horla (1887)
– Le Rosier de madame Husson (1888)
– La Main gauche (1889)
– Le Père Milon (1889)
Sommaire
– Clair de lune (« Il portait bien son nom de bataille, l’abbé Marignan… ») (1882) ****
– Un coup d’État (1883) *** *
– Le Loup (1882) *** *
– L’Enfant (« Après avoir longtemps juré qu’il ne se marierait jamais… ») (1882) ***
– Conte de Noël (1882) *** *
– La Reine Hortense (1883) *****
– Le Pardon (1882) *** *
– La Légende du Mont Saint-Michel (1882) *** *
– Une veuve (1882) ****
– Mademoiselle Cocotte (1883) ***
– Les Bijoux (1883) *****
– Apparition (1883) ***
ajouté ultérieurement au recueil :
– La Porte (1887) ***
– Le Père (« Jean de Valnoix est un ami que je vais voir de temps en temps. ») (1887) ***
– Moiron (1887) ***
– Nos lettres (1888) ***
– La Nuit (Cauchemar) (1887) *****
Clair de lune (« Il portait bien son nom de bataille, l’abbé Marignan… ») ****
L’abbé Marignan est un serviteur sincère et rigoureux de Dieu. La femme lui est répugnante, avec ses yeux tendres, son corps appelant toujours à la débauche charnelle. Il a une petite nièce agitée et pleine d’énergie. Il apprend qu’elle voit chaque soir son amoureux…
Personnage aux convictions semblables au religieux de Une vie (réticent, aigri, devant toute vie sensuelle), dont les convictions vont être démontées, mais personnage finalement vu de manière positive : le sens de l’humanité dépasse des conventions morales basées sur une théologie abusive ; et ce sont ses propres réflexions devant la vie qui détruisent ses convictions rigoristes. En cela, l’abbé est similaire à celui du Baptême. Exemple même d’un conte à idée (développant et illustrant une théorie) ; on retrouve une vie débordante dans chaque personnage (chacun semble avoir une vie au-delà des limites du récit, comme chez Zola, comme si l’auteur avait écrit sur eux toute une fiche perso).
p. 598 : « Pourquoi Dieu avait-il fait cela ? Puisque la nuit est destinée au sommeil, à l’inconscience, au repos, à l’oubli de tout, pourquoi la rendre plus charmante que le jour, plus douce que les aurores et les soirs, et pourquoi cet astre lent et séduisant, plus poétique que le soleil et qui semble destiné, tant il est discret, à éclairer des choses trop délicates et mystérieuses pour la grande lumière, s’en venait-il faire si transparentes les ténèbres ?
Pourquoi le plus habile des oiseaux chanteurs ne se reposait-il pas comme les autres et se mettait-il à vocaliser dans l’ombre troublante ?
Pourquoi ce demi-voile jeté sur le monde ? Pourquoi ces frissons de cœur, cette émotion de l’âme, cet alanguissement de la chair ?
Pourquoi ce déploiement de séductions que les hommes ne voyaient point, puisqu’ils étaient couchés en leurs lits ? A qui étaient destinés ce spectacle sublime, cette abondance de poésie jetée du ciel sur la terre ? »
Un coup d’État *** *
L’Empereur est pris par les Prussiens. La république est proclamée. Dans le petit bourg de Canneville, le docteur Massarel s’apprête à prendre le poste de maire à la place de M. le vicomte de Varnetot.
Vision microscopique d’une révolution, à l’échelle d’un bourg de Normandie, ce conte montre le ridicule des conflits pour la province, le peu d’importance de l’idéologie pour les campagnes. Si l’on peut voir les paysans comme des rustres dépassés par la vie politique, Maupassant s’appuie au contraire sur leur terre à terre pour montrer la vanité des notables citadins qui se croient importants dans leurs batailles d’idées qui ne bouleversent pas le monde, comme des conversations de dîner en ville, anecdotiques, face au rythme des saisons et récoltes.
p. 1005 : « Le 5 septembre au matin, le docteur en uniforme, son revolver sur sa table, donnait une consultation à un vieux couple de campagnards, dont l’un, le mari, atteint de varices depuis sept ans, avait attendu que sa femme en eût aussi pour venir trouver le médecin, quand le facteur apporta le journal.
M. Massarel l’ouvrit, pâlit, se dressa brusquement, et, levant les bras au ciel dans un geste d’exaltation, il se mit à vociférer de toute sa voix devant les deux ruraux affolés : « Vive la République ! vive la République ! vive la République ! » »
Le Loup *** *
Les ancêtres du marquis d’Arville étaient des chasseurs acharnés. Un jour qu’ils chassaient un loup blanc qui effrayait la région, le père de son trisaïeul heurta une grosse branche.
Incident de chasse grossier, transformé en véritable aventure épique et mystérieuse. La virilité violente de la chasse, son horreur, son adrénaline, sont tracés d’une main de connaisseur.
p. 629 : « Puis, il se jeta sur le monstre. Il se sentait fort à culbuter une montagne, à broyer des pierres dans ses mains. La bête le voulut mordre, cherchant à lui fouiller le ventre ; mais il l’avait saisie par le cou, sans même se servir de son arme, et il l’étranglait doucement, écoutant s’arrêter les souffles de sa gorge et les battements de son cœur. Et il riait, jouissant éperdument, serrant de plus en plus sa formidable étreinte, criant, dans un délire de joie : « Regarde, Jean, regarde ! » Toute résistance cessa ; le corps du loup devient flasque. Il était mort. »
L’Enfant (« Après avoir longtemps juré qu’il ne se marierait jamais… ») *** *
Jacques Bourdillère, grand coureur de jupons, tombe amoureux et décide de se marier, mais le soir des noces, reçoit un courrier de son ancienne amante.
Court récit sans la moindre analyse, sans réelle conclusion, sans avis de l’auteur. Quelles sont les leçons à tirer ? que le passé rattrape le viveur ? que le viveur a tué son amante ? l’a remplacé par un enfant ? que sa sincérité a finalement arrangé ses affaires ? Comment se fait-il que l’enfant soit accepté si simplement ?
Cet aspect quasi incomplet de la nouvelle n’est pas à critiquer, c’est au contraire le fonctionnement typique du genre, reposant sur l’implicite : le récit court tait volontairement une partie importante de ce qu’il pourrait développer, demandant ainsi la participation active du lecteur qui cherche des réponses et complète donc le récit par son imagination. Un fonctionnement qu’Umberto Eco détaille et généralise dans son essai L’Oeuvre ouverte.
p. 483 : « Un matin, comme il était étendu sur le sable, tout occupé à regarder les femmes sortir de l’eau, un petit pied l’avait frappé par sa gentillesse et sa mignardise. Ayant levé les yeux plus haut, toute la personne le séduisit. De toute cette personne, il ne voyait d’ailleurs que les chevilles et la tête émergeant d’un peignoir de flanelle blanche, clos avec soin. On le disait sensuel et viveur. C’est donc par la seul grâce de la forme qu’il fut capté d’abord ; puis il fut retenu par le charme d’un doux esprit de jeune fille, simple et bon, frais comme les joues et les lèvres. »
Conte de Noël *** *
La femme du forgeron a mangé un œuf que son mari a trouvé sur la route enneigée. Elle en est devenue folle. On fait appel au père Vatinel pour une dépossession.
Le récit d’un miracle de noël, incroyable, est malignement délégué à un médecin, homme digne de foi, raisonnable. Atmosphère, neige et contexte de noël sont idéals pour cette aventure bizarre qui ne trouve aucune explication, hormis la scène d’hypnose du Père. Ce genre d’expérience (l’hypnose, qu’on retrouvera dans Le Horla), à la mode, aurait donc des vertus remarquables ?
p. 690 : « La plaine, les haies, les ormes des clôtures, tout semblait mort, tué par le froid. Ni hommes ni bêtes ne sortaient plus : seules les cheminées des chaumières en chemise blanche révélaient la vie cachée, par les minces filets de fumée qui montaient droit dans l’air glacial.
De temps en temps, on entendait craquer les arbres, comme si leurs membres de bois se fussent brisés sous l’écorce ; et parfois, une grosse branche se détachait et tombait, l’invincible gelée pétrifiant la sève et cassant les fibres. »
La Reine Hortense *****
Vieille fille aigrie qui abrite une flopée d’animaux de toute sorte, La « Reine Hortense » perd la tête et va bientôt trépasser. Sa famille est appelée pour la veiller. Dans ses fièvres, elle parle à des enfants qu’elle n’a jamais eus.
Reprenant le thème de la vieille fille sans amour (notamment en arrière-plan dans Une vie), Maupassant y mêle le thème obsédant de la veillée funèbre (la cruauté des proches dont on avait déjà été témoin dans En famille). L’idée de ce rêve ante mortem qui réalise ce que l’inconscient désire est d’un magnifique romantisme et reste touchant et scientifique (C.G. Jung établit sa théorie des rêves sur ce principe que les rêves compenseraient le vécu). Sinon, le personnage de vieille fille se révèle à l’aube de sa mort, montrant toute sa bienveillance à l’égard des enfants, de ceux qu’elle aurait voulus, de ceux qu’elle a, ses animaux.
p. 806 : « On entendait à côté la voix de l’agonisante, vivant, à cette heure dernière, la vie qu’elle avait attendue sans doute, vivant ses rêves eux-mêmes au moment où tout allait finir pour elle. »
Le Pardon *** *
Une femme naïve est mariée à un homme qui la trompe. Lorsqu’une lettre anonyme le dénonce, celui-ci présente son amante (en tant que grande amie) à sa femme.
Le tableau de cette femme naïve à l’extrême est sans appel, d’une dureté absolue à l’égard de celle-ci, victime consentante, élevée pour ne jamais comprendre ce qui se trame autour d’elle (prolongeant encore ce thème de la condition féminine tragique de Une vie). C’est la thèse de Sade qu’on retrouve ici : une éducation douce et timorée, laissant les enfants avec leurs illusions, ne fait que provoquer leur souffrance et leur incompétence à vivre.
p. 583 : « Les enfants ne se doutent de rien, et ils arrivent à l’âge de vivre à leur tour, avec un bandeau sur les yeux et sur l’esprit, sans soupçonner les dessous de l’existence, sans savoir qu’on ne pense pas comme on parle, et qu’on ne parle pas comme on agit ; sans savoir qu’il faut vivre en guerre avec tout le monde, ou du moins en paix armée, sans deviner qu’on est sans cesse trompé quand on est naïf, joué quand on est sincère, maltraité quand on est bon. »
La Légende du mont Saint-Michel *** *
Récit par un Bas-Normand, des ruses par lesquelles saint Michel chassât Satan de la région.
Cette amusante légende est imprégnée de l’humour normand. Le Bas-Normand a construit son imaginaire chrétien en le mêlant à son folklore. La ruse des récoltes en terre / sous terre se marie bien avec le thème biblique. Le festin, l’incident corporel (avec éjection du sommet de la tour) et le coup de pied au cul, sont les ornements fantasmés de cette légende.
p. 679 : « Un sceptique de génie a dit : « Dieu a fait l’homme à son image, mais l’homme le lui a bien rendu. »
Ce mot est d’une éternelle vérité et il serait fort curieux de faire dans chaque continent l’histoire de la divinité locale, ainsi que l’histoire des saints patrons dans chacune de nos provinces. Le nègre a des idoles féroces, mangeuses d’hommes ; le mahométan polygame peuple son paradis de femmes ; les Grecs, en gens pratiques, avaient divinisé toutes les passions. »
Une veuve ****
Une vieille fille, qui garde au doigt une bague faite de cheveux blonds, raconte comment elle se considère comme fiancée-veuve d’un garçon de douze ans, suicidé d’amour pour elle.
Pourtant sans surprise, cette petite histoire s’avère fort touchante, peut-être par l’âge de son héros. Cette famille des Santèze, sentimentale à l’excès, s’éteint d’elle-même, carbonisée par sa trop grande idéalisation de l’amour, comme une allégorie de la disparition du Romantisme, autodétruit par sa sensiblerie inapte à la survie.
Ce conte montre la fragilité d’une trop grande finesse.
p. 534 : « Oh ! c’était une race singulière, des fous, si l’on veut, mais des fous charmants, des fous par amour. Tous, de père en fils, avaient des passions violentes, de grands élans de tout leur être qui les poussaient aux choses les plus exaltées, aux dévouements fanatiques, même aux crimes. C’était en eux, cela, ainsi que la dévotion ardente est dans certaines âmes. Ceux qui se font trappistes n’ont pas la même nature que les coureurs de salon. On disait dans la parenté : « Amoureux comme un Santèze. » Rien qu’à les voir, on le devinait. Ils avaient tous les cheveux bouclés, bas sur le front, la barbe frisée, et des yeux larges, larges, dont le rayon entrait dans vous, et vous troublait sans qu’on sût pourquoi. »
Mademoiselle Cocotte ***
Le cocher François recueille une pauvre chienne misérable mais très attachante. Il la baptise Cocotte car elle attire tous les chiens du quartier, ce que le maître de François ne peut accepter.
Reprise de L’Histoire d’un chien presque dans les mêmes termes mais le cadre narratif change : ici il est question du récit de l’histoire d’un homme devenu fou par amour pour son chien.
Or, cette surbrillance du cadre et ce titre comique étouffent le sujet et finissent par rendre presque comique une fin qui tirait presque les larmes.
L’exagération, le final gore et amoral affaiblit un peu l’idée maîtresse de l’amour pour les animaux. L’assimilation animal-amante est trop grossière pour être poétique.
Néanmoins, cette histoire reste touchante.
p. 763 : « La chienne morte avait retrouvé son maître à soixante lieues de leur maison ! »
Les Bijoux *****
M. Lantin, commis principal au ministère de l’intérieur, est marié à une ravissante jeune femme, économe, douce, qui a pour seuls défauts d’aimer aller souvent au théâtre et d’apprécier le brillant des bijoux faux. Il est atrocement triste lorsque sa petite femme est emportée par la maladie. Il a maintenant du mal à vivre de son petit salaire de fonctionnaire. Il va alors pour vendre la quincaillerie de sa femme tant regrettée…
Ce conte raconté uniquement du point de vue du fonctionnaire Lantin, fait passer toute une partie de l’histoire dans le non-dit. À aucun moment le narrateur n’explique ce qui s’est passé, il se contente de suggérer (au lecteur de compléter l’intrigue dans son imaginaire, principe de L’Oeuvre ouverte selon Umberto Eco). Il se pose d’abord une question de morale, sur le caractère féminin, si enclin à mener une double vie. Il met en évidence l’idiotie, la naïveté extrême du bonhomme, bourgeois aveugle, bonne dupe.
Enfin, ce conte amène une nouvelle problématique par la conclusion du second mariage : vaut-il mieux vivre heureux, aveugle et amoureux d’une femme qui vous trompe que malheureux et attaché à une femme honnête et fidèle ? Ainsi, on passe de ce qui pourrait être un portrait à charge, cliché, de la femme trompeuse, à un éloge de celle qui sais combiner et arranger à la perfection les différents aspects de sa vie, préserver le secret là où il doit l’être, mais tout en limitant sa place, en acceptant l’homme avec qui elle vit tel qu’il veut être… Savoir-faire proche de celui du nouvelliste…
p. 765 : « Quelquefois, le soir, quand ils demeuraient en tête à tête au coin du feu, elle apportait sur la table où ils prenaient le thé la boîte de maroquin où elle enfermait la « pacotille », selon le mot de M. Lantin ; et elle se mettait à examinait ces bijoux imités avec une attention passionnée, comme si elle eût savouré quelque jouissance secrète et profonde ; et elle s’obstinait à passer un collier au cou de son mari pour rire ensuite de tout son cœur en s’écriant : « Comme tu es drôle ! » Puis elle se jetait dans ses bras et l’embrassait éperdument. »
Apparition ***
Un vieux marquis nous raconte comment, sur la demande d’un vieil ami désespéré depuis la mort de sa femme, il s’est aventuré dans le vieux château de celui-ci et a eu la peur de sa vie.
Le fantastique se fait ici merveilleux car l’apparition paraît bien réelle, à moins que le conteur ait tout rêvé. On peut cependant imaginer aussi que l’apparition est bien la femme mais qu’elle n’est pas morte mais séquestrée par son mari…
L’ambiance est un peu plombée par cette apparition qui parle et qu’on touche : le « doute fantastique » s’écroule. De plus, le conte n’a pas l’air de suggérer grand chose de plus, sinon une ressemblance lointaine avec la nouvelle de Poe, La Chute de la maison Usher.
p. 784 : Une telle secousse me courut dans les membres que je faillis m’abattre à la renverse ! Oh ! personne ne peut comprendre, à moins de les avoir ressenties, ces épouvantables et stupides terreurs. L’âme se fond ; on ne sent plus son cœur ; le corps entier devient mou comme une éponge ; on dirait que tout l’intérieur de nous s’écroule. »
La Porte ***
Karl Marsouligny nous conte comment il s’est fait invité à la campagne par le mari de la femme à qui il faisait la cour sans discrétion.
L’intrigue semble tirée du Décaméron de Boccace. Il est dommage que le désir charnel n’ait pas été plus vivement attisé avant le final. Le mari est peu décrit et l’aventure reste assez bizarre.
p. 906 : « Dans une grande pièce en désordre, au milieu de jupes, de cols, de corsages semés par terre, un grand être sec, dépeigné, le bas du corps couvert d’une vieille jupe de soir fripée qui collait sur sa croupe maigre, brossait devant une glace des cheveux blonds, courts et rares.
Ses bras formaient deux angles pointus ; et comme elle se retournait effarée, je vis sous une chemise de toile commune un cimetière de côtes qu’une fausse gorge de coton dissimulait en public. »
Le Père (« Jean de Valnoix est un ami que je vais voir de temps en temps. ») *****
Le conteur se rend dans le sud, chez son vieil ami Jean de Valnoix, retiré du monde par dégoût. Au 19 juillet, un domestique annonce la venue d’une bohémienne. Celle-ci vient exprimer sa reconnaissance, chaque année à la même date, parce que Jean l’a aidée à accoucher, il y a sept ans d’une petite fille. Elle est chaque fois accompagnée de la petite et d’un homme différent.
Ce conte trompe d’abord le lecteur par des réflexions qui pourraient annoncer un conte fantastique, après quoi, il prend la tournure d’une anecdote plaisante qui n’omet pas une petite attaque amusante envers le vrai père, un gendarme, qui, pourtant gardien de la morale, n’a jamais assumé cette enfant. On a aussi un parallèle entre le grand monde avec « ses bassesses et ses saletés » et le monde populaire, ses énormités et son innocence.
p. 974 : « Nous étions assis tous les deux, vers neuf heures du soir, à regarder couler l’eau de la rivière, contre nos pieds : et nous échangions des idées très vagues sur les étoiles qui se baignaient dans le courant et semblaient nager devant nous. Nous échangions des idées très vagues, très confuses, très courtes, car nos esprits sont très bornés, très faibles, très impuissants. […] Nous songions aux êtres qui peuplent ces mondes, à leurs formes inimaginables, à leurs facultés insoupçonnables à leurs organes inconnus, aux animaux, aux plantes, à toutes les espèces, à tous les règnes, à toutes les essences, à toutes les matières, que le rêve de l’homme ne peut même effleurer. »
Moiron ***
Un instituteur du nom de Moiron, connu pour être un homme d’une grande bonté, est condamné à mort pour avoir provoqué la mort de nombre de ses élèves en leur faisant avaler par des gâteaux, de la fibre de verre. Le procureur général, M. Maloureau, sur la conviction d’un prêtre, a demandé la grâce de Moiron à Napoléon.
Difficile de faire croire à ce criminel tueur en série par ailleurs exemplaire en dehors du fait qu’il tue (serait-ce inspiré d’un fait divers ? on pourrait comparer avec Le Boucher de Claude Chabrol). Ne reste que cette vision de la religion qui semble ici aider ce criminel qui finalement ne fait que servir le méchant Dieu auquel il croit. Dans ses bons actes, la religion serait finalement naïve, inutile et détournée.
p. 987 : « Pourquoi cette conviction soudaine d’une femme si pieuse jeta-t-elle dans mon esprit un terrible doute ? »
p. 989 : « J’ouvris les yeux comme lorsqu’on s’éveille ; et je compris que Dieu est méchant. Pourquoi avait-il tué mes enfants ? J’ouvris les yeux, et je vis qu’il aime tuer. Il n’aime que ça, monsieur. Il ne fait vivre que pour détruire ! Dieu, monsieur, est un massacreur. Il lui faut tous les jours des morts. Il en fait de toutes les façons pour mieux s’amuser. Il a inventé les maladies, les accidents, pour se divertir tout doucement le long des mois et des années ; et puis, quand il s’ennuie, il a les épidémies, la peste, le choléra, les angines, la petite vérole ; est-ce que je sais tout ce qu’a imaginé ce monstre ? Ça ne lui suffisait pas encore, ça se ressemble, tous ces maux-là ! et il se paie des guerres de temps en temps, pour voir deux cent mille soldats par terre, écrasés dans le sang et dans la boue, crevés, les bras et les jambes arrachés, les têtes cassées par des boulets comme des œufs qui tombent sur une route. »
Nos lettres ***
Notre conteur trouve par hasard de vieilles lettres de la tante Rose. Celle-ci demande à son amant de lui réexpédier ses lettres car elles seront naturellement plus en sécurité.
Ce conte constitué d’un petit récit cadre se voulant objectif, et de deux lettres des amants sert d’illustration à la nature trompeuse de la femme. La conclusion comme d’ailleurs la démonstration, très empruntes de Schopenhauer, paraissent cependant sans fondement.
p. 1030 : « Songez donc que jamais, vous entendez bien, jamais une femme ne brûle, ne déchire, ne détruit les lettres où on lui dit qu’elle est aimée. Toute notre vie est là, tout notre espoir, notre attente, tout notre rêve. Ces petits papiers qui portent notre nom et nous caressent avec de douces choses, sont des reliques, et nous adorons les chapelles, nous autres, surtout les chapelles dont nous sommes les saintes. Nos lettres d’amour, ce sont nos titres de beauté, nos titres de grâce et de séduction, notre orgueil intime de femmes, ce sont les trésors de notre cœur. Non, non, jamais une femme ne détruit ces archives secrètes et délicieuses de sa vie. »
La Nuit (Cauchemar) *****
Notre conteur aime follement se promener la nuit. Mais un soir, la nuit ne veut plus s’en aller, et le promeneur se perd dans l’ombre profonde d’un Paris vide.
L’angoisse progressive, l’irréalité tout à fait justifiée du rêve, sont ici d’autant plus efficaces qu’il n’y a aucune transition entre la réalité et le cauchemar. Le second n’étant que le prolongement (logique ?) de la première.
Ce cauchemar est bien un révélateur psychologique d’une hantise de Maupassant : perdre le mince lien qui nous rattache avec la lumière, la vie, le temps, la réalité, la logique.
En même temps, il serait presque possible de voir dans cette nouvelle une illustration du fonctionnement implicite des « contes » de Maupassant et de leur esthétique : autour du texte écrit, du récit solide, du conscient, plus on s’éloigne et plus on se perd dans un monde sans lumière, un monde informe, un monde de vide (on pourra comparer avec cette métaphore de Robert Musil d’une conscience marchant sur un pont fragile au dessus du vide, dans Les Désarrois de l’élève Törless).
p. 946 : « Pour la première fois je sentis qu’il allait arriver quelque chose d’étrange, de nouveau. Il me sembla qu’il faisait froid, que l’air s’épaississait, que la nuit, que ma nuit bien-aimée, devenait lourde sur mon cœur. »