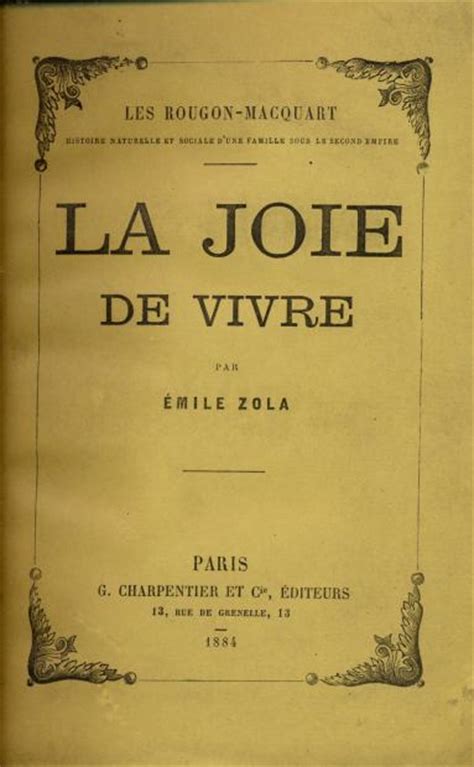
Les limites de la charité chrétienne.
Zola (Émile) 1884, La Joie de vivre (Les Rougon-Macquart, vol. 12), Charpentier
Résumé
Pauline Chenu, fille de Lisa Macquart (commerçante enrichie du Ventre de Paris), est orpheline à dix ans, envoyée avec son héritage chez des parents, les Chanteau, qui habitent à Bonneville, un petit village au bord de la falaise en Normandie. Bien accueillie par tous à l’exception de la vieille servante, Pauline grandit dans la joie et le jeu avec son cousin Lazare, promis à des études de médecine. Seule la petite Louise qui vient parfois pendant l’été, lui dispute l’exclusivité de son compagnon de jeu adoré.
Pauline est d’un dévouement total, sans condition, pour sa nouvelle famille, le père Chanteau qui souffre horriblement de la goutte dans son coin, les tâches ménagères et les petits déboires financiers de la mère, les pauvres du village…
Quand Lazare délaisse ses études pour des rêves d’artiste ou de gloire facile, Pauline le soutient mentalement et bientôt financièrement. Devenue jeune fille, elle prend conscience de son amour pour Lazare et l’engagement de sa fortune dans les projets de son cousin prend la forme d’une promesse de mariage. Mais les projets artistiques piétinent, les projets d’invention et d’industrie sont des gouffres…
Commentaires
La joie de vivre, c’est le caractère de Pauline, infatigablement positif, bienveillant, dévoué aux autres. Peu à peu grignotée, à l’image de la côte par les vagues destructrices, par le tempérament autodestructeur de son milieu : monsieur Chanteau qui continue les écarts à son régime malgré tous les avertissements ; madame Chanteau qui soutient les lubies de son fils, joue l’argent de l’héritage de Pauline, Lazare qui est obsédé par la peur de la mort et fuit dans l’illusion, les gueux qui choisissent volontairement la pauvreté et la déchéance alors même qu’on leur propose de l’aide. Même la chatte qui retourne inlassablement se remplir d’une portée inutile, illustre cette destruction de soi.
Contrairement à l’attente romantique – le modèle de Causette chez les Ténardier –, l’environnement de Pauline, à commencer par madame Chanteau et Lazare, ou même Louise, ne cherche pas à lui faire du mal mais au contraire, reconnaissent et admirent son dévouement. Ils lui font du mal bien malgré eux, c’est leur nature négative, sans espoir de changement, comme ses vagues, qui la détruisent. Ainsi, la gentillesse se transforme en un cadeau de soi, une dette inacceptable pour madame Chanteau qui se met à haïr la petite tellement parfaite. Lazare lui aussi se sent écrasé face à l’immense bonté de Pauline, lui préférant alors Louise, destructrice elle aussi (qui choisit Lazare dont le caractère ne lui correspond pas, qui revient chaque été dans un lieu qui ne lui ressemble pas…).
Mais Pauline elle-même ne déteint pas de ce décor : elle est également auto-destructrice malgré elle. Malgré tous les avertissements, explicités par le médecin qui l’enjoint à partir, elle s’entête dans sa bonté, luttant elle-même contre sa nature jalouse. Triomphant de sa jalousie, d’une certaine forme de pingrerie qui n’est qu’une forme naturelle d’égoïsme, de volonté d’être heureux, elle s’enferme dans un destin malheureux. C’est la forme ultime de bonté, d’abandon de soi, qui provoque en fait, par sa dissonance avec le reste des hommes, une certaine dose de malheurs. Son aide aux malheureux gamins du village ne fait que les entretenir dans leur pauvreté, en flattant son ego généreux, au lieu de parfois les bousculer ou les laisser réagir d’eux-mêmes à leurs propres maux. En soignant M. Chanteau, elle adoucit les conséquences de son vice de gourmandise, les rendant acceptables. Lazare peut envisager de nouvelles lubies. Sa générosité alimente les tendances dépensières de la mère… Toute la gentillesse, la charité chrétienne de Pauline, au lieu de résoudre les problèmes existants, les fait persister voir naître. Cet aspect négatif de la charité pourrait être interprété comme un côté conservateur chez Zola : si vous donnez de l’argent à un pauvre, il le boira. Mais on peut aussi le comprendre autrement : la charité soutient le vice parce qu’elle se substitue à une vraie résolution des problèmes : intégration des populations pauvres par le métier et par l’éducation (le plein emploi condition sine qua none d’une société solidaire), interdiction de spéculer ; améliorer l’hygiène de vie plutôt que de soigner les conséquences (ce qui serait à rapprocher de la pensée d’Ivan Illich) ; ne pas donner de fausses illusions d’enrichissement et de gloire aux enfants… Le don de soi chez Pauline est négatif parce qu’elle s’oublie elle-même et parce qu’il empêche une vraie réaction contre soi-même chez des personnages profondément négatifs.
Ce roman est ainsi celui de l’instinct de mort de l’homme, qui s’incarne explicitement chez Lazare par un dégoût, une peur de la mort paralysante qui ne peut être oubliée que par une fuite en avant. C’est cet élan vers le positif, vers l’oubli de soi qu’on peut appeler joie de vivre. La joie malgré tout, l’envie de se lever, de faire l’effort, d’y croire, c’est Pauline. Mais quelle que soit cet élan, même le plus noble et puissant, il ne fait que cacher cette pulsion macabre très schopenhauerienne. Toutefois, c’est peut-être dans le volume suivant du cycle des Rougon-Macquart, que Zola apporte une réponse par son personnage d’Étienne Lantier qui change lui-même, vainquant la violence de l’alcool, s’instruisant, parlant, créant une caisse de solidarité pour donner la force à ses camarades de se révolter contre leur condition…
Contrairement à l’essentiel du cycle des Rougon-Macquart, ce roman ne semble pas tout à fait centré sur un thème ou une catégorie sociale (la charité? ). Cette famille de petite bourgeoisie de province normande, cette vie de femme ratée, semble à rapprocher de Flaubert (Madame Bovary, 1856) ou de Maupassant (Une vie, 1883, sorti un an plus tôt). Chez Flaubert, madame Bovary se détruit par des illusions nourries par de mauvaises lectures ; chez Maupassant, c’est le manque d’éducation, la méchanceté fondamentale de certains personnages qui provoquent le malheur de l’héroïne. Tandis que chez Zola, c’est la nature humaine même qui va naturellement à son malheur.
Passages retenus
Signes avant-coureur de l’abus de gentillesse, pp. 17-18 :
Mais, lorsque le dessert, un fromage de Pont-l’Évêque et des biscuits, la grande joie fut une brusque apparition de Mathieu. Jusque-là, il avait dormi quelque part, sous la table. L’arrivée des biscuits venait de le réveiller, il semblait les sentir dans son sommeil ; et, tous les soirs, à ce moment précis, il se secouait, il faisait sa ronde, guettant les coeurs sur les visages. D’habitude, c’était Lazare qui se laissait le plus vite apitoyer ; seulement, ce soir-là, Mathieu, à son deuxième tour, regarda fixement Pauline, de ses bons yeux humains ; puis, devinant une grande amie des bêtes et des gens, il posa sa tête énorme sur le petit genou de l’enfant, sans la quitter de ses regards pleins de tendres supplications. Oh ! Le mendiant ! dit madame Chanteau. Doucement, Mathieu ! Veux-tu bien ne pas te jeter si fort sur la nourriture !
Le chien, d’un coup de gosier, avait bu le morceau de biscuit que Pauline lui tendait ; et il replaçait sa tête sur le petit genou, il demandait un autre morceau, les yeux toujours dans les yeux de sa nouvelle amie. Elle riait, le baisait, le trouvait bien drôle, les oreilles rabattues, une tape noire sur l’oeil gauche, la seule tache qui marquât sa robe blanche, aux longs poils frisés. Mais il y eut un incident : la Minouche, jalouse, venait de sauter au bord de la table ; et, ronronnante, l’échine souple, avec des grâces de jeune chèvre, elle donnait de grands coups de tête dans le menton de l’enfant. C’était sa façon de se caresser, on sentait son nez froid et l’effleurement de ses dents pointues ; tandis qu’elle dansait sur ses pattes, comme un mitron pétrissant de la pâte. Alors, Pauline fut enchantée, entre les deux bêtes, la chatte à gauche, le chien à droite, envahie par eux, exploitée indignement, jusqu’à leur distribuer tout son dessert.
Renvoie-les donc, lui dit sa tante. Ils ne te laisseront rien.
Qu’est-ce que ça fait ? répondit-elle simplement, dans son bonheur de se dépouiller.
On avait fini. Véronique ôtait le couvert. Les deux bêtes, voyant la table nette, s’en allèrent sans dire merci, en se léchant une dernière fois.
La chatte et ses portées, p. 69 :
Les quelques bêtes de la maison l’auraient instruite si elle n’avait pas ouvert les livres. La Minouche surtout l’intéressait. Cette Minouche était une gueuse, qui, quatre fois par an, tirait des bordées terribles. Brusquement, elle si délicate, sans cesse en toilette, ne posant la patte dehors qu’avec des frissons, de peur de se salir, disparaissait deux et trois jours. On l’entendait jurer et se battre, on voyait luire dans le noir, ainsi que des chandelles, les yeux de tous les matous de Bonneville. Puis, elle rentrait abominable, faite comme une traînée, le poil tellement déguenillé et sale, qu’elle se léchait pendant une semaine. Ensuite, elle reprenait son air dégoûté de princesse, elle se caressait au menton du monde, sans paraître s’apercevoir que son ventre s’arrondissait. Un beau matin, on la trouvait avec des petits. Véronique les emportait tous, dans un coin de son tablier, pour les jeter à l’eau. Et la Minouche, mère détestable, ne les cherchait même pas, accoutumée à en être débarrassée ainsi, croyant que la maternité finissait là. Elle se léchait encore, ronronnait, faisait la belle, jusqu’au soir où, dévergondée, dans les coups de griffes et les miaulements, elle allait en chercher une ventrée nouvelle. Mathieu était meilleur père pour ces enfants qu’il n’avait pas faits, car il suivait le tablier de Véronique en geignant, il avait la passion de débarbouiller tous les petits êtres au berceau.
Oh ! Ma tante, cette fois, il faut lui en laisser un, disait à chaque portée Pauline, indignée et ravie des grâces amoureuses de la chatte.
Mais Véronique se fâchait.
Non, par exemple ! Pour qu’elle nous le traîne partout !… Et puis elle n’y tient pas. Elle a tout le plaisir sans avoir le mal.
Cour des miracles, pp. 125-126 :
Maintenant, sa charité active s’élargissait sur toute la contrée. Elle aimait d’instinct les misérables, n’était pas répugnée par leurs déchéances, poussait ce goût jusqu’à raccommoder avec des bâtons les pattes cassées des poules, et à mettre dehors, la nuit, des écuelles de soupe pour les chats perdus. C’était, chez elle, un continuel souci des souffrants, un besoin et une joie de les soulager. Aussi les pauvres venaient-ils à ses mains tendues, comme les moineaux pillards vont aux fenêtres ouvertes des granges. Bonneville entier, cette poignée de pêcheurs rongée de maux sous l’écrasement des marées hautes, montaient chez la demoiselle, ainsi qu’ils la nommaient. Mais elle adorait surtout les enfants, les petits aux culottes percées, laissant voir leurs chairs roses, les petites blémies, ne mangeant pas à leur faim, dévorant des yeux les tartines qu’elle leur distribuait. Et les parents finauds spéculaient sur cette tendresse, lui envoyaient leur marmaille, les plus troués, les plus chétifs, pour l’apitoyer davantage.
– Tu vois, reprit-elle en riant, j’ai mon jour comme une dame, le samedi. On vient me visiter… Eh ! toi, petite Gonin, veux-tu bien ne pas pincer cette grande bête de Houtelard ! Je me fâche, si vous n’êtes pas sages… Tâchons de procéder par ordre.
Alors, la distribution commença. Elle les régentait, les bousculait avec maternité.
Les fausses illusions de la connaissance, p. 258 :
Ah ! Je reconnais là nos jeunes gens d’aujourd’hui, qui ont mordu aux sciences, et qui en sont malades, parce qu’ils n’ont pu y satisfaire les vieilles idées d’absolu, sucées avec le lait de leurs nourrices. Vous voudriez trouver dans les sciences, d’un coup et en bloc, toutes les vérités, lorsque nous les découvrons à peine, lorsqu’elles ne seront sans doute jamais qu’une éternelle enquête. Alors, vous les niez, vous vous rejetez dans la foi qui ne veut plus de vous, et vous tombez au pessimisme… Oui, c’est la maladie de la fin de siècle, vous êtes des Werther retournés.
S’effacer soi, p. 310 :
Tout finissait, elle venait de couper les liens de son égoïsme, elle n’espérait plus en rien ni en personne ; et il y avait, au fond d’elle, la volupté subtile du sacrifice. Mais elle ne retrouvait pas son ancienne volonté de suffire au bonheur des siens, ce besoin autoritaire qui lui apparaissait à cette heure comme le dernier retranchement de sa jalousie. L’orgueil de son abnégation s’en était allée, elle acceptait que les siens fussent heureux en dehors d’elle. C’était le degré suprême dans l’amour des autres : disparaître, donner tout sans croire qu’on donne assez, aimer au point d’être joyeux d’une félicité qu’on a pas faite et qu’on ne partagera pas. Le soleil se levait, lorsqu’elle s’endormit d’un grand sommeil.
Surgissement des règles, p. 327 :
Mais elle se pencha davantage. La coulée rouge d’une goutte de sang, le long de sa cuisse, l’étonnait. Soudain elle comprit : sa chemise, glissée à terre, semblait avoir reçu l’éclaboussement d’un coup de couteau. C’était donc cela qu’elle éprouvait depuis son départ de Caen, une telle défaillance de tout son corps ? Elle ne l’attendait point si tôt, cette blessure, que la perte de son amour venait d’ouvrir, aux sources mêmes de la vie. Et la vue de cette vie qui s’en allait inutile, combla son désespoir. […] Ah ! Misère ! La pluie rouge de la puberté tombait là, aujourd’hui, pareille aux larmes vaines que sa virginité pleurait en elle. Désormais, chaque mois ramenait ce jaillissement de grappe mûre, écrasée aux vendanges, et jamais elle ne serait femme, et elle vieillirait dans la stérilité !
Alors, la jalousie la reprit aux entrailles, devant les tableaux que son excitation déroulait toujours. Elle voulait vivre, et vivre complètement, faire de la vie, elle qui aimait la vie ! À quoi bon être si l’on ne donne pas son être ? Elle voyait les deux autres, une tentation de balafrer sa nudité lui faisait chercher ses ciseaux du regard. Pourquoi ne pas couper cette gorge, briser ces cuisses, achever d’ouvrir ce ventre et faire couler ce sang jusqu’à la dernière goutte ? Elle était plus belle que cette maigre fille blonde, elle était plus forte, et lui ne l’avait pas choisie cependant. Jamais elle ne le connaîtrait, rien en elle ne devait plus l’attendre, ni les bras, ni les hanches, ni les lèvres. Tout pouvait être jeté à la borne, comme un haillon vide. Étaient-ce possible qu’ils fussent ensemble, lorsqu’elle restait seule à grelotter de fièvre, dans cette maison froide !
Brusquement, elle s’abattit sur le lit, à plat ventre. Elle avait saisi l’oreiller dans ses bras convulsifs, elle le mordait pour étouffer ses sanglots ; et elle tâchait de tuer sa chair révoltée, en l’écrasant sur le matelas. De longues secousses la soulevaient, de la nuque aux talons. Vainement, ses paupières se serraient pour ne plus voir, elle voyait quand même, des monstruosités se levaient dans l’obscurité. Que faire ? se crever les yeux, et voir encore, voir toujours peut-être.