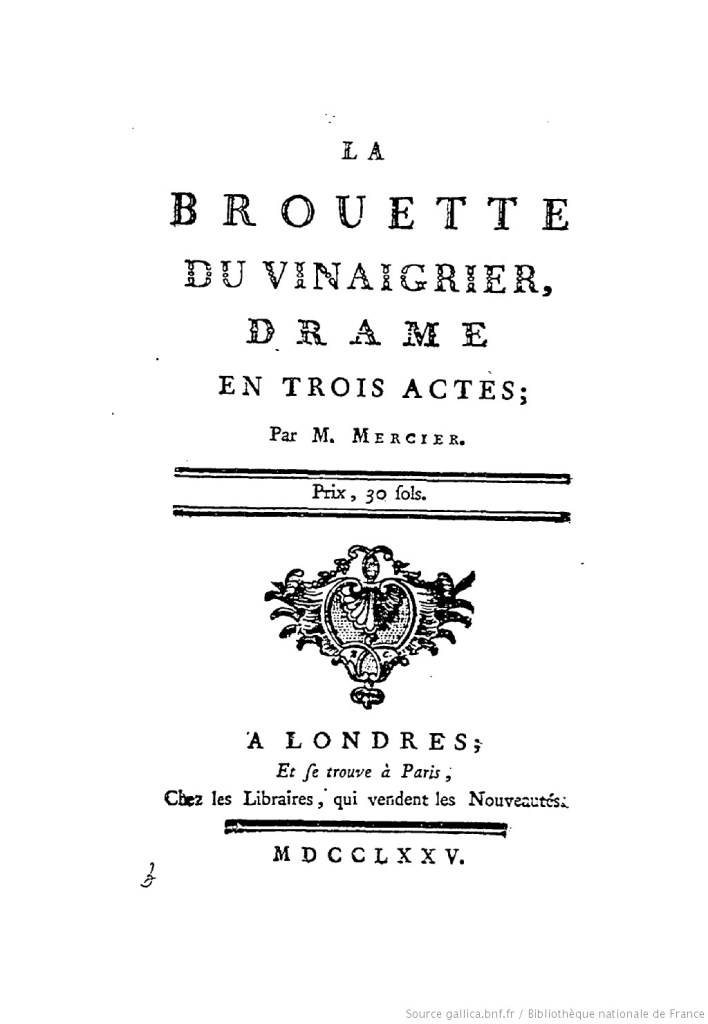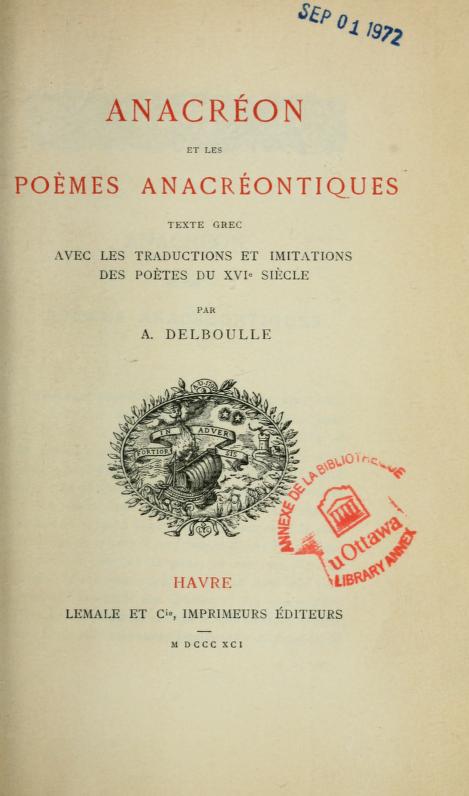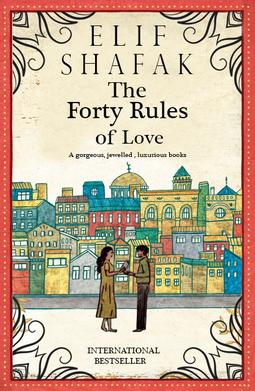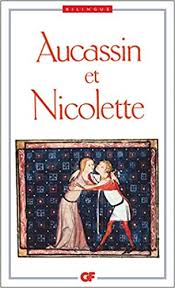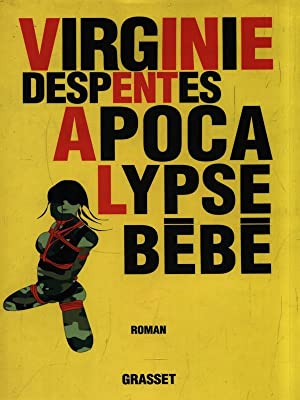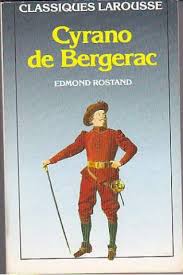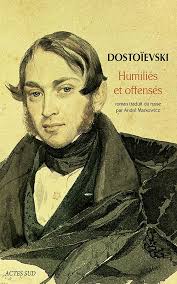
L’acharnement contre les pauvres finira par faire surgir leur voix
Dostoïevski (Fédor) 1861, Humiliés et offensés, Actes Sud, Babel, 2000
Traduit du russe par André Markowicz (titre original : Униженные и оскорбленные)
Résumé
Ivan Pétrovitch vit une petite vie modeste d’écrivain après un premier roman qui lui a valu un petit succès critique. Assistant par hasard à la mort d’un vieil homme, il rencontre alors la petite-fille de celui-ci : une petite fille endurcie et triste qui se fait contrôler par sa logeuse à qui elle doit l’enterrement de sa mère.
Dans le même temps, la famille adoptive d’Ivan s’installe à Saint-Pétersbourg pour se consacrer au procès qui les oppose au Prince, ancien bienfaiteur de la famille, qui les accuse désormais de tout, et particulièrement d’avoir voulu marier leur fille à son fils.
Ivan retrouve Natacha qu’il aime tendrement depuis leur enfance. Mais l’amour de celle-ci pour le fils du Prince est toujours vif, trahissant ainsi l’honneur de sa famille et son amour d’enfance.
Commentaires
On peut voir ici un dédoublement et une superposition de la structure narrative : la jeune fille qui a fauté et fait un mauvais choix d’amour ; le père qui ne peut pardonner malgré sa souffrance ; les proches qui prennent les contrecoups ; les grands, insouciants du mal qu’ils causent, égoïstes, impunis… On pourrait penser que ce dédoublement du schéma narratif est un peu gros, un peu comme dans Les Affinités électives de Goethe (1809). De même pour la mise en abyme du métier d’écrivain, et les références à la carrière de l’auteur Dostoïevski dans la vie de son personnage Ivan. Ces gros traits gardent un quelque chose sans doute de la maladresse d’un premier gros ouvrage mais on y trouve déjà ce qui fera les oeuvres à suivre. Le personnage de la jeune orpheline Nelly symbolise à merveille son oeuvre et sa vie d’écrivain : d’abord mutique, sous les chocs de la vie, elle finit par laisser entendre une voix, cette voix caractéristique des personnages de Dostoïevski, ce cri d’écorché, détruit, sali, piétiné, mais toujours explosant d’une humanité pure.
Cette voix particulière, émotive et sursautante, emportée par la passion, des personnages, est déjà là. Et le fait que le personnage central du narrateur, soit également le double de l’auteur – un écrivain face à son métier : devant faire passer la puissance de la vie dans son œuvre – nous apprend sur sa manière de faire. Son personnage est impliqué dans l’action, au plus proche. Il est touché par l’intrigue, mu par elle. Ses discours, ses analyses, sont motivés par un but interne au récit, non par la séduction du lecteur. Contrairement à une tendance de l’écriture moderne (cette obsession mise en évidence par Jacqueline Authier-Revuz dans Ces mots qui ne vont pas de soi, des écrivains qui se sentent obligés de corriger tout ce qu’ils viennent d’écrire, comme s’ils voulaient laisser voir leur quête de précision au lecteur), la voix dostoïevskienne n’est pas double : elle est toute à son action de parler, plongée dans son univers de fiction, traversée par un monde, elle ne semble pas se soucier des lecteurs. On peut penser que par la suite, Dostoïevski s’est introduit, glissé, dans plusieurs personnages pour avoir cette multifocalisation, une focalisation par discours, par voix, propre à ses grands romans (ce que Bakhtine qualifie de « dialogisme », dans sa Poétique de Dostoïevski, 1929). C’est peut-être aussi ce qui permet aux fictions de Dostoïevski d’avoir une finesse étonnante d’analyse psychologique de ses personnages. Voulant les faire parler au cœur de leur emportement émotionnel, Dostoïevski doit donc vivre en même temps qu’eux leurs mésaventures. Il leur prête donc sa voix sans les trahir. C’est pourquoi chaque discours est à la fois le même et toujours différent selon le personnage. (cf. Bakhtine)
Passages retenus
p. 112-114 :
Je suis persuadé que, dans son âme à lui, tout gémissait et se retournait de douleur, à voir les larmes et la peur de sa pauvre compagne ; je suis persuadé qu’il souffrait bien plus qu’elle ; mais il n’arrivait pas à se retenir. Cela arrive parfois aux gens les plus gentils mais qui n’ont pas les nerfs solides et qui, malgré toute leur bonté, se laissent entraîner jusqu’à la jouissance par leur propre malheur et leur colère, et cherchent à s’exprimer à tout prix, même s’ils offensent quelqu’un d’autre, quelqu’un qui n’y est pour rien, et qui, généralement, est l’être auquel ils tiennent le plus. Les femmes, par exemple, ont parfois le besoin de se sentir malheureuses, offensées, même s’il n’y a eu ni offense ni malheur. Je connais beaucoup d’hommes qui, dans ce cas-là, ressemblent aux femmes, et même des hommes assez forts, qui n’ont quasiment rien de féminin. Le vieillard sentait le besoin d’une dispute, même s’il souffrait de ce besoin.
Je me souviens qu’une idée fusa dans ma tête : est-ce que, réellement, il n’aurait pas été capable de faire une folie quelconque, dans la journée, comme le supposait Anna Andréïevna ? Et si le bon Dieu lui avait mis du plomb dans la cervelle et qu’il était allé, réellement, chez Natacha, mais qu’il ait changé d’avis en route, ou que quelque chose n’ait pas marché, se soit brisé dans son intention, – comme c’était évident – et s’il était rentré chez lui, là, fâché, anéanti, portant la honte des désirs et des sentiments qu’il venait de ressentir, cherchant quelqu’un sur qui soulager son cœur et sa propre faiblesse, et choisissant justement pour ce faire ceux chez qui il soupçonnait le plus les mêmes désirs et les mêmes sentiments. Peut-être, voulant pardonner à sa fille, s’était-il justement imaginer le bonheur et la joie de sa pauvre Anna Andréïevna, et, devant son échec, évidement, c’est elle qui prenait tout.