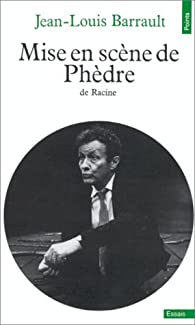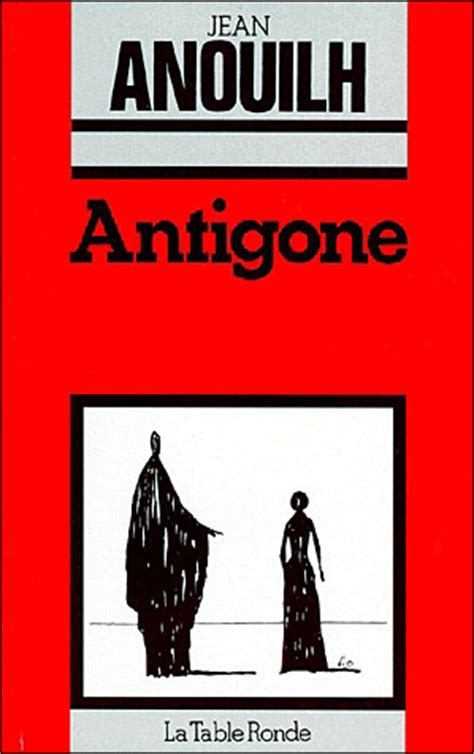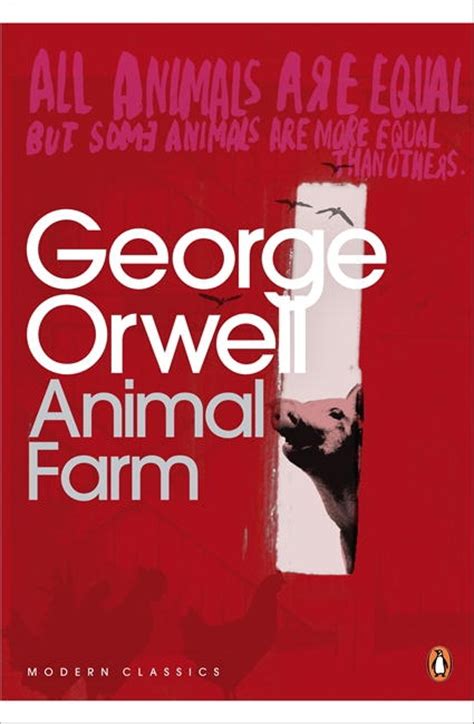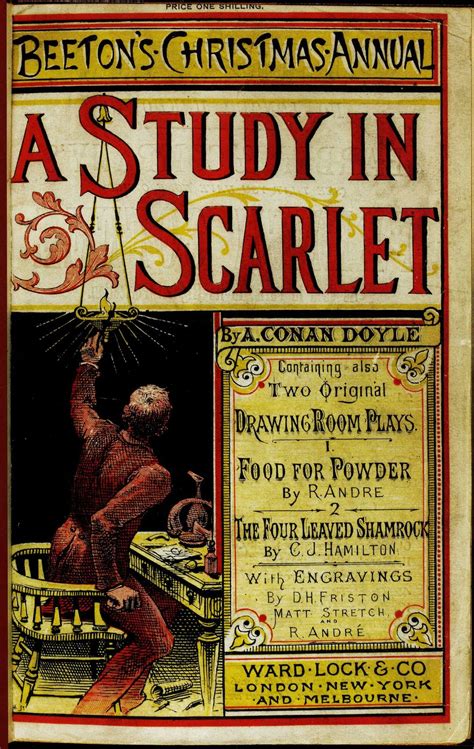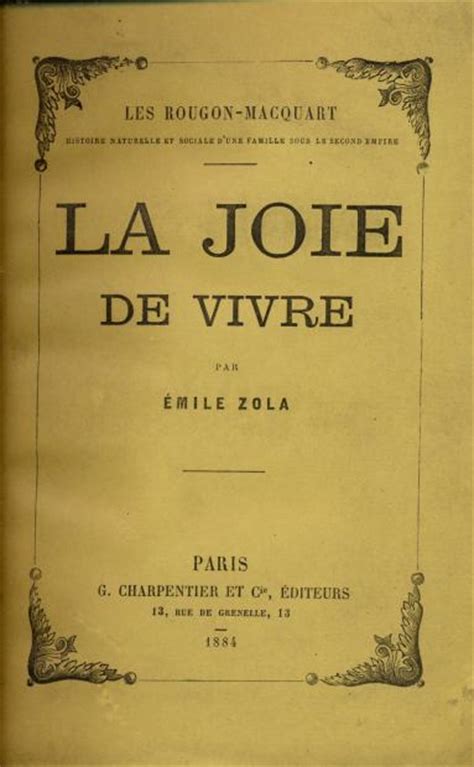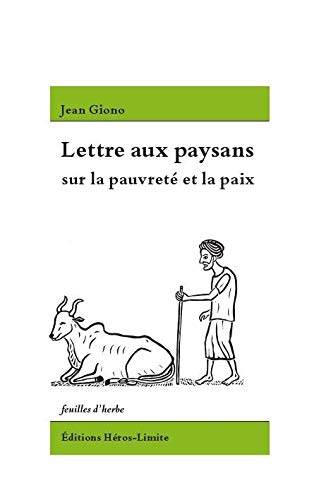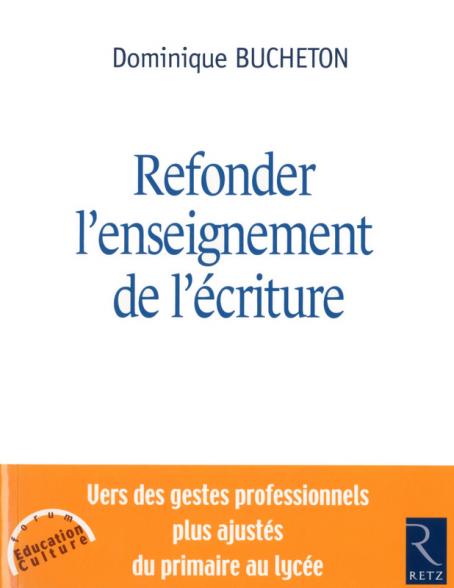Il faudra plus que des discours pour concilier les classes sociales… – Première pierre de la Comédie humaine
Balzac (Honoré de) 1829-1842, La Maison du chat-qui-pelote (Gloire ou Malheur), Paris, Furne corrigé*
Première œuvre de la Comédie humaine de Balzac, catégorie Études de mœurs : Scènes de la vie privée.
Cette longue nouvelle a d’abord été publiée sous le titre pompeux de Gloire ou Malheur en 1830, elle a été retravaillée plusieurs fois jusqu’à être intégrée dans La Comédie humaine en 1842 sous le nom qu’on lui connaît.
* Nouvelle édition professionnelle numérique, texte d’après les corrections que Balzac a effectuées jusqu’à la fin de sa vie. Comparaisons entre les différentes versions-révisions du texte, étude de la génétique du texte… Plus d’informations sur le site du projet eBalzac.
Voyez aussi cet article très intéressant à propos du projet eBalzac.
Illustration d’Édouard Toudouze, scène du début du roman.
Résumé
Un jour qu’il passe devant la vieille maison du drapier Guillaume, le jeune peintre Théodore de Sommervieux aperçoit la belle Augustine à sa fenêtre et en tombe amoureux. Inspiré par cette apparition, il exécute de magnifiques tableaux de la vieille bâtisse et de la jeune fille. La jeune fille, longtemps préservée par ses parents et destinée à un mariage avec l’un des apprentis, cède à la séduction distinguée et plein de promesses du jeune homme. Le père accepte de céder sa fille.
Commentaires
Dans cette nouvelle, Balzac montre la distance qui sépare encore le peuple, ici les artisans, de la haute société, des artistes. Malgré l’amour, la passion, qui rapproche les deux, l’inadéquation des classes sociales, la différence de l’éducation, créent un fossé trop important pour penser à la pleine mixité rêvée par la jeune République égalitaire. Sur un plan différent, on retrouvera ce décalage de nombreuses fois dans l’oeuvre de Balzac, par exemple dans les Illusions perdues où Lucien, imprimeur, aspire à une carrière d’artiste poète.
En contrepoint de ce mariage désaccordé qui avait pourtant tout pour séduire suivant les stéréotypes du roman romantique (Paul et Virginie) ou du conte (le beau jeune homme artiste, lyrique, sincère, et la belle jeune fille bien éduquée, innocente…), on trouve le mariage de l’artisan successeur du drapier avec la première fille Virginie qu’il n’aimait pas… Cet arrangement finit par satisfaire les deux qui apprennent à s’aimer avec le temps et que leur éducation respective a préparé à vivre ensemble (tenir la boutique, travailler dur…).
Le personnage d’Augustine subit un échec social dans son amour, mais ne peut non plus rebondir car elle ne comprend pas les codes du monde dans lequel elle a essayé de s’intégrer. La culture qu’elle essaie de rattraper ne lui donne pas le goût artistique que peut avoir un jeune élevé dans une famille ayant un capital culturel important. Suscitant pourtant l’admiration de nombre d’hommes dans le monde, elle ne peut même imaginer sortir du mariage bourgeois. Alors qu’une femme qui est pourtant sa rivale, séduite par sa jeunesse et sa détresse, lui donne toutes les techniques pour reprendre son amour, Augustine ne peut accepter les mécaniques du jeu de l’amour : cacher son emportement amoureux, susciter la frustration et la jalousie… Eduquée dans la simplicité, dans la culture de l’idéal amour-mariage, elle est ainsi piégée, incapable de divorcer, de s’avouer son erreur, condamnée à souffrir.
Passages retenus
p. 12
Élevés sur la pointe de leurs pieds, et réfugiés au fond de leur grenier pour jouir de la colère de leur victime, les commis cessèrent de rire en voyant l’insouciant dédain avec lequel le jeune homme secoua son manteau, et le profond mépris que peignit sa figure quand il leva les yeux sur la lucarne vide. En ce moment, une main blanche et délicate fit remonter vers l’imposte la partie inférieure d’une des grossières croisées du troisième étage, au moyen de ces coulisses dont le tourniquet laisse souvent tomber à l’improviste le lourd vitrage qu’il doit retenir. Le passant fut alors récompensé de sa longue attente. La figure d’une jeune fille, fraîche comme un de ces blancs calices qui fleurissent au sein des eaux, se montra couronnée d’une ruche en mousseline froissée qui donnait à sa tête un air d’innocence admirable. Quoique couverts d’une étoffe brune, son cou, ses épaules s’apercevaient, grâce à de légers interstices ménagés par les mouvements du sommeil. Aucune expression de contrainte n’altérait ni l’ingénuité de ce visage, ni le calme de ces yeux immortalisés par avance dans les sublimes compositions de Raphaël : c’était la même grâce, la même tranquillité de ces vierges devenues proverbiales. Il existait un charmant contraste produit par la jeunesse des joues de cette figure, sur laquelle le sommeil avait comme mis en relief une surabondance de vie, et par la vieillesse de cette fenêtre massive aux contours grossiers, dont l’appui était noir. Semblable à ces fleurs de jour qui n’ont pas encore au matin déplié leur tunique roulée par le froid des nuits, la jeune fille, à peine éveillée, laissa errer ses yeux bleus sur les toits voisins et regarda le ciel ; puis, par une sorte d’habitude, elle les baissa sur les sombres régions de la rue, où ils rencontrèrent aussitôt ceux de son adorateur. La coquetterie la fit sans doute souffrir d’être vue en déshabillé, elle se retira vivement en arrière, le tourniquet tout usé tourna, la croisée redescendit avec cette rapidité qui, de nos jours, a valu un nom odieux à cette naïve invention de nos ancêtres, et la vision disparut. Il semblait à ce jeune homme que la plus brillante des étoiles du matin avait été soudain cachée par un nuage.
p. 15-18
Le vieux négociant se trouva debout comme par miracle, sur le seuil de sa boutique, au moment où le domestique se retira. Monsieur Guillaume regarda la rue Saint-Denis, les boutiques voisines et le temps, comme un homme qui débarque au Havre et revoit la France après un long voyage. Bien convaincu que rien n’avait changé pendant son sommeil, il aperçut alors le passant en faction, qui, de son côté, contemplait le patriarche de la draperie, comme Humboldt dut examiner le premier gymnote électrique qu’il vit en Amérique. Monsieur Guillaume portait de larges culottes de velours noir, des bas chinés, et des souliers carrés à boucles d’argent. Son habit à pans carrés, à basques carrées, à collet carré, enveloppait son corps légèrement voûté d’un drap verdâtre garni de grands boutons en métal blanc mais rougis par l’usage. Ses cheveux gris étaient si exactement aplatis et peignés sur son crâne jaune, qu’ils le faisaient ressembler à un champ sillonné. Ses petits yeux verts, percés comme avec une vrille, flamboyaient sous deux arcs marqués d’une faible rougeur à défaut de sourcils. Les inquiétudes avaient tracé sur son front des rides horizontales aussi nombreuses que les plis de son habit. Cette figure blême annonçait la patience, la sagesse commerciale, et l’espèce de cupidité rusée que réclament les affaires. A cette époque on voyait moins rarement qu’aujourd’hui de ces vieilles familles où se conservaient, comme de précieuses traditions, les mœurs, les costumes caractéristiques de leurs professions, et restées au milieu de la civilisation nouvelle comme ces débris antédiluviens retrouvés par Cuvier dans les carrières. Le chef de la famille Guillaume était un de ces notables gardiens des anciens usages : on le surprenait à regretter le Prévôt des Marchands, et jamais il ne parlait d’un jugement du tribunal de commerce sans le nommer la sentence des consuls. C’était sans doute en vertu de ces coutumes que, levé le premier de sa maison, il attendait de pied ferme l’arrivée de ses trois commis, pour les gourmander en cas de retard. Ces jeunes disciples de Mercure ne connaissaient rien de plus redoutable que l’activité silencieuse avec laquelle le patron scrutait leurs visages et leurs mouvements, le lundi matin, en y recherchant les preuves ou les traces de leurs escapades.
p. 80-86
La fougue de passion qui possédait Théodore fit dévorer au jeune ménage près d’une année entière sans que le moindre nuage vînt altérer l’azur du ciel sous lequel ils vivaient. Pour eux, l’existence n’eut rien de pesant. Théodore répandait sur chaque journée d’incroyables fioriture de plaisirs. Il se plaisait à varier les emportements de la passion, par la molle langueur de ces repos où les âmes sont lancées si haut dans l’extase qu’elles semblent y oublier l’union corporelle. Incapable de réfléchir, l’heureuse Augustine se prêtait à l’allure onduleuse de son bonheur. Elle ne croyait pas faire encore assez en se livrant toute à l’amour permis et saint du mariage. Simple et naïve, elle ne connaissait ni la coquetterie des refus, ni l’empire qu’une jeune demoiselle du grand monde se crée sur un mari par d’adroits caprices. Elle aimait trop pour calculer l’avenir, et n’imaginait pas qu’une vie si délicieuse pût jamais cesser. Heureuse d’être alors tous les plaisirs de son mari, elle crut que cet inextinguible amour serait toujours pour elle la plus belle de toutes les parures, comme son dévouement et son obéissance seraient un éternel attrait. Enfin, la félicité de l’amour l’avait rendue si brillante, que sa beauté lui inspira de l’orgueil et lui donna la conscience de pouvoir toujours régner sur un homme aussi facile à enflammer que monsieur de Sommervieux. Ainsi son état de femme ne lui apporta d’autres enseignements que ceux de l’amour. Au sein de ce bonheur, elle resta l’ignorante petite fille qui vivait obscurément rue Saint-Denis, et ne pensa point à prendre les manières, l’instruction, le ton du monde dans lequel elle devait vivre. Ses paroles étant des paroles d’amour, elle y déployait bien une sorte de souplesse d’esprit et une certaine délicatesse d’expression ; mais elle se servait du langage commun à toutes les femmes quand elles se trouvent plongées dans une passion qui semble être leur élément. Si, par hasard, une idée discordante avec celles de Théodore était exprimée par Augustine, le jeune artiste en riait comme on rit des premières fautes que fait un étranger, mais qui finissent par fatiguer s’il ne se corrige pas.
Cependant, à l’expiration de cette année aussi charmante que rapide, Sommervieux sentit un matin la nécessité de reprendre ses travaux et ses habitudes. Sa femme était enceinte. Il revit ses amis. Pendant les longues souffrances de l’année où, pour la première fois, une jeune femme nourrit un enfant, il travailla sans doute avec ardeur ; mais parfois il retourna chercher quelques distractions dans le grand monde. La maison où il allait le plus volontiers était celle de la duchesse de Carigliano qui avait fini par attirer chez elle le célèbre artiste. Quand Augustine fut rétablie, quand son fils ne réclama plus ces soins assidus qui interdisent à une mère les plaisirs du monde, Théodore en était arrivé à vouloir éprouver cette jouissance d’amour-propre que nous donne la société quand nous y apparaissons avec une belle femme, objet d’envie et d’admiration. Parcourir les salons en s’y montrant avec l’éclat emprunté de la gloire de son mari, se voir jalousée par toutes les femmes, fut pour Augustine une nouvelle moisson de plaisirs ; mais ce fut le dernier reflet que devait jeter son bonheur conjugal. Elle commença par offenser la vanité de son mari, quand, malgré de vains efforts, elle laissa percer son ignorance, l’impropriété de son langage et l’étroitesse de ses idées. Le caractère de Sommervieux, dompté pendant près de deux ans et demi par les premiers emportements de l’amour, reprit, avec la tranquillité d’une possession moins jeune, sa pente et ses habitudes un moment détournées de leur cours. La poésie, la peinture et les exquises jouissances de l’imagination possèdent sur les esprits élevés des droits imprescriptibles. Ces besoins d’une âme forte n’avaient pas été trompés chez Théodore pendant ces deux années, ils avaient trouvé seulement une pâture nouvelle. Quand les champs de l’amour furent parcourus, quand l’artiste eut, comme les enfants, cueilli des roses et des bleuets avec une telle avidité qu’il ne s’apercevait pas que ses mains ne pouvaient plus les tenir, la scène changea. Si le peintre montrait à sa femme les croquis de ses plus belles compositions, il l’entendait s’écrier comme eût fait le père Guillaume : ― C’est bien joli ! son admiration sans chaleur ne provenait pas d’un sentiment consciencieux, mais de la croyance sur parole de l’amour. Augustine préférait un regard au plus beau tableau. Le seul sublime qu’elle connût était celui du cœur. Enfin, Théodore ne put se refuser à l’évidence d’une vérité cruelle : sa femme n’était pas sensible à la poésie, elle n’habitait pas sa sphère, elle ne le suivait pas dans tous ses caprices, dans ses improvisations, dans ses joies, dans ses douleurs ; elle marchait terre à terre dans le monde réel, tandis qu’il avait la tête dans les cieux. Les esprits ordinaires ne peuvent pas apprécier les souffrances renaissantes de l’être qui, uni à un autre par le plus intime de tous les sentiments, est obligé de refouler sans cesse les plus chères expansions de sa pensée, et de faire rentrer dans le néant les images qu’une puissance magique le force à créer. Pour lui, ce supplice est d’autant plus cruel, que le sentiment qu’il porte à son compagnon ordonne, par sa première loi, de ne jamais rien se dérober l’un à l’autre, et de confondre les effusions de la pensée aussi bien que les épanchements de l’âme. On ne trompe pas impunément les volontés de la nature : elle est inexorable comme la Nécessité, qui, certes, est une sorte de nature sociale. Sommervieux se réfugia dans le calme et le silence de son atelier, en espérant que l’habitude de vivre avec des artistes pourrait former sa femme, et développerait en elle les germes de haute intelligence engourdis que quelques esprits supérieurs croient préexistants chez tous les êtres ; mais Augustine était trop sincèrement religieuse pour ne pas être effrayée du ton des artistes. Au premier dîner que donna Théodore, elle entendit un jeune peintre disant avec cette enfantine légèreté qu’elle ne sut pas reconnaître et qui absout une plaisanterie de toute irréligion : ― Mais, madame, votre paradis n’est pas plus beau que la Transfiguration de Raphaël ? Eh ! bien, je me suis lassé de la regarder. Augustine apporta donc dans cette société spirituelle un esprit de défiance qui n’échappait à personne. Elle gêna. Les artistes gênés sont impitoyables : ils fuient ou se moquent.
p. 90-93
Elle pleura des larmes de sang, et reconnut trop tard qu’il est des mésalliances d’esprit aussi bien que des mésalliances de mœurs et de rang. En songeant aux délices printanières de son union, elle comprit l’étendue du bonheur passé, et convint en-elle même qu’une si riche moisson d’amour était une vie entière qui ne pouvait se payer que par du malheur. Cependant elle aimait trop sincèrement pour perdre toute espérance. Aussi osa-t-elle entreprendre à vingt et un ans de s’instruire et de rendre son imagination au moins digne de celle qu’elle admirait.
― Si je ne suis pas poète, se disait-elle, au moins je comprendrai la poésie.
Et déployant alors cette force de volonté, cette énergie que les femmes possèdent toutes quand elles aiment, madame de Sommervieux tenta de changer son caractère, ses mœurs et ses habitudes ; mais en dévorant des volumes, en apprenant avec courage, elle ne réussit qu’à devenir moins ignorante. La légèreté de l’esprit et les grâces de la conversation sont un don de la nature ou le fruit d’une éducation commencée au berceau. Elle pouvait apprécier la musique, en jouir, mais non chanter avec goût. Elle comprit la littérature et les beautés de la poésie, mais il était trop tard pour en orner sa rebelle mémoire. Elle entendait avec plaisir les entretiens du monde, mais elle n’y fournissait rien de brillant. Ses idées religieuses et ses préjugés d’enfance s’opposèrent à la complète émancipation de son intelligence. Enfin, il s’était glissé contre elle, dans l’âme de Théodore, une prévention qu’elle ne put vaincre. L’artiste se moquait de ceux qui lui vantaient sa femme, et ses plaisanteries étaient assez fondées : il imposait tellement à cette jeune et touchante créature, qu’en sa présence, ou en tête-à-tête, elle tremblait. Embarrassée par son trop grand désir de plaire, elle sentait son esprit et ses connaissances s’évanouir dans un seul sentiment. La fidélité d’Augustine déplut même à cet infidèle mari, qui semblait l’engager à commettre des fautes en taxant sa vertu d’insensibilité. Augustine s’efforça en vain d’abdiquer sa raison, de se plier aux caprices, aux fantaisies de son mari, et de se vouer à l’égoïsme de sa vanité ; elle ne recueillit point le fruit de ces sacrifices. Peut-être avaient-ils tous deux laissé passer le moment où les âmes peuvent se comprendre.