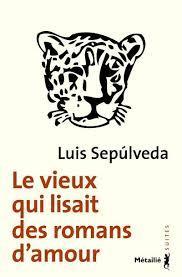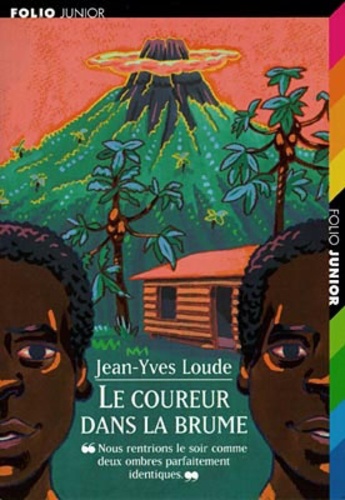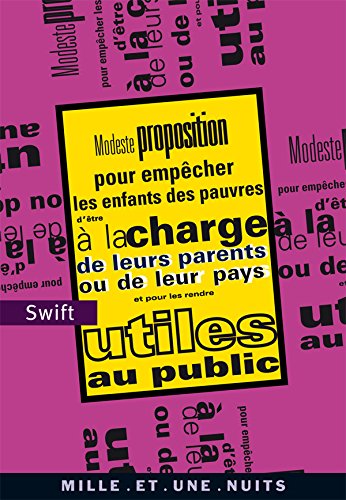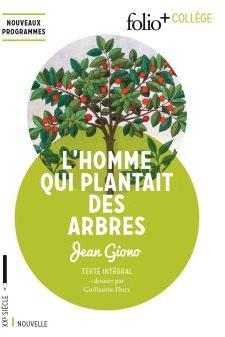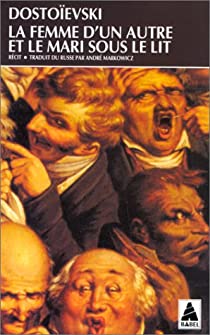L’apprentissage peut asservir ou émanciper. Naissance d’une pédagogie alternative.
Rancière (Jacques) 1987, Le Maître ignorant (Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle), Fayard
Résumé
Début XIXe, Joseph Jacotot, professeur de littérature française, est appelé pour enseigner aux Pays-Bas. N’ayant pas de langue commune avec ses étudiants, il leur demande d’acheter l’édition bilingue des Aventures de Télémaque de Fénelon, et d’en apprendre par coeur quelques passages. Il se rend compte que ses élèves, très motivés, apprennent d’eux-mêmes le français avec cet ouvrage, peut-être mieux que s’il ne les avait guidés…
A partir des expérimentations et réflexions pédagogiques de Jacotot, Jacques Rancière développe les principes d’une pédagogie alternative qui émanciperait l’apprenant, plutôt que de le maintenir en situation de sujet dominé par un professeur, par des savoirs, une institution, une idéologie.
Le premier principe émancipateur, contre-intuitif, est de poser l’égalité des intelligences des hommes, éduqués ou non.
Commentaires
L’expérience de Jacotot est un très beau symbole des principes de la pédagogie alternative (que Freinet, Montessori, Steiner… ont essayé de mettre en oeuvre dans leurs écoles). La motivation de la personne qui apprend est bien-sûr déterminante dans la réussite de l’apprentissage, mais ce que remarque Jacotot est surtout l’efficacité de l’apprentissage en autonomie de ses étudiants. Certes, il leur a donné un outil pratique d’apprentissage (Fénelon ayant conçu son livre comme un roman pédagogique, enseignant par la fiction la belle langue et la culture au dauphin du roi de France, Les Aventures de Télémaque (1699) était aux XVIIIe et XIXe siècles l’un des grands best sellers, et notamment pour apprendre le français à l’étranger). Mais c’est parce qu’ils cherchent par eux-mêmes le fonctionnement de la langue française en la comparant avec la langue hollandaise, en émettant leurs hypothèses, en se cherchant des explications, qu’ils avancent brillamment. De là le titre volontiers provocateur de Rancière, « le maître ignorant » : on peut enseigner n’importe quoi, même ce qu’on ignore, à condition que les apprenants soient motivés et qu’on leur propose des outils adaptés. Il faut faire confiance à l’apprenant pour l’aider au mieux dans son apprentissage, il ira de lui-même, par son exigence et sa curiosité, à la connaissance, mais par son chemin propre et vers ses connaissances. Il est ainsi nécessaire dans l’enseignement de partir du chemin personnel de curiosité de l’apprenant, source de sa moivation, pour l’accompagner, volontaire, d’un intérêt pratique limité ou infantile à une connaissance plus étendue. Le verbe « ignorer » du titre est volontairement exagéré, pour faire comprendre l’aspect tout à fait secondaire des savoirs, de l’expertise disciplinaire de l’enseignant, ce qui est au contraire la priorité dans les concours de recrutement des enseignants. Il y a inversion paradoxale entre le professeur qui ne sait pas et l’élève qui lui sait, car c’est son propre savoir original qu’il doit construire, et sera donc seul à posséder (l’intelligence collective se renforçant de la variété des intelligences individuelles). Dans l’application pratique, l’enseignant peut feindre d’ignorer les règles afin de pousser les apprenants à construire eux-mêmes leurs savoirs. D’une même manière, au lieu de dénoncer une « faute », montrant par là sa supériorité en termes de connaissances, l’enseignant peut amener son élève à considérer que le résultat, la solution qu’il a obtenue, sont insatisfaisants et qu’il doit donc chercher à faire mieux (cela nécessiterait de sortir de l’attention quasi exclusive à la méthode ; ex : calculer la vitesse du vélo. Un premier apprenant obtient 300km/h en appliquant la bonne formule mais ne s’étonne pas de son résultat et obtient la moitié des points ; un second obtient 35 au lieu de 30 avec une mauvaise méthode, il obtient zéro point…). En revanche, « ignorant » ne veut pas dire « stupide », « naïf » ou « garde-chiournes », l’enseignant peut (doit) être expert en guidage, en accompagnement, en connaissance et conception de matériel pédagogique. La formation française des enseignants tente depuis bien vingt ans d’intégrer ces préoccupations mais continue d’être dénigrée pour son obsession des connaissances théoriques et son manque d’enseignement pratique. Or, la domination du théorique sur le pratique, c’est le maintien de l’élitisme intellectuel, de la supériorité de classe des sachants.
Les travaux de Jacotot, en tant que document historique, permettent par ailleurs à Jacques Rancière de ne pas paraître vouloir imposer des thèses et une position politique – proche communiste, anarchiste – pas toujours bien acceptées dans les médias ou même dans un cadre universitaire se voulant neutre. De la même manière que les travaux d’Etienne Cabet et de Louis Gabriel Gauny avaient nourri son premier ouvrage La Nuit des prolétaires (Archives du rêve ouvrier) (1981), Rancière s’appuie sur les réflexions de Jacotot afin d’amener et d’alimenter sa propre réflexion, mais aussi afin de pousser le lecteur à tirer les conclusions par lui-même, celles qui s’imposent au regard des documents. C’est d’ailleurs l’un des principes de la pédagogie alternative : ne pas imposer de solution, de cours, de formule, mais amener les apprenants vers la recherche de solution, qu’ils construisent eux-mêmes le cours, leur savoir, qu’ils trouvent eux-mêmes la formule (on parle de la méthode dite d’induction). Dans son premier essai sur le monde ouvrier, il était déjà question d’auto-apprentissage (comment les ouvriers s’organisant en syndicats ont éprouvé le besoin d’instruire, d’éveiller politiquement leurs pairs, utilisant le temps libre nocturne, à l’image du personnage de Lantier dans Germinal). Ici, le souci pédagogique qui anime l’auteur est celui de l’enseignement du peuple, des catégories sociales ouvrières. En quoi l’enseignement public ne remplit-il pas pleinement son rôle émancipateur et a-t-il au contraire souvent un effet d’aliénation, d’asservissement des classes inférieures par une élite ?
Malgré l’habitude contemporaine très critique à l’égard des professeurs et de l’école, cette évidente baisse du niveau scolaire moyen, la dénonciation et la critique radicale du cadre traditionnel de l’enseignement, de son exigence théorique ou formelle, l’autorité du maître, l’obéissance de l’enfant, son inefficacité en termes d’ascension sociale, la reproduction de classes sociales suivant leur patrimoine culturel (mise en évidence par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron dans Les Héritiers en 64, puis dans La Reproduction en 70 ; exception faite de quelques transclasses qui légitiment justement ce système déficient), a de quoi choquer. Tout lecteur, étant passé par le cadre de l’école, et de toute évidence y ayant réussi (ne serait-ce qu’à avoir une maîtrise suffisante du langage intellectuel pour lire ce livre), pourrait se sentir attaqué, considérer comme absurde – anarchiste, utopiste – l’idée qu’on puisse apprendre mieux sans école, sans le maître, sans son autorité sans la discipline, la punition, les règles claires… qu’on puisse se passer de l’école puisque l’école les a formés et a grandement participé à leur réussite sociale. L’institution scolaire est vue logiquement, même dans sa forme traditionnelle autoritaire et excluante, comme un progrès humain déterminant, comme un outil de civilisation, comme un outil d’ascension sociale… Il suffit à l’élève d’être sage et de travailler… Or, avoir appris à lire et écrire, compter, n’est pas une garantie de libération, mais peut même devenir une nouvelle manière d’être asujetti (par intériorisation d’une infériorité intellectuelle par l’échec scolaire). Cette remise en question du bien-fondé de l’éducation nationale rejoint la pensée d’Ivan Illich, Une société sans école (1971). Rancière pointe les mêmes dysfonctionnements dus à l’institutionnalisation, l’idéologie qui est au coeur du projet éducatif et qui se mêle insidieusementse à l’instruction, ce but de former un employé docile, obéissant, reconnaissant l’autorité, la supériorité de certaines fonctions sociales, de certains savoirs sur d’autres, donc de certains citoyens sur d’autres (on pensera ici au slogan de La Ferme des animaux, de Orwell : « all animals are equals, but some animals are more equals »).
Cet objectif pleinement idéologique de former de bons citoyens suivant les normes établies et fixées par un gouvernement, de former une élite en termes de savoirs et savoir-faire idéologiquement jugés comme supérieurs, pervertit toute bonne initiative pédagogique (ce qui se vérifie aujourd’hui où nombre des principes alternatifs – pédagogie par l’action, le projet, induction, co-construction du cours, classe inversée, différenciation et le plus représentatif, la bienveillance – ont été adoptés sans réels résultats). Par exemple, le principe de différenciation, très utilisé aujourd’hui pour tenir compte des spécificités des élèves (déficits, dyslexie, autisme, hyperactivité, peu francophones…) qui est conçu justement dans le but noble de remettre l’élève au centre de son apprentissage, pour construire un enseignement adapté et motivant, devient simplement un faux-semblant de progrès permettant d’intégrer tout type d’élève dans des classes normales et donc de retirer les investissements de cadres pédagogiques spécialisés, pris en charge par des enseignants formés, reconnus et payés à hauteur de leurs compétences. Le programme rigide, les coefficients alloués aux matières, le rythme scolaire annuel, les classes d’âge, les examens, rendent toute pratique de différenciation inutile et même peut-être contre-productive (car l’enseigneant affecte de considérer la différence des élèves alors qu’il n’a pas forcément la compétence pour aider, et que ceux-ci seront dans l’ensemble du système notés, classés, orientés, écartés selon une norme bien déterminée).
L’émancipation ne peut pas se faire tant que le principe premier de l’éducation nationale est de normaliser, de formater des élèves sages, dociles, reconnaissant l’autorité indiscutable de la norme, des discoureurs qui se disputent sur une solution sans questionner le problème (qui agissent toujours dans le cadre imposé par un maître reconnu de fait). Critiquer le dispositif traditionnel de la personne qui sait devant ceux qui doivent se taire et apprendre, c’est critiquer la relation hiérarchique par excellence qui étant légitimée, transférera une telle légitimité dans le monde du travail, dans la société, entre les décideurs et leurs sujets, les patrons et les employés, les expérimentés et les débutants, les riches ayant réussi et les pauvres, entre les parents et les enfants… des rapports humains de domination. Redéfinir cette relation primordiale, c’est repenser les rapports humains. En cela, on retrouve les conceptions très humanistes du travail émancipateur chez Marx (par exemple dans ses Manuscrits parisiens). Une personne active, actrice de l’orientation de son travail, participant à sa hauteur et selon ses aptitudes à une oeuvre collective, se réalise en tant qu’être humain par son travail, s’émancipe, au lieu d’être dans un rapport de force, de subordination, d’intérêt, vecteur de frustration. Ainsi, le respect au professeur ne doit pas être un respect forcé de la fonction, mais un respect de l’humain, de l’altérité.
C’est ainsi que le principe primordial d’émancipation que tire Rancière de cette recherche et sur lequel il propose de réfléchir est celui de l’égalité fondamentale entre tous, de tout temps et de tout lieu. Cette affirmation est évidemment paradoxale. Comment ne pas constater les différences de capacité, de talent ? Les aptitudes à réaliser une tâche ? Comment ne pas considérer certains comportements comme moins bons que d’autres ? Or, c’est bien là pour lui une des bases de naissance des inégalités : la valeur qu’on attribue à telle compétence, à telle fonction sociale, à tel savoir plutôt qu’à tel autre, est relative à une idéologie, une idéologie dominante. La hiérarchie des intelligences est donc toute relative. Les anthropologues ont admis comme principe d’analyse ce refus de hiérarchiser les sociétés, de juger des comportements qui paraissent moins bons par rapport à des repères idéologiques qui ont été formés justement en grande partie par l’éducation (refus de l’ethnocentrisme), justement pour mieux comprendre le fonctionnement et la logique globale d’une société. Faire taire cette hiérarchie des connaissances et des fonctions est le plus sûr moyen de saisir la cohérence des motivations et la logique propre d’un apprenant et de le mener de ses intérêts précoces d’enfant à une curiosité culturelle étendue rejoignant le collectif, l’abstrait, l’intellectuel…
Un autre point qui semble fondamental pour Rancière est le rôle de la parole qu’il choisit de qualifier de poétique (au sens de personnalisée, renvoyant à la spécificité de chacun, à son émotion, sa perception subjective), par opposition à un langage qui se voudrait scientifiquement universel (un mot, un concept bien défini, indiscutable). Ce point découle de l’égalité préalable des intelligences : la parole de certains individus, au prétexte qu’ils ne s’expriment pas avec les concepts qui font autorité, avec des mots autorisés, serait invalidée, inférieure. Non pas invalidée pour son contenu (reconnu car discuté, pesé et éventuellement écarté par la communauté de discours), mais pour sa forme, moins noble. Or, l’une des conditions d’émancipation d’un individu est bien la prise en compte de sa parole singulière, de son expérience singulière, par la communauté. Dès lors, l’une des caractéristiques fondamentales d’une pédagogie émancipatrice serait la place accordée à l’expression poétique par l’élève de son expérience d’apprentissage (Ce que le management nomme feedback, utilisé comme outil d’optimisation, ce que les ateliers d’écriture placent au centre du processus créateur-libérateur, comme discussion libre). Dès lors, c’est tout une révision de l’acte pédagogique que propose Rancière : lire, écrire, traiter d’un problème, ne serait plus appliquer des principes et utiliser des connaissances universelles extérieures à soi afin de donner une réponse validée par une instance supérieure, mais agir, essayer, rendre compte, traduire par ses propres mots une expérience humaine personnelle, et faire reconnaître par la discussion avec le groupe, la validité, l’universalité ou l’originalité de ce qu’on a vécu.
Passages retenus
De la culture de la hiérarchie sociale, p. 70 :
Ainsi va la croyance en l’inégalité. Point d’esprit supérieur qui n’en trouve un plus supérieur pour le rabaisser ; point d’esprit inférieur qui n’en trouve un plus inférieur à mépriser. La toge professorale de Louvain est bien peu de choses à Paris. Et l’artisan de Paris sait combien lui sont inférieurs les artisans de province qui savent, eux, combien les paysans sont arriérés. Le jour où ces derniers penseront qu’ils connaissent, eux, les choses, et que la toge de Paris abrite un songe-creux, la boucle sera bouclée. L’universelle supériorité des inférieurs s’unira à l’universelle infériorité des supérieurs où nulle intelligence ne pourra se reconnaître dans son égale. Or la raison se perd là où un homme parle à un autre homme qui ne peut lui répliquer. « Il n’y a pas de plus beau spectacle, il n’y en a pas de plus instructif que le spectacle d’un homme qui parle. Mais l’auditeur doit se réserver le droit de penser à ce qu’il vient d’entendre et le parleur doit l’y engager (…) Il faut donc que l’auditeur vérifie si le parleur est actuellement dans sa raison, s’il en sort, s’il y rentre. Sans cette vérification autorisée, nécessitée même par l’égalité des intelligences, je ne vois, dans une conversation, qu’un discours entre un aveugle et son chien. » (Jacotot, Journal de l’émancipation intellectuelle, t. III, 1835-1836, p. 334)
Réponse à la fable de l’aveugle et du paralytique, l’aveugle parlant à son chien est l’apologue du monde des intelligences inégales. On voit qu’il s’agit de philosophie et d’humanité, non de recettes de pédagogie enfantine. L’enseignement universel est d’abord l’universelle vérification du semblable que peuvent faire tous les émancipés, tous ceux qui ont décidé de se penser comme des hommes semblables à tout autre.
L’homme est un animal poétique, p. 109-110 :
Pour [les profanes], comme pour tout être raisonnable, reste donc ce mouvement de la parole qui est à la fois distance connue et soutenue à la vérité et conscience d’humanité, désireuse de communiquer avec les autres et de vérifier avec elles sa similitudes. « L’homme est condamné à sentir et à se taire ou, s’il veut parler, à parler indéfiniment puisqu’il a toujours à rectifier en plus ou en moins ce qu’il vient de dire (…) parce que, quelque chose qu’on en dise, il faut se hâter d’ajouter : ce n’est pas cela ; et, comme la rectification n’est pas plus entière que le premier dire, on a, dans ce flux et dans ce reflux, un moyen perpétuel d’improvisation. » (J. Jacotot, Droit et philosophie panécastique, Paris, 1938, p. 231)
Improviser est, on le sait, un des exercices canoniques de l’enseignement universel. Mais c’est d’abord l’exercice de la vertu première de notre intelligence : la vertu poétique. L’impossibilité où nous sommes de dire la vérité, quand même nous la sentons, nous fait parler en poètes, raconter les aventures de notre esprit et vérifier qu’elles sont comprises par d’autres aventuriers, communiquer notre sentiment et le voir partagé par d’autres êtres sentants. L’improvisation est l’exercice par lequel l’être humain se connaît et se confirme dans sa nature d’être raisonnable, c’est-à-dire d’animal « qui fait des mots, des figures, des comparaisons, pour raconter ce qu’il pense à ses semblables » (Jacotot, Enseignement universel. Musique, 3e éd., Paris, 1830, p. 163). La vertu de notre intelligence est moins de savoir que de faire. « Savoir n’est rien, faire est tout ». Mais ce faire est fondamentalement acte de communication. Et, pour cela, « parler est la meilleure preuve de la capacité de faire quoi que ce soit. » Dans l’acte de parole, l’homme ne transmet pas son savoir, il poétise, il traduit et convie les autres à faire de même.
Société d’égalitaires, p. 120-121 :
On peut ainsi rêver d’une société d’émancipés qui seraient une société d’artistes. Une telle société répudierait le partage entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, entre ceux qui possèdent ou ne possèdent pas la propriété de l’intelligence. Elle ne connaîtrait que des esprits agissants : des hommes qui font, qui parlent de ce qu’ils font et transforment ainsi toutes leurs œuvres en moyens de signaler l’humanité qui est en eux comme en tous. De tels hommes sauraient que nul ne naît avec plus d’intelligence que son voisin, que la supériorité qu’un tel manifeste est seulement le fruit d’une application à manier les mots aussi acharnée que l’application d’un autre à manier les outils ; que l’infériorité de tel autre est la conséquence de circonstances qui ne l’ont pas contraint à en chercher davantage. Bref, ils sauraient que la perfection mise par tel ou tel à son art propre n’est que l’application particulière du pouvoir commun à tout être raisonnable, celui que chacun éprouve, lorsqu’il se retire dans ce huis clos de la conscience où le mensonge n’a plus de sens. Ils sauraient que la dignité de l’homme est indépendante de sa position, que « l’homme n’est pas né pour telle position particulière mais pour être heureux en lui-même indépendamment du sort. (Joseph Jacotot, Enseignement universel. Langue maternelle, 6e éd., Paris, 1836, p. 243) » et que ce reflet de sentiment qui brille dans les yeux d’une épouse, d’un fils ou d’un ami chers présente au regard d’une âme sensible assez d’objets propres à le satisfaire.
Dénonciation de la prétention scientifique et objective du langage, p. 141 :
A ce langage figuré, ce langage de la religion et de la poésie, dont la figuration permet à l’intérêt déraisonnable tous les travestissements, il est possible d’opposer un langage vrai où les mots recouvrent exactement les idées.
Jacotot récuse un tel optimisme. Il n’y a pas de langage de la raison. Il y a seulement un contrôle de la raison sur l’intention de parler. Le langage poétique qui se connaît comme tel ne contredit pas la raison. Au contraire, il rappelle à chaque sujet parlant de ne pas prendre le récit des aventures de son esprit pour la voix de la vérité. Tout sujet parlant est le poète de lui-même et des choses. La perversion se produit quand ce poème se donne pour autre chose qu’un poème, quand il veut s’imposer comme vérité et forcer l’acte. La rhétorique est une poétique pervertie.
p. 194-195 :
Guerres et révolutions, en changeant la forme et les limites des empires, changent la nature des explications dominantes. Mais ce changement est circonscrit dans des limites étroites. Nous savons en effet que l’explication est un travail de paresse. Il lui suffit d’introduire l’inégalité, et cela se fait à moindre frais. La plus élémentaire hiérarchie est celle du bien et du mal. Le plus simple rapport logique qui puisse servir à l’expliquer est celui de l’avant et de l’après. Avec ces quatre termes, le bien et le mal, l’avant et l’après, on a la matrice de toutes les explications. Cela était mieux avant, disent les uns : le législateur ou la divinité avait arrangé les choses ; les hommes étaient frugaux et heureux ; les chefs paternels et obéis ; la foi des ancêtres respectée, les fonctions bien distribuées et les cœurs unis. Maintenant les mots se corrompent, les distinctions se brouillent, les rangs se confondent et la sollicitude pour les petits se perd avec le respect des grands. Tâchons donc de conserver ou de revivifier ce qui, dans nos distinctions, nous rattache encore au principe de bien. Le bonheur est pour demain, répondent les autres : le genre humain était comme un enfant livré aux caprices de son imagination, bercé par des contes de nourrices ignares, assujetti à la force brutale des despotes et à la superstition des prêtres. Maintenant, les esprits s’éclairent, les mœurs se civilisent, l’industrie répand ses bienfaits, les hommes connaissent leurs droits et l’instruction leur révélera leurs devoirs avec les sciences. C’est la capacité désormais qui doit décider des rangs sociaux. Et c’est l’instruction qui la révélera et la développera.
p. 228 :
L’important, la manifestation de la liberté, était ailleurs : dans l’art égal que, pour soutenir ces positions antagonistes [liberté de dire limitée ou non à ce qu’on a droit de dire], les uns traduisaient des autres ; dans l’estime née de cette comparaison pour ce pouvoir de l’intelligence qui ne cesse de s’exercer au sein même de la déraison rhétorique ; dans la reconnaissance de ce que parler peut vouloir dire pour qui renonce à la prétention d’avoir raison et de dire la vérité au prix de la mort de l’autre. S’approprier cet art, conquérir cette raison, c’était cela qui comptait pour les prolétaires. Il faut être homme avant d’être citoyen. « quelque parti qu’il puisse prendre comme citoyen dans cette lutte, comme panécasticien, il doit admirer l’esprit de ses adversaires. Un prolétaire, rejeté hors de la classe des électeurs, et à plus forte raison de celle des éligibles, n’est pas obligé de trouver juste ce qu’il regarde comme une usurpation ni d’aimer les usurpateurs. Mais il doit étudier l’art de ceux qui lui expliquent comment on le dépouille pour son bien. » (Droit et philosophie panécastique, Paris, 1938, p. 293)