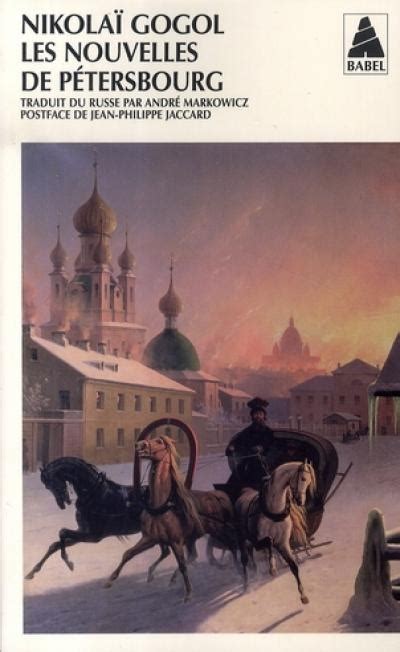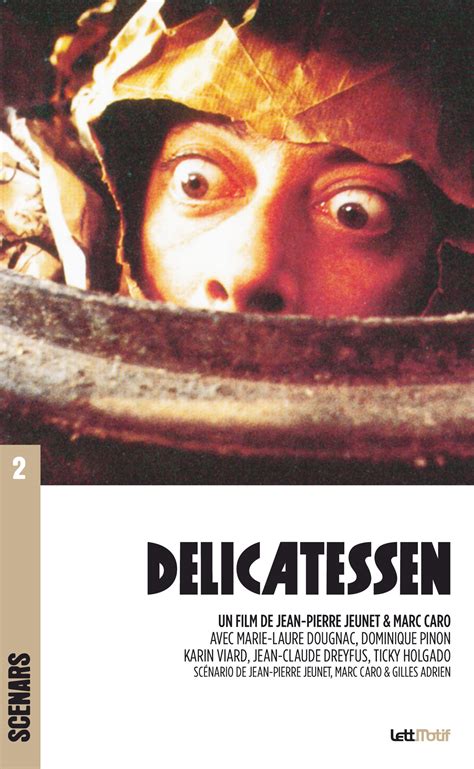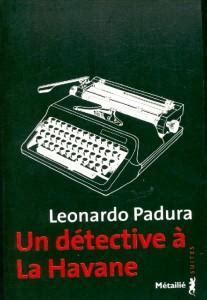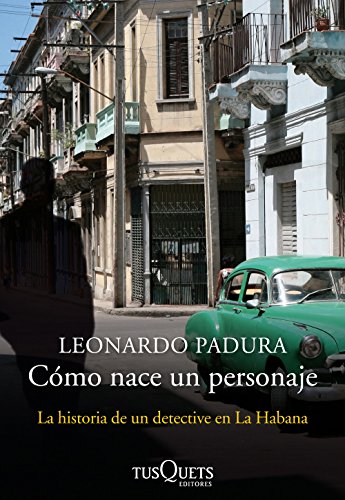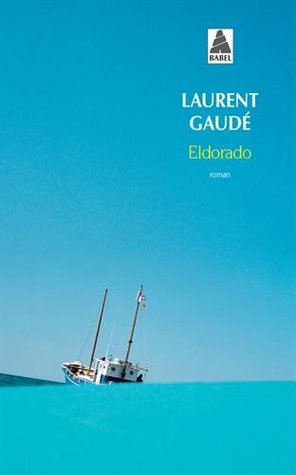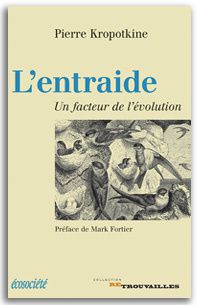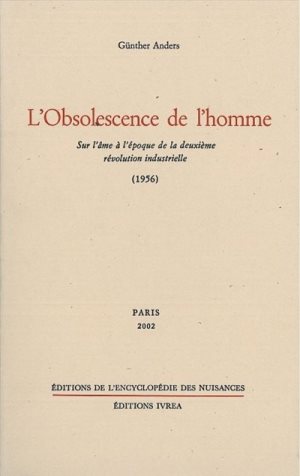Diffusion de l’idéologie courtoise par le roman de chevalerie : pour une nouvelle noblesse de l’âme
Chrétien de Troyes 1180-1190, Perceval ou le Conte du Graal [in Perceval le Gallois, t. 2 : le poème], éd. Dequesne-Maquillier (Mons), 1866
Texte original disponible sur Gallica. Les versions modernisées destinées à la scolarité sont largement amputées (le presque-viol de la femme de chevalier qu’il rencontre sous la tante, et surtout les aventures de Gauvin, supposées servir de modèle à celles de Perceval, restant à écrire).
Résumé
Le jeune Perceval, que sa mère a fait grandir dans la forêt, loin de la vie militaire qui a tué père et frères, croise un jour des chevaliers et s’émerveille. Il quitte sa mère pour rejoindre la cour du roi Arthur. Son ignorance des règles de la cour lui attire des moqueries, mais une jeune fille lui prédit un grand avenir. Il tue le chevalier Vermeil et lui vole ses armes pensant ainsi devenir un chevalier. Mais la vaillance n’est pas suffisante. C’est l’ancien chevalier Gornemant qui se charge de lui apprendre le code de la chevalerie.
Commentaires
Sans doute en cours d’écriture à la mort de Chrétien de Troyes (aucune œuvre contemporaine ne mentionne le récit complet), ce roman semble à peine ébaucher la quête du Graal promise… Serait-on en face d’un début d’épopée ? La popularité de l’auteur, les thèmes et tout ce qui restait à écrire ont motivé de nombreux auteurs à en écrire la suite. En cela, Le Conte du Graal représente à merveille la littérature du Moyen-Âge et sa composition très souvent collective (divers auteurs, puis conteurs, trouvères et jongleurs, qui écrivent, modifient, complètent, adaptent, traduisent ou transcrivent… – chaque poète se permettant d’ajouter un épisode inédit – et réalisent une légende par constellation d’ouvrages truffés de variantes – complétés d’illustrations, de peintures, de broderies, sculptures… ). C’est sans doute le roman qui a marqué et imposé la vision des chevaliers jusqu’à aujourd’hui. L’imaginaire du temps des chevaliers est vendu aux enfants comme partie de l’histoire du Moyen-Âge. Films, Playmobil, déguisements, jeux de société… La féerie qui habite le récit a inspiré la naissance du genre de la fantaisie héroïque, les plus célèbres étant Le Seigneur des anneaux de Tolkien et Le Trône de fer de George R. R. Martin. Pourtant, on sait très bien aujourd’hui que d’un point de vue historique, le monde des chevaliers ainsi présenté n’a jamais existé (« ça ne s’est pas passé comme ça », comme le dit Therry Jones des Monty Mython dans la superbe série-documentaire Sacré Moyen-Âge, 2004). Pourquoi donc cette affabulation ?
Les figures héroïques de la chevalerie sont effectivement fausses mais ont pour objectif essentiel d’influencer les comportements, de diffuser un nouveau modèle positif du seigneur noble, de manière à changer la société de Cour. Les chevaliers de la cour d’Arthur se battent contre d’autres chevaliers sans valeur (mauvais) – il y a une allégorie du combat culturel que mènent les troubadours/trouvères (nobles qui prennent la plume en dépit des mauvaises considérations pour ce métier manuel) pour l’éducation de leurs pairs (C’est pourquoi le Don Quichotte de Cervantès, tout en se moquant de la fausseté des romans de chevalerie, souligne la noblesse et la richesse du rêve naïf et utopique de Quichotte). Comme l’explique bien Tzvétan Todorov dans Critique de la critique (1984), le discours littéraire a davantage à voir avec les discours de croyance, mythologie, fable… qu’avec le discours de vérité, histoire et sciences. Il a donc pour fonction de représenter, d’exprimer les aspirations, les rêves, les ressentiments, des hommes, davantage que leur réalité.
Les chevaliers, bien que de familles importantes, recevaient alors peu d’éducation, ils ne connaissaient pas le latin ou très peu, ne savaient donc ni lire ni écrire. Ils étaient plutôt militaires, préoccupés d’expéditions visant à l’enrichissement, à l’accroissement du domaine de seigneurie… Et quand ils revenaient de guerre, ils festoyaient dans des banquets dignes de nos ancêtres les Gaulois. Ils n’allaient à l’Église que pour suivre les traditions et non par foi. Les valeurs chrétiennes avaient peu cours sur le champ de bataille : l’on épargnait les ennemis seulement dans le but de réclamer rançon. Les chevaliers s’occupaient peu d’aller délivrer des princesses enfermées dans des tours ou de faire une cour avancée à des femmes mariées, les mariages étant souvent arrangés pour raisons politiques, empêcher une guerre, étendre un domaine et donc concurrencer celui d’un autre seigneur, les autres femmes étaient du butin de guerre ou se prenaient si l’occasion se présentait… En cela, malgré les exagérations, le monde de la chevalerie était mieux représenté par les chansons de geste (comme Raoul de Cambrai), leurs milliers de morts, le patriotisme et les alliances, les vengeances et les trahisons, les croisades pour raison politique ou d’enrichissement… Comment réformer cette culture de la virilité, de la possession par la violence, du machisme du plus grand territoire et de la plus grande lance ?
La courtoisie qui s’exprime dans les romans de chevalerie est un mouvement culturel visant à passer de l’aristocratie militaire (légitimation des privilèges par la force) à une aristocratie de l’éducation (légitimation par l’éducation) : la parole sûre et prudente, la politesse, la galanterie, la pitié, la charité chrétienne, la défense du bien et des faibles…
Perceval ou le Conte du Graal est à sa manière un roman d’apprentissage. Apprentissage des codes de la chevalerie et de la Courtoisie chrétienne. Le personnage de Perceval est un jeune homme, grandi dans la naïveté, loin du monde militaire. Il a ainsi le cœur naïf, pur (à la manière des personnages de Dragon Ball ou One Piece). Il représenterait volontiers le lecteur ou le jeune noble auditeur du roman mais sa totale naïveté le place également dans une position d’objet de moquerie. Le comique du roman, tel que serait celui de Candide, ou celui d’un Pierre Richard, est basé sur le rire provoqué par l’inadaptation du personnage à cet environnement. Son comportement fait rire même les jeunes qui ont tout de même une idée du monde de la chevalerie. Il va recevoir les apprentissages de la vie et de son rôle social par différentes méthodes pédagogiques complémentaires : l’amour maternel (instruction traditionnelle par l’amour et l’autorité familiale) qui marque sa sensibilité, l’autorité de l’expérience du vieux chevalier, l’apprentissage par l’action et par la leçon de l’erreur, le modèle de Gauvain le parfait chevalier comme un artisan confirmé dont l’apprenti doit observer et imiter les gestes. Une dernière technique d’apprentissage pourrait être la révélation : que ce soit l’apparition du roi pêcheur qui pourrait être simplement vécue comme un rêve, ou le signe de l’hirondelle blessée dans la neige qu’on pourrait ne pas voir, l’extraordinaire bouleverse le jeune et doit l’élever à un autre niveau de sensibilité, d’amour et d’ambition, un esprit supérieur doté des valeurs chrétiennes. Le Graal, qui deviendra concrètement un symbole chrétien (le saint calice) dans l’oeuvre de Robert de Boron (l’un des premiers continuateurs), n’est-il pas le symbole de cette accession à un autre niveau d’humanité ? Au début du roman, Perceval est moqué alors même qu’il possède les valeurs guerrières tant reconnues de son époque, mais celles-ci le mènent à l’échec et au malheur. Il ne triomphera et ne deviendra légende qu’en portant à travers sa quête du Graal les valeurs de la courtoisie et de la chevalerie.
Passages retenus
Apparition du Graal et importance de questionner l’inconnu, v. 4368-4429 :
Que qu’il parolent d’un et d’el,
Uns varlés d’une cambre vint,
Qui une blance lance tint,
Empoignie par emmi leu ;
Si passa par entre le feu
Et cil ki sor le lit séoient,
Et tout cil ki laiens estoient
Virent la lance et le fer blanc :
S’en ist une goute de sanc
Del fer de la lance el somet,
Et, jusqu’à la main au varlet,
Couloit cele goute vermelle.
Li varlés voit cele mervelle,
Qui laiens ert noviaus venus ;
Si s’est del demander tenus
Coment celle chose avenoit ;
Que del casti li souvenoit
Celui ki chevalier le fist,
Ki li ensegna et aprist
Que de trop parler se gardast ;
Et crient, se il le demandast,
C’on le tenist à vilounie ;
Pour çou ne le demanda mie.
Atant dui varlet à lui vinrent,
Qui candelers en lor mains tinrent
De fin or ouvret à chisiel ;
Li varlet estoient moult biel,
Qui les candelers aportoient ;
En cascun candelles ardoient,
X candoiles à tout le mains.
Un graal entre ses II mains
Une demoisièle tenoit
Qui avoec les varlés venoit,
Bièle, gente et acesmée ;
Quant ele fu laiens entrée
Atout le graal qu’ele tint,
Une si grans clartés i vint
Que si pierdirent les candoiles
Lor clarté com font les estoiles
Quant le solaus liève ou la lune ;
[…]
Ensi come passa la lance,
Par devant le lit s’en pasèrent
Et d’une cambre en l’autre entrèrent ;
Et li varlés les vit passer
Et n’osa mie demander
Del graal, qui on en servoit ;
Que tous jors en son cuer avoit
La parole au preudome sage ;
Si crient que il n’i ait damage,
Pour çou qu’il a oï retraire
C’ausi bien se puet-on trop taire
Com trop parler à la foïe
Tandis qu’ils parlaient de ci et de ça, un valet arriva d’une chambre. Il tenait une lance blanche, empoignée par son milieu. Ainsi il passa entre le feu et ceux qui étaient assis sur le divan. Et tous ceux qui étaient là virent la lance et le fer blanc : il en sortit une goutte de sang et cette goutte vermeille coula depuis le fer de la lance en son extrémité jusqu’à la main du garçon. Le jeune homme vit cette merveille, mais il était nouveau venu ici. Aussi s’est-il tenu de demander comment cette chose se faisait, car il avait le souvenir de celui qui le fit chevalier et qui lui enseigna à se garder de trop parler. Et c’est pour cela que, croyant que si il posait des questions on le tiendrait pour mal éduqué, il ne posa pas de question. C’est alors que dix valets vinrent à lui qui tenaient dans leurs mains des chandeliers d’or travaillé et coupé finement. Ils étaient bien beaux, ces jeunes garçons qui apportaient les chandeliers. Sur chacun brûlaient plusieurs chandelles, dix chandelles au moins. Une jeune fille belle, digne et élégante venait avec les valets, elle tenait un graal entre ses deux mains. Quand elle fut entrée dans la pièce, avec le graal qu’elle tenait, une si grande clarté en vint que les chandelles perdirent aussitôt leur clarté, comme le font les étoiles quand le soleil se lève, ou la lune. […] Tout comme était passée la lance, ils passèrent devant le divan et entrèrent dans la pièce voisine. Et le jeune homme les vit passer et n’osa aucunement demander au sujet du graal, qui on allait servir. Il avait toujours eau cœur les paroles du sage vénérable. Cependant, on peut craindre qu’il y ait malheur, parce qu’il a entendu exposer qu’on peut aussi bien trop se taire que trop parler.
Le départ et l’abandon de la mère, v. 1799-1828 :
Et partout là ù il aloit
III gaverlos porter soloit ;
Ses gaverlos en vot porter,
Mais II l’en fist la mère oster
Por ce que trop sanlast Galois ;
Si éust-elle fet tous trois
Moult volentiers, s’il péust estre.
Une roote en sa main destre
Porta, por son ceval férir.
Plorant le baise au départir
La mère, qui moult cier l’avoit,
Et prie Dieu que il l’avoit :
« Biaus fius, fait-ele, Dex vos maint !
Joie plus qu’il ne m’en remaint
Vos doinst-il, quanque vos aliés ! »
Quant li vallés fu eslongiés
Le get d’une pière menue,
Se retorne et si voit chéue
Sa mère au cief del pont arrière,
Et giut pasmée en tel manière
Com s’ele fust kéue morte.
Et cil feroit, de la roote,
Son cacéour parmi la crupe ;
Et cil s’en va, ki pas n’agrupe,
Ains l’enporte, grant aléure,
Parmi la grant foriest oscure,
Et chevauce très le matin
Tant ke li jors vint à déclin.
En la foriest, cele nuit, jut,
Tant que li jors clers aparut.