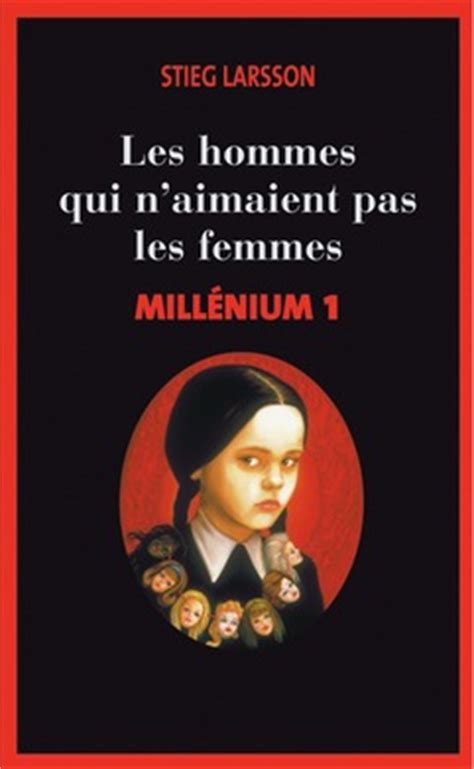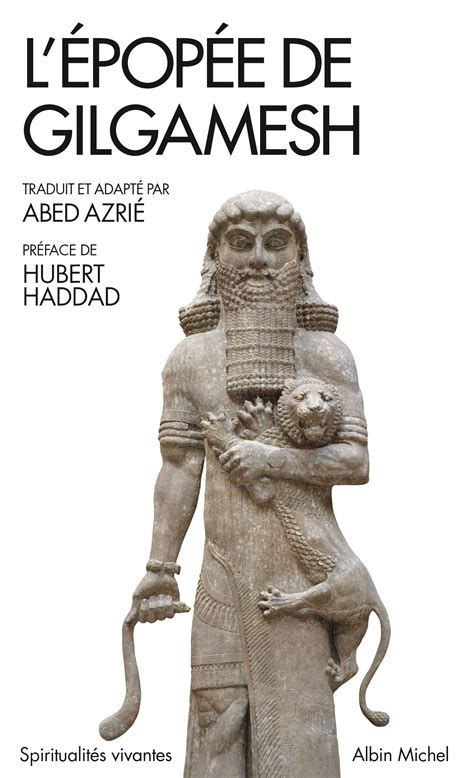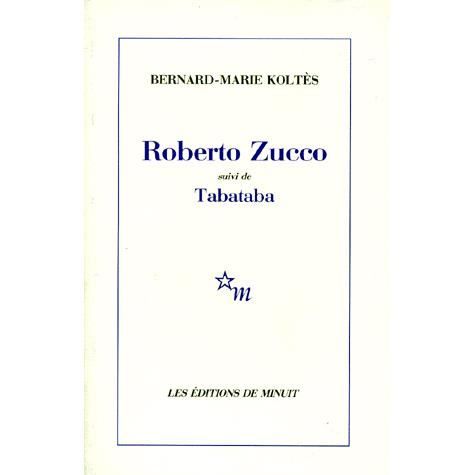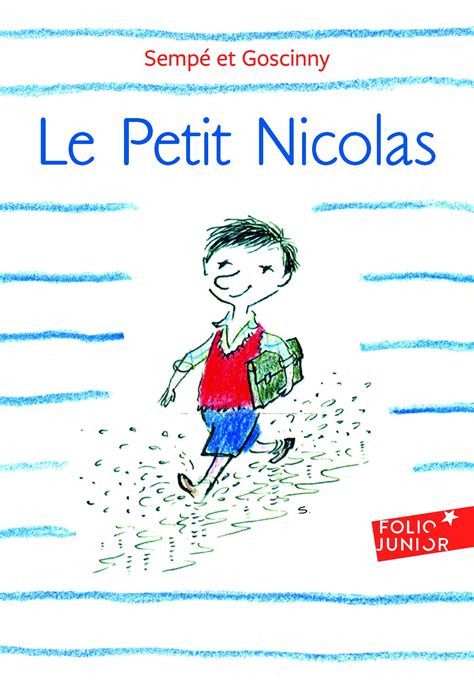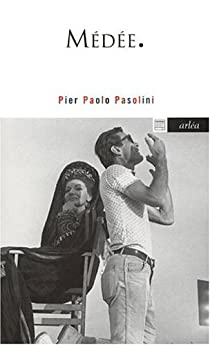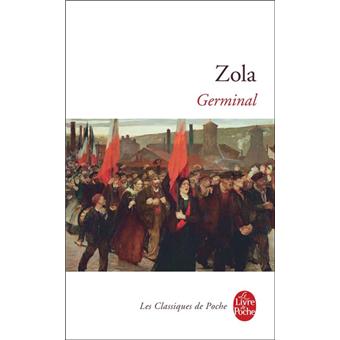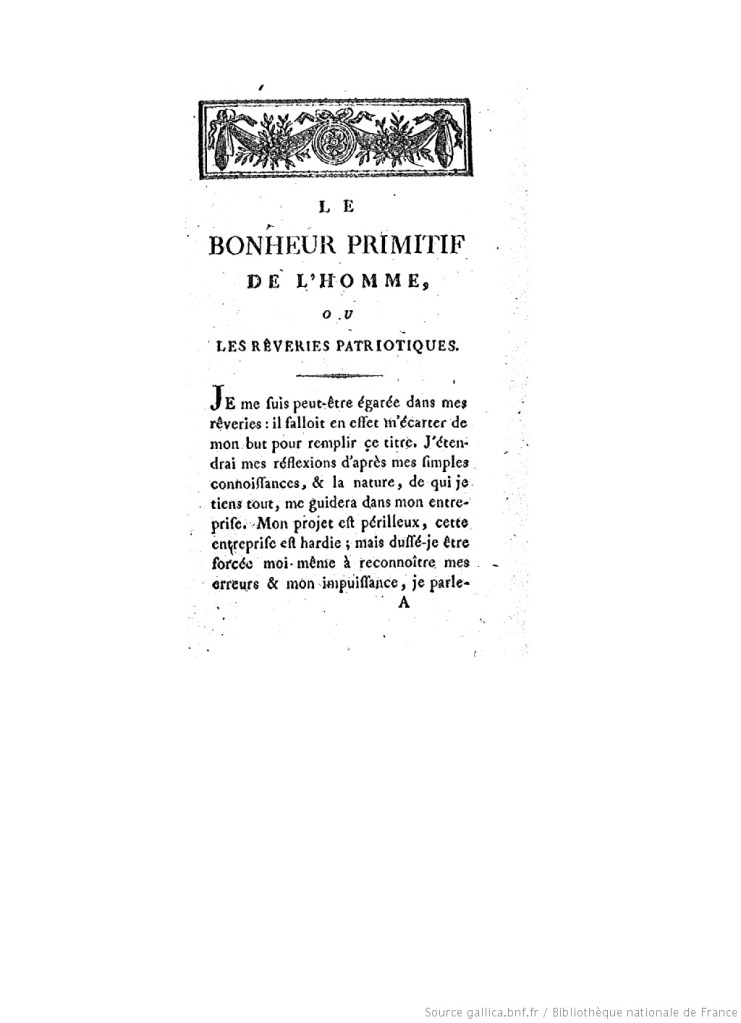Ces valeurs qui dépassent l’individu
Simone Weil, La personne et le sacré (1943), Payot & Rivages, coll. Petite Bibliothèque, 2017
L’auteure : Simone Weil
Née à Paris, d’un père d’une famille d’origine juive alsacienne et d’une mère d’origine juive de Rostov en Russie. La famille suit les affectations du père chirurgien-militaire. Elle ne reçoit aucune instruction religieuse et obtient le baccalauréat à seize ans et entre en hypokhâgne au lycée Henri-IV où elle assiste aux cours d’Alain et croise Simone de Beauvoir. Elle est reçue septième à l’agrégation de philosophie à 22 ans.
Professeure au lycée de Puy-en-Velay en 32-33, elle se montre solidaire des mouvements de grève des ouvriers. Elle vit avec le minimum des chômeurs et donne le reste à la Caisse de Solidarité. Elle écrit dans diverses revues syndicalistes comme L’École émancipée ou la Révolution prolétarienne, participe au Cercle communiste démocratique de Souvarine, mais se montre critique envers le régime de Staline et critique le communisme devant Trotski.
En 34, elle met de côté sa carrière et se fait ouvrière chez Alsthom à Paris, puis à la chaîne aux Forges à Boulogne-Billancourt, et comme fraiseuse chez Renault. Elle note toutes ses impressions dans son Journal d’usine. En 36, malgré son pacifisme, elle se rend en Catalogne pendant la guerre d’Espagne et intègre la colonne Durruti, mais revient déçue des divisions des gauches. Elle abandonne le rationalisme d’Alain et se rapproche du christianisme.
Pendant la guerre, exclue de l’université, elle passe six mois comme fille de ferme en Ardèche chez le philosophe Gustave Thibon. Elle rejoint la France libre à Londres mais on lui refuse de participer aux forces de la Résistance, autre que par ses articles, en raison de sa santé. En 43, on la déclare tuberculeuse, elle décède à l’hôpital quelques mois plus tard.
À l’exception de ses articles, son œuvre a été publiée après sa mort.
Résumé
Simone Weil veut montrer que la défense des droits de l’homme, l’homme en tant que personne ayant des droits, est certes importante, mais que c’est une erreur de penser que ces droits sont sacrés, que la personne humaine est sacrée, au-dessus de tout. Ce qui est sacré, ayant bien plus de valeur, , c’est justement ce qui le dépasse, qui transcende l’individu, qui n’est pas propre à sa personne, ce qui est au contraire impersonnel : l’humanité, la justice, la liberté…
Ce qui veut dire qu’éveiller les gens au respect de ces grandes valeurs aura beaucoup plus d’effet, de bonnes répercussions sur la société, que de les appeler à respecter les droits de chacun.
Appréciations
Ce petit essai, écrit l’année de sa mort, parmi les Écrits de Londres, peut tout d’abord être aisément rapproché de l’Homme révolté, d’Albert Camus, publié en 51, huit ans plus tard, dans lequel il pose que la révolte de l’esclave intervient au moment où l’homme est prêt à sacrifier sa vie, sa personne, pour défendre ce qu’il estime le dépasser, ce qui fait l’humain, sa dignité. Ainsi, l’esclave peut accepter de voir ses droits bafoués, mais pas l’essence de ce qui fait de lui un être humain. Mais la pensée de Simone Weil prend une autre direction. Là où Camus interroge les limites de la révolte, Simone Weil cherche à définir cette essence de l’humain, ce sacré, tout en l’insérant dans les conflits sociaux, la vie quotidienne, la défense des faibles… Elle compare les effets de la défense des droits de la personne et ceux de la défense de valeurs. Les grandes valeurs ont une valeur d’autorité qui l’emportent largement. Ces valeurs essentielles peuvent être vues comme valeurs humanistes ou comme vertus chrétiennes. Car c’est bien ce qui transcende l’être humain, l’amène à dépasser son état d’individu animal, qui intéresse Simone Weil.
On voit dans les luttes récentes contre le racisme (mais également contre les politiques des grandes entreprises), que l’existence d’un droit ne suffit pas à en garantir le respect au sein d’une société. C’est bien la défense de valeurs supérieures qui amène à faire émerger aux yeux de toute une société, l’ampleur et la légitimité d’un problème. La lutte pour la sauvegarde de l’environnement constate depuis des années l’échec de ses combats ponctuels, se heurtant à la plus grande machine qu’est l’économie. L’écologie gagne du terrain depuis qu’elle porte des valeurs universelles de respect de la nature, respect de la vie animale, pour lesquelles des individus sont prêts au sacrifice, à l’image de Greta Thunberg.
Passages retenus
p. 31 : « Excepté l’intelligence, la seule faculté humaine vraiment intéressée à la liberté publique d’expression est cette partie du coeur qui crie contre le mal. Mais comme elle ne sait pas s’exprimer, la liberté est peu de chose pour elle. Il faut d’abord que l’éducation publique soit telle qu’elle lui fournisse, le plus possible, des moyens d’expression. Il faut ensuite un régime, pour l’expression publique des opinions, qui soit moins défini par la liberté que par une atmosphère de silence et d’attention où ce cri faible et maladroit puisse se faire entendre. Il faut enfin un système d’institutions amenant le plus possible aux fonctions de commandement les hommes capables et désireux de l’entendre et de le comprendre.
Il est clair qu’un parti occupé à la conquête ou à la conservation du pouvoir gouvernemental ne peut discerner dans ces cris que du bruit. Il réagira différemment selon que ce bruit gêne celui de sa propre propagande ou au contraire le grossit. Mais en aucun cas il n’est capable d’une attention tendre et divinatrice pour en discerner la signification. »
p. 42 : « De plus, le plus grand danger n’est pas la tendance du collectif à comprimer la personne, mais la tendance de la personne à se précipiter, à se noyer dans le collectif. Ou peut-être le premier danger n’est-il que l’aspect apparent et trompeur du second.
S’il est inutile de dire à la collectivité que la personne est sacrée, il est inutile aussi de dire à la personne qu’elle est elle-même sacrée. Elle ne peut pas le croire. Elle ne se sent pas sacrée. La cause qui empêche que la personne se sente sacrée, c’est qu’en fait elle ne l’est pas.
S’il y a des êtres dont la conscience rende un autre témoignage, à qui leur propre personne donne un certain sentiment de sacré qu’ils croient pouvoir, par généralisation, attribuer à toute personne, ils sont dans une double illusion.
Ce qu’ils éprouvent, ce n’est pas le sentiment du sacré authentique, c’en est cette fausse imitation que produit le collectif. S’ils éprouvent à l’occasion leur propre personne, c’est parce qu’elle a part au prestige collectif par la considération sociale dont elle se trouve être le siège.
Ainsi c’est par erreur qu’ils croient pouvoir généraliser. Quoique cette généralisation erronée procède d’un mouvement généreux, elle ne peut pas avoir assez de vertu pour qu’à leurs yeux la matière humaine anonyme cesse réellement d’être de la matière humaine anonyme. Mais il est difficile qu’ils aient l’occasion de s’en rendre compte, car ils n’ont pas contact avec elle.
Dans l’homme, la personne est une chose en détresse, qui a froid, qui court chercher un refuge et une chaleur. »
p. 47-48 : « Quand on leur parle de leur propre sort, on choisit généralement de leur parler de salaires. Eux, sous la fatigue qui les accable et fait de tout effort d’attention une douleur, accueillent avec soulagement la clarté facile des chiffres.
Ils oublient ainsi que l’objet à l’égard du marchandage, dont ils se plaignent qu’on les force à livrer au rabais, qu’on leur en refuse le juste prix, ce n’est pas autre chose que leur âme.
Imaginons que le diable est en train d’acheter l’âme d’un malheureux, et que quelqu’un, prenant pitié du malheureux, intervienne dans le débat et dise au diable : « Il est honteux de n’offrir que ce prix ; l’objet vaut au moins le double. »
Cette farce sinistre est celle qu’a jouée le mouvement ouvrier, avec ses syndicats, ses partis, ses intellectuels de gauche.
Cet esprit de marchandage était déjà implicite dans la notion de droit que les gens de 1789 ont eu l’imprudence de mettre au centre de l’appel qu’ils ont voulu crier à la face du monde. C’était en détruire d’avance la vertu.
La notion de droit est liée à celle de partage, d’échange, de quantité. Elle a quelque chose de commercial. Elle évoque par elle-même le procès, la plaidoirie. »
p. 51 : « Louer la Rome antique de nous avoir légué la notion de droit est singulièrement scandaleux. Car si on veut examiner chez elle ce qu’était cette notion dans son berceau, afin d’en discerner l’espèce, on voit que la propriété était définie par le droit d’user et d’abuser. Et en fait la plupart de ces choses dont tout propriétaire avait le droit d’user et d’abuser étaient des êtres humains. »
p. 54 : « Si l’on dit à quelqu’un qui soit capable d’entendre : « Ce que vous me faîtes n’est pas juste », on peut frapper et éveiller à la source l’esprit d’attention et d’amour. Il n’en est pas de même de paroles comme : « J’ai le droit de… », « Vous n’avez pas le droit de… » ; elles enferment une guerre latente et éveillent un esprit de guerre. La notion de droit, mise au centre des conflits sociaux, y rend impossible de part et d’autre toute nuance de charité. »
p. 61 : « La possession d’un droit implique la possibilité d’en faire un bon ou mauvais usage. Le droit est donc étranger au bien. Au contraire l’accomplissement d’une obligation est un bien toujours, partout. La vérité, la beauté, la justice, la compassion sont des biens toujours, partout.
Il suffit, pour être sûr qu’on dit ce qu’il faut, de se restreindre, quand il s’agit des aspirations des malheureux, aux mots et aux phrases qui expriment toujours, partout, en toutes circonstances, uniquement du bien.
C’est l’un des deux seuls services qu’on puisse leur rendre avec des mots. L’autre est de trouver des mots qui expriment la vérité de leur malheur ; qui, à travers les circonstances extérieures, rendent sensible le cri toujours poussé dans le silence : « Pourquoi me fait-on du mal ? » »