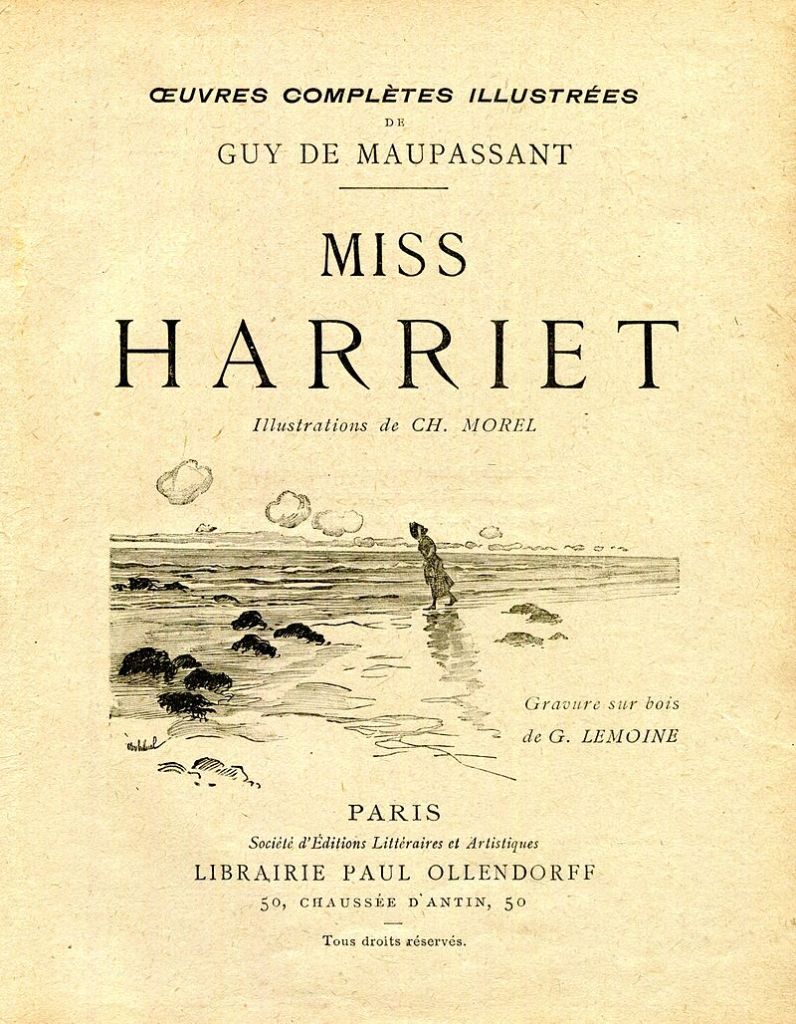
La farce de l’existence
Maupassant (Guy de) 1882-1883, 1988 (1883, 1988), Miss Harriet, in [Oeuvres complètes, t. 1 & 2], Gallimard, coll. « nrf La Pléiade », 1974 & 1979
Recueils :
– Boule de Suif (nouvelle : 1880 ; recueil : 1899)
– La Maison Tellier (1881)
– Mademoiselle Fifi (1882)
– Contes de la bécasse (1883)
– Clair de Lune (1883)
– Miss Harriet (1884)
– Les Sœurs Rondoli (1884)
– Yvette (1884)
– Contes du jour et de la nuit (1885)
– Monsieur Parent (1886)
– Toine (1886)
– La Petite Roque (1886)
– Le Horla (1887)
– Le Rosier de madame Husson (1888)
– La Main gauche (1889)
– Le Père Milon (1889)
Sommaire
– Miss Harriet (1883) ****
– L’Héritage (1884) ****
– Denis (1883) ****
– L’Âne (1883) ****
– Idylle (1884) ***
– La Ficelle (1883) ****
– Garçon, un bock !… (1884) ***
– Le Baptême (1884) ****
– Regret (1883) ****
– Mon oncle Jules (1883) ****
– En voyage (« Le wagon était au complet depuis Cannes… ») (1883) ***
– La Mère Sauvage (1884) ****
Miss Harriet ****
Un jeune peintre errant trouve gîte dans une petite ferme où réside déjà depuis de longs mois une vieille fille anglaise, sensible mais défraîchie, se consolant par la nature et par la foi, de son manque d’amour.
La souffrance de la vieille fille est vertigineuse mais inaccessible (comme elle l’était déjà dans Une vie). La sensibilité extrême à l’origine du tragique suicide restera incompréhensible même pour un sensible comme le peintre. Au dehors ne se manifeste plus qu’une carapace d’automatismes sociaux ridicules, comme de vieux ongles biscornus. Miss Harriet est le prototype de ces vieilles filles qui ne vivent plus tout à fait parmi nous, mais dans une sorte d’intériorité secrète (comme sa soeur de fiction, La Reine Hortense). On peut regretter une sorte d’incohérence de construction des personnages secondaires qui prennent une consistance à la fin alors qu’ils n’en avaient jusqu’alors aucune. Peut-être que c’est le tragique qui les révèle à l’existence.
p. 880 : « Elle était très maigre, très grande, tellement serrée dans un châle écossais à carreaux rouges, qu’on l’eût crue privée de bras si on n’avait vu une longue main paraître à la hauteur des hanches, tenant une ombrelle blanche de touriste. Sa figure de momie, encadrée de boudins de cheveux gris roulés, qui sautillaient à chacun de ses pas, me fit penser, je ne sais pourquoi, à un hareng saur qui aurait porté des papillotes. »
p. 881 : « C’était, en vérité, une de ces exaltées à principes, une de ces puritaines opiniâtres comme l’Angleterre en produit tant, une de ces vieilles et bonnes filles insupportables qui hantent toutes les tables d’hôte de l’Europe, gâtent l’Italie, empoisonnent la Suisse, rendent inhabitables les villes charmantes de la Méditerranée, apportent partout leurs manies bizarres, leurs mœurs de vestales pétrifiées, leurs toilettes indescriptibles et une certaine odeur de caoutchouc qui ferait croire qu’on les glisse, la nuit, dans un étui. »
L’Héritage ****
M. Lesable, commis prometteur au ministère, accepte d’épouser Cora, fraîche et désirable, fille de son collègue Cachelin. Il faut dire que la vieille tante Charlotte possède une fortune colossale… dont Cora est seule héritière. Mais dans le testament de la vieille, le couple a trois ans pour avoir un enfant sinon la fortune ira aux bonnes œuvres.
Reprise du conte Un Million, mais dans une version longue et détaillée. Tout y était déjà. Cette nouvelle plus longue, permet à Maupassant de développer nombre de thèmes qu’il affectionne particulièrement : la vie au ministère (Les Dimanches d’un bourgeois de Paris), la cruauté de la famille bourgeoise qui flaire un héritage (En Famille), la dégradation d’un ménage, l’adultère et l’enfant bâtard… Mais ces trois derniers thèmes passent dans une sorte d’implicite sans conséquence comme si le bonheur bourgeois s’aveuglait naturellement de lui-même afin d’être possible. Il le devient parce que les « affaires sales » paraissent propres, le sont officiellement.
On reprochera justement un peu à ce patchwork de ne pas assez mettre l’accent sur cet assemblage bizarre et immoral que forme ce bonheur bourgeois. La longueur de la nouvelle perd justement cette efficacité éclair de ce qui n’est pas dit.
p. 30 : « Ils regagnaient leur domicile, côte à côte, sans parler, honteux et furieux, comme s’ils s’étaient mutuellement volés. Toute la douleur même de Cora s’était soudain dissipée, l’ingratitude de sa tante la dispensant de la pleurer. »
p. 31 : « Et un malaise l’oppressait, la pensée harcelante, la sensation douloureuse de leur désastre, de cette infortune inattendue, d’autant plus amère et brutale que l’espérance avait été plus vive et plus longue ; et il prononça tout haut, comme on fait dans les grands troubles d’esprit, dans les obsessions d’idées fixes : « Sale rosse ! » »
p. 46 : « Elle se retourna : « Je dis son fait à ce pierrot-là ! » […]
Cachelin déclara : « Si seulement on pouvait divorcer. Ça n’est pas agréable d’avoir épousé un chapon. »
Lesable se dressa d’un bond, tremblant de fureur, éclatant à ce mot. Il marcha vers son beau-père, en bredouillant : « Sortez d’ici !… Sortez !… Vous êtes chez moi, entendez-vous… Je vous chasse… » Et il saisit sur la commode une bouteille pleine d’eau sédative qu’il brandissait comme une massue.
Cachelin, intimidé, sortit à reculons en murmurant : « Qu’est-ce qui lui prend, maintenant ? » […]
Elle se mit à rire.
Devant cette gaieté qui l’insultait encore, il devint fou, et s’élançant, il la saisit au cou de la main gauche, tandis qu’il la giflait furieusement de la droite. Elle reculait, éperdue, suffoquant. Elle rencontra le lit et s’abattit dessus à la renverse. Il ne la lâcha point et frappait toujours. Tout à coup il se releva, essoufflé, épuisé ; et, honteux soudain de sa brutalité, il balbutia : « Voilà… voilà… voilà ce que c’est. » »
Denis ****
Un vieux pharmacien est, une nuit, attaqué par son serviteur Denis, qui le poignarde. Denis ne l’achève pas quand il apprend que son maître n’a pas reçu l’argent escompté.
Cet étrange comportement du maître qui pardonne à son valet traître contre services rendus et cette trahison subite du valet n’ont rien à voir avec la folie. Elles dénoncent au travers des tensions des deux personnages, des conflits sociaux irréconciliables qui forcent à aller à l’inverse de la morale, de la loi… Sur ce thème de la frustration du domestique par rapport à son maître, on pourra comparer avec Les Bonnes de Genet ou avec L’Île des esclaves de Marivaux.
p. 862 : « Il fut réveillé par un bruit singulier. Il s’assit aussitôt dans son lit et écouta. Mais brusquement sa porte s’ouvrit, et Denis parut sur le seuil, tenant une bougie d’une main, un couteau de cuisine de l’autre, avec de gros yeux fixes, la lèvre et les joues contractées comme celles des gens qu’agite une horrible émotion, et si pâle qu’il semblait un revenant. »
L’Âne ****
Deux énergumènes ravagent la Seine : ils récupèrent et opèrent toute chose susceptible de rapporter. Ils rachètent l’âne d’une femme qui allait pour s’en débarrasser.
La cruauté du comportement humain par rapport aux animaux est ici prise en charge et mêlée par une séance de chasse pour pauvre. Ces ravageurs sont eux-mêmes des déchets de société. On peut ainsi souvent retrouver chez Maupassant cette cascade de domination-perversion, très sadienne (que Camus détaille bien avec le cynisme radical et pitoyable de La Chute)
p. 908 : « Quand le baudet eut fini de pousser sa plainte lamentable, comme un appel au secours, un dernier cri d’impuissance, l’homme, qui avait son idée, cria : « Mailloche, ohé ! ma sœur, amène-toi, je vas lui faire prendre médecine. » Et, tandis que l’autre ouvrait de force la bouche de l’animal, Chicot lui introduisait au fond du gosier le canon de son fusil, comme s’il eût voulu lui faire boire un médicament ; puis, il dit : « Ohé ! ma sœur, attention, je verse la purge. »
Et il appuya sur la gâchette. L’âne recula de trois pas, tomba sur le derrière, tenta de se relever et s’abattit à la fin sur le flanc en fermant les yeux. Tout son vieux corps pelé palpitait ; ses jambes s’agitaient comme s’il eût voulu courir. Un flot de sang lui coulait entre les dents. Bientôt, il ne remua plus. Il était mort. »
Idylle ***
Une grosse jeune femme et un maigre jeune homme se trouvent dans le même wagon de Gênes à Marseille, par un beau soleil. La grosse dame se sent oppressée par son corsage, avec ses gros seins gonflés de lait.
Un mélange étrange et comique de sentiment maternel et de pulsion amoureuse. La situation est un peu ridicule, invraisemblable. L’aspect voyage – anonymat – sans suite de cette situation qui se déroule dans un non-lieu permet des aventures immorales de ce type (que Maupassant avait déjà utilisé pour la farce Ce cochon de Morin). Le voyage en train est un moment très particulier de suspension des rôles sociaux, propice à une certaine légèreté de relation (que Dostoïevski décrit très bien dans ses Petites images).
p. 1195 : « Ils dirent les longues choses banales que répètent sans cesse les gens du peuple et qui suffisent à leur esprit lent et sans horizon. Ils parlèrent du pays. Ils avaient des connaissances communes. Ils citèrent des noms, devenant amis à mesure qu’ils découvraient une nouvelle personne qu’ils avaient vue tous les deux. Les mots rapides, pressés, sortaient de leurs bouches avec leur terminaisons sonores et leur chanson italienne. Puis ils s’informèrent d’eux-même. »
La Ficelle ****
Un vieil homme se baisse honteusement sur le chemin pour ramasser dans la boue un petit bout de ficelle qu’il croit pouvoir réutiliser. On le voit. On l’accuse plus tard d’avoir trouvé le porte-feuille qu’un homme avait perdu.
Cette mésaventure farcesque devient particulièrement intéressante car l’on voit le thème du piège finement élaboré : le personnage se piège lui-même, d’abord par son économie, ensuite par sa hantise, ses obsessions, ses hontes… Sa ferme volonté de s’innocenter contribue à l’enfermer encore plus dans cette histoire de ficelle. On retrouve également ce motif typique de Maupassant du petit rien qui entraîne le bouleversement d’une vie.
p. 1086 : « Il rentra chez lui, honteux et indigné, étranglé par la colère, par la confusion, d’autant plus atterré qu’il était capable, avec sa finauderie de Normand, de faire ce dont on l’accusait, et même de s’en vanter comme d’un bon tour. Son innocence lui apparaissait confusément comme impossible à prouver, sa malice étant connue. Et il se sentait frappé au cœur par l’injustice du soupçon. »
Garçon, un bock !… ***
Le comte Jean des Barrets est devenu pilier de comptoir. Il est dégoûté de tout, sans ambition ni envie ni amour pour personne depuis son enfance.
Figure du dégoût (ou nonchalance ?) réussie mais raccourcie psychologiquement. Maupassant tire apparemment cet épisode de sa propre enfance. Des années avant Freud, Maupassant cherche à saisir l’importance des traumatismes dans la construction de l’adulte.
p. 1127 : « Alors papa, tremblant de fureur, se retourna, et saisissant sa femme par le cou, il se mit à la frapper avec l’autre main de toute sa force, en pleine figure.
Le chapeau de maman tomba, ses cheveux dénoués se répandirent ; elle essayait de parer les coups, mais elle n’y pouvait parvenir. Et papa, comme fou, frappait, frappait. Elle roula par terre, cachant sa face dans ses bras. Alors il la renversa sur le dos pour la battre encore, écartant les mains dont elle se couvrait le visage. »
Le Baptême ****
C’est le baptême du petit Dentu. C’est son oncle, prêtre de la paroisse, qui s’occupe d’accueillir le nouveau-né dans la maison de Dieu.
Ce conte est à rapprocher de la finesse de Clair de lune, où les contradictions de l’homme d’église étaient déjà montrées de belle manière. Le paysage et les personnages de campagne sont peints avec splendeur. La « farce » propre à ce monde s’intègre parfaitement et n’est pas ici du registre du grotesque. Non, ici, le paysan est profondément humain et révèle innocemment le cruel paradoxe du prêtre, interdit d’amour et de procréation, alors qu’il est souvent le plus apte, le plus sensible, le plus conscient de la portée de l’œuvre de la procréation.
p. 1147 : « Il [le prêtre] n’entendait rien, il ne voyait rien, il contemplait l’enfant. Il avait envie de le prendre encore sur ses genoux, car il gardait, sur sa poitrine et dans son cœur, la sensation douce de l’avoir porté tout à l’heure, en revenant de l’église. Il était ému devant cette larve d’homme comme devant un mystère ineffable auquel il n’avait jamais pensé, un mystère auguste et saint, l’incarnation d’une âme nouvelle, le grand mystère de la vie qui commence, de l’amour qui s’éveille, de la race qui se continue, de l’humanité qui marche toujours. »
Regret ****
M. Saval a maintenant soixante-deux ans et a eu une vie ratée : il n’a jamais vécu l’amour. Il avait été secrètement amoureux de la femme d’un ami.
Le vrai tragique de l’histoire n’est pas la vie minable du personnage mais le fait qu’il aurait pu la réussir mais qu’il est passé à côté par nonchalance et un peu par lâcheté.
p. 1048 : « La nonchalance avait été son grand mal, son défaut, son vice. Combien de gens ratent leur vie par nonchalance. Il est si difficile à certaines natures de se lever, de se remuer, de faire des démarches, de parler, d’étudier des questions. »
Mon oncle Jules ****
Une famille très modeste du Havre fonde beaucoup d’espoir sur l’oncle Jules, parti faire fortune aux Amériques. Lors d’un petit voyage à Jersey, le père croit le reconnaître en un ouvreur d’huîtres.
Le mythe de l’espoir familial reposant sur un lointain proche parti faire fortune. On pensera à ce phénomène des émigrés qui ne peuvent rentrer sans avoir fait fortune, au risque de passer pour un raté et de décevoir les attentes énormes de la famille.
p. 931 : « Ma mère souffrait beaucoup de la gêne où nous vivions, et elle trouvait souvent des paroles aigres pour son mari, des reproches voilés et perfides. Le pauvre homme avait alors un geste qui me navrait. Il se passait alors la main ouverte sur le front, comme pour essuyer une sueur qui n’existait pas, et il ne répondait rien. Je sentais sa douleur impuissante. On économisait sur tout ; on n’acceptait jamais un dîner, pour n’avoir pas à le rendre ; on achetait les provisions au rabais, les fonds de boutique. Mes sœurs faisaient leurs robes elles-mêmes et avaient de longues discussions sur le prix d’un galon qui valait quinze centimes le mètre. Notre nourriture ordinaire consistait en soupe grasse et bœuf accommodé à toutes les sauces. Cela est saint et réconfortant, paraît-il ; j’aurais préféré autre chose. »
En voyage (« Le wagon était au complet depuis Cannes… ») ***
La comtesse Marie Baranow de Russie est envoyée à Menton pour se soigner. Dans le train, un homme en sang surgit de nulle part. Elle l’aide à passer la frontière.
Petite anecdote de voyage, sorte d’aventure amoureuse rêvée pour une femme abandonnée, se transforme en l’histoire d’un bonheur établi sur le maintien de la distance des corps et des sentiments. Mais si ce bonheur plat contente Marie, il réduit le bandit à un état d’attente transie et torturante. Encore une nouvelle attaque aux bonnes mœurs qu’on enseigne aux femmes et qui rendent tout le monde malheureux.
p. 815 : « Quant à lui, il était certes également une sorte de Don Quichotte, car il ne fit rien pour se rapprocher d’elle. Il voulait tenir jusqu’au bout l’absurde promesse de ne lui jamais parler qu’il avait faite dans le wagon. »
La Mère Sauvage ****
La mère Sauvage doit loger quatre Prussiens chez elle, dont elle s’occupe en toute hospitalité. Elle reçoit une lettre lui annonçant la mort de son fils parti à la guerre.
« La Mère Sauvage » est à rapprocher de la mère de Une vendetta. Seulement ici, la vengeance de la mère est directe, expéditive ; et ce n’est pas le coupable qui est puni. La violence est détournée sur le peuple coupable (on retrouve ce report de la frustration sur plus faible, comme dans L’Âne). Il s’agit peut-être juste de ne plus être seule à pleurer.
p. 1223 : « Vous écrirez comment s’est arrivé, et vous direz à leurs parents que c’est moi qui est fait ça. Victoire Simon, la Sauvage ! N’oubliez pas. »
10 commentaires sur « Ramasse tes lettres : Miss Harriet (recueil), de Maupassant »