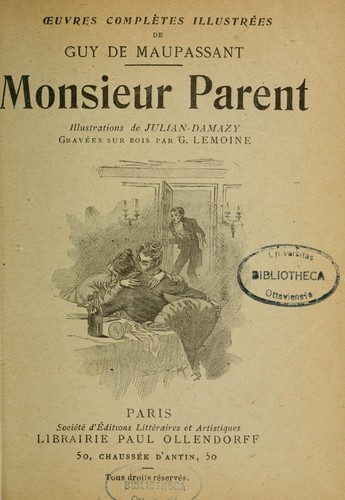
Les pièges que l’on se tend pour vivre…
Maupassant (Guy de) 1883-1885 (1885), Monsieur Parent [in Œuvres complètes, t. 1 & 2], Gallimard, coll. « nrf La Pléiade », 1974 & 1979
Recueils :
– Boule de suif (1879) et nouvelles non reprises en recueil
– La Maison Tellier (1881)
– Mademoiselle Fifi (1882)
– Contes de la bécasse (1883)
– Clair de Lune (1883)
– Miss Harriet (1884)
– Les Sœurs Rondoli (1884)
– Yvette (1884)
– Contes du jour et de la nuit (1885)
– Monsieur Parent (1885)
– Toine (1886)
– La Petite Roque (1886)
– Le Horla (1887)
– Le Rosier de madame Husson (1888)
– La Main gauche (1889)
– L’Inutile Beauté (1890)
– Le Père Milon (1899)
– Le Colporteur (1900)
Sommaire
– Monsieur Parent (1885) ****
– La Bête à Maît’ Belhomme (1885) ***
– À vendre (1885) ****
– L’Inconnue (1885) ****
– La Confidence (1885) ****
– Le Baptême (« Allons, docteur, un peu de cognac… ») (1885) ****
– Imprudence (1885) ***
– Un fou (1885) ***
– Tribunaux rustiques (1884) ***
– L’Épingle (1885) ****
– Les Bécasses (1885) ***
– En wagon (1885) ***
– Ça ira (1885) ***
– Découverte (1884) ***
– Solitude (1884) ****
– Au bord du lit (1883) ****
– Petit soldat (1885) ****
Monsieur Parent ****
Monsieur Parent est un gros bourgeois, doux, timide et faible, inactif vivant sur une rente confortable. Il se laisse marcher sur les pieds par sa femme, se fait engueuler par Julie, la vieille servante de famille, mais, heureusement, il a son petit Georges ! Mais voilà que Julie, dans un excès d’exaspération, lui révèle tout : sa femme le trompe avec son ami Paul Limousin depuis leur mariage, et son petit Georges n’est pas de lui. M. Parent les jette tous dehors et se renferme sur lui, et vide son temps dans un bar.
Reprise développée et modifiée de « Le Petit« . Toute la première partie suit scrupuleusement le conte précité, à l’exception du fait que la femme est encore en vie. Mais lorsque le mari apprend son malheur, il choisit toujours de se retirer de la vie, mais n’a pas la force de se suicider, et devient une loque de comptoir, plus mort que vif. Tout son monde s’est écroulé en une soirée. S’est révélé d’un coup le hors-champ de son existence, et l’évaluation de celle-ci s’est complètement inversée, comme pour cet autre bourgeois dans « Les Bijoux« .
Le thème essentiel de cette nouvelle est cependant l’enfant bâtard, thème très cher à Maupassant.
En plus du simple récit que contenait l’ancien conte, Monsieur Parent fait intervenir l’aspect torturant et autodestructeur du doute concernant la paternité de l’enfant chéri (qu’on retrouve trois ans plus tard dans Pierre et Jean, mais en vision inversée, du point de vue de l’enfant). À cause de ce doute, M. Parent est incapable d’aimer l’enfant qu’il aimait auparavant, car il a une conception limitée de l’enfant comme extension de soi. Avoir un doute sur le sang du gamin, c’est alors avoir un doute sur sa propre identité.
Ce doute, dans le caractère faible de Monsieur Parent, se mue en incapacité d’affronter la vie. (Louis Forestier note la ressemblance avec le caractère de M. Folantin dans À vau-l’eau de Huysmans, publié en 1882. On pourrait également faire un parallèle avec le personnage de Cidrolin des Fleurs bleues de Raymond Queneau, personnage lui aussi fuyant, déçu par sa femme et ses enfants…)
p. 582 : « Et il entra dans son appartement. Dès qu’il y fut, il poussa le verrou pour être seul, bien seul, tout seul. Il était tellement habitué, maintenant, à se voir malmené et rudoyé qu’il ne se jugeait en sûreté que sous la protection des serrures. Il n’osait même plus penser, réfléchir, raisonner avec lui-même, s’il ne se sentait garanti par un tour de clef contre les regards et les suppositions. »
p. 583 : « L’enfant riait enchanté, agitait ses bras, poussait des cris de plaisir, et le père aussi riait et criait de contentement, secouant son gros ventre, s’amusant plus encore que le petit. »
p. 589 : « Et il traversa le salon en deux enjambées pour aller examiner dans la glace la face de son enfant à côté de la sienne. Il tenait Georges assis sur son bras, afin que leurs visages fussent tout proches, et il parlait haut, tant son égarement était grand. « Oui… nous avons le même nez… le même nez… peut-être… ce n’est pas sûr… et le même regard… Mais non, il a les yeux bleus… Alors… oh ! mon Dieu !… mon Dieu !… mon Dieu !… je deviens fou !… Je ne veux plus voir… je deviens fou !… » »
La Bête à Maît’ Belhomme ***
La diligence de Césaire Horlaville est pleine et emporte quelques villageois vers Le Havre. Parmi eux, le grand et maigre maît’Belhomme applique son mouchoir sur son oreille et trépigne de douleur. Il prétend avoir une bête dans l’oreille et se rend en ville voir un guérisseur car il n’aime pas les médecins.
On pense ici immédiatement à Boule de Suif. Mais sur le ton léger de la farce, Maupassant trace fermement des portraits sociaux, en couleur vives, des paysans normands. Finalement, le prétexte de la diligence, en plus de permettre un clin d’œil évident au premier succès de l’auteur, offre une chute hilarante mais tellement crédible qui laisse exprimer encore tous les comportements pittoresques du paysan.
p. 559 : « – C’est-il point quéque lapin qu’t’as dans l’oreille ? Il aura pris çu trou-là pour son terrier, vu la ronce. Attends, j’vas l’fé sauver.
Et Caniveau, formant un porte-voix de ses mains, commença à imiter les aboiements des chiens courants en chasse. Il jappait, hurlait, piaulait, aboyait. Et tout le monde se mit à rire dans la voiture, même l’instituteur qui ne riait jamais. »
À vendre ****
Notre conteur se promène sur les côtes du Finistère et sent passer en lui toute une allégresse rêveuse. Au fond d’une plage, il aperçoit une petite maison blanche. Elle est à vendre. Piqué de curiosité, il décide de la visiter. Tombé sous le charme de la grande photographie d’une femme, il interroge la vieille bonne.
Ce conte est étrangement positif. Il reprend le thème de la femme inconnue mais familière de Rimbaud (« Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant… »), mais placé dans une situation d’excellente disposition peu habituelle de l’auteur. L’emportement naïf du narrateur, d’ailleurs bien peu développé, peut même paraître ridicule. Cet emportement provient en fait de la séduction de la nature, qui a fait ressurgir un rêve de jeunesse. Mais ce rêve ne peut qu’être à nouveau crevé. Un motif qui annonce les considérations de Fort comme la mort sur le temps et sa perception psychologique, et dans le prolongement, celles de Marcel Proust.
p. 420
Pourquoi gardons-nous le souvenir si clair, si cher, si aigu de certaines minutes d’amour avec la Terre, le souvenir d’une sensation délicieuse et rapide, comme de la caresse d’un paysage rencontré au détour d’une route, à l’entrée d’un vallon, au bord d’une rivière, ainsi qu’on rencontrerait une belle fille complaisante ?
L’Inconnue ****
Gontran et Roger des Annettes discutent des rencontres d’un instant, de ces femmes croisées seulement. Roger des Annettes raconte comment quatre fois il a croisé une même femme et que ces quatre fois ont fini par le rendre amoureux.
Dans la continuité du thème abordé dans « À vendre », ce conte reprend aussi le thème de Baudelaire dans « À une passante », de la femme croisée qui reste comme un rêve potentiel poignant et regretté. Mais contrairement au poème de Baudelaire, où la passante n’est adorée que parce qu’elle n’est croisée qu’une seule fois, une fois dans laquelle se loge toute la puissance du fantasme, le second conteur finit par tomber amoureux de cette femme étrange alors qu’il lui parle enfin. L’emportement amoureux se constitue par tout un jeu d’émotions conjuguées qui n’ont pas tant à voir avec la femme croisée : « La vérité est que ce ne sont pas précisément ces étrangers qui nous inspirent ces vagues regrets. En réalité, ils nous sont indifférents. Ce sont ces moments-là que nous regrettons, ces miettes de notre existence, envolées à jamais ». (« Guy de Maupassant intime », La Grande Revue, 25 octobre 1912, Mme X, Lecomte du Noüy) Ainsi Maupassant méditant sur la perception subjective de l’expérience annonce clairement le phénomène de cristallisation du sentiment amoureux chez Marcel Proust : Swann n’est plus amoureux d’Odette mais de la fantaisie qu’il s’était fait d’elle au début de leur rencontre (cf. Du côté de chez Swann).
p. 442-443
Est-ce une fillette qui fait les courses du magasin, une jeune femme qui vient de l’église ou qui va chez son amant ? Qu’importe ! La poitrine est ronde sous le corsage transparent. – Oh ! si on pouvait mettre le doigt dessus ? le doigt ou la lèvre. – Le regard est timide ou hardi, la tête brune ou blonde ? Qu’importe ! L’effleurement de cette femme qui trotte vous fait courir un frisson dans le dos. Et comme on la désire jusqu’au soir, celle qu’on a rencontrée ainsi ! Certes, j’ai bien gardé le souvenir d’une vingtaine de créatures vues une fois ou dis fois de cette façon et dont j’aurais été follement amoureux si je les avais connues plus intimement.
Mais voilà, celles qu’on chérirait éperdument, on ne les connaît jamais. Avez-vous remarqué ça ? c’est assez drôle ! On aperçoit, de temps en temps, des femmes dont la seule vue nous ravage de désirs. Mais on ne fait que les apercevoir, celles-là. Moi, quand je pense à tous les êtres adorables que j’ai coudoyés dans les rues de Paris, j’ai des crises de rage à me pendre.
La Confidence ****
La petite marquise Rennedon vient rendre visite à son amie, la petite baronne de Grangerie, afin de lui confier qu’elle vient, aujourd’hui même, de se venger de son gros mari jaloux.
Premier épisode d’un tryptique où on retrouvera les deux jeunes femmes, avec « Sauvée » et « Le Signe ».
Ce conte reste dans les mêmes thématiques que les précédents comme « Joseph » ; mais il est surtout à rapprocher de « Clair de Lune ». Tout l’intérêt du conte présent est dans la manière dont le personnage expose son aventure et prépare la chute. Elle prend une confidente, qui joue le rôle de tout lecteur modèle, afin de rire avec elle de son mari. Mais la leçon du conte est ambiguë : est-ce la faute des hommes mauvais si les femmes mal mariées deviennent perverses ? ou est-ce que les femmes, paradoxalement, s’amusent et s’accommodent très bien de leurs mauvais maris, grâce auxquels elles peuvent déployer toute une étendue de perversité ?
On retrouve le rôle important du rire, comme symbole révélateur de l’adultère.
p. 526 : « Oh ! ma chère, en voilà un supplice que d’être… aimée par un homme grotesque… Non, vraiment, je ne pouvais plus… plus du tout… c’est comme si on vous arrachait une dent tous les soirs… bien pis que ça, bien pis ! Enfin figure-toi dans tes connaissances quelqu’un de très vilain, de très ridicule, de très répugnant, avec un gros ventre – c’est ça qui est affreux -, et de gros mollets velus. Tu le vois, n’est-ce pas ? Eh bien, figure-toi encore que ce quelqu’un est ton mari… et que tous les soirs… tu comprends. Non ! c’est odieux !… odieux !… Moi, ça me donnait des nausées, de vraies nausées… des nausées dans ma cuvette. Vrai, je ne pouvais plus. Il devrait y avoir une loi pour protéger les femmes dans ces cas-là. – Mais figure-toi ça, tous les soirs… Pouah ! que c’est sale ! »
Le Baptême (« Allons, docteur, un peu de cognac… ») ****
A l’occasion d’un verre d’alcool, un vieux raconte une histoire. Un hiver, dans sa maison de campagne en Bretagne, la famille qui gardait la maison le reste de l’année venait d’avoir un bébé. Et malgré la neige et le froid, ils appliquent jusqu’au bout la coutume de laisser l’enfant nu jusqu’au baptême.
Placé sous le signe de la déchéance alcoolique, avec la référence à l’Assommoir, ce conte ne pouvait que finir affreusement mal. Et ce qui pourtant ressemble à ce qui aurait pu être une farce paysanne devient un drame horrible, à rapprocher également de « L’Ivrogne« . En illustrant l’absurdité des coutumes – ou plutôt de leur respect à la lettre -, ce conte nous montre la plus stupide d’entre elles : l’abus d’alcool. La Bretagne apparaît ainsi comme une terre sauvage, bestiale, mal-civilisée, différente de ce qu’on verra chez Loti dans Pêcheur d’Islande, même si on retrouve cette mer mangeuse d’hommes. Une autre comparaison intéressante pourrait être faite avec le film Wake in Fright (1971), de Ted Kotcheff, illustrant l’impossibilité en culture australienne de dire non à une bière…
p. 437 : « Entrez dans ces chaumières. Jamais vous ne trouverez le père. Et si vous demandez à la femme ce qu’est devenu son homme, elle tendra les bras sur la mer sombre qui grogne et crache sa salive blanche le long du rivage. Il est resté dedans un soir qu’il avait bu un peu trop. Et le fils aîné aussi. Elle a encore quatre garçons, quatre grands gars blonds et forts. A bientôt leur tour. »
Imprudence ***
Les jeunes mariés commencent à se lasser un peu… Madame a l’idée, pour pimenter leur couple, d’aller passer la soirée dans un bar que fréquentait son mari, étant jeune. Ainsi, ils joueront aux amants. Elle se met à interroger son mari sur ses anciennes amantes.
Cette petite sortie du couple bourgeois mal marié, révèle comment la femme, découvrant que son mari s’est bien amusé avant, va à coup sûr se trouver un amant, puisque dès le départ, ce qui l’animait était ce jeu dangereux. Fait partie de ces tableaux, comme Une vie, montrant les dégâts de l’éducation bien-pensante des femmes, qui croyant les protéger, les prépare très mal à la vie sexuelle qu’elles vont mener.
p. 551 : « Elle se sentait étrangement émue par ce lieu suspect, agitée, contente, une peu souillée mais vibrante. Deux valets graves, muets, habitués à tout voir et à tout oublier, à n’entrer qu’aux instants nécessaires, et à sortir aux minutes d’épanchement, allaient et venaient vite et doucement. »
Un fou ***
Un magistrat très respecté vient d’être mis en terre. Le notaire retrouve dans un tiroir, quelques pages de son journal. Il y livre une irrésistible envie de goûter au meurtre.
Le récit est évidemment à rapprocher de tous les contes préparatoires du « Horla ».
On retrouve ici l’une des thèses de Sade dans La Philosophie dans le boudoir, sur la nature meurtrière de l’homme, sur ce délicieux vice nécessaire à l’homme, pour son équilibre. Ainsi, le magistrat, personnage officiellement au-delà de tout soupçon, comprend que le meurtre n’est que l’autre facette de la pureté (« tuer n’est-il pas ce qui ressemble le plus à créer ? Faire et détruire ! Ces deux mots enferment l’histoire des univers », p. 541), et ne lui cède que plus facilement. Mais la perversité, l’envie de tuer, provient ici d’abord d’un raisonnement avant d’être pulsion, ce qui confirme toute l’atrocité du personnage qui tue par intelligence. Bien-sûr, le récit met également en évidence la défaillance – typique chez Maupassant – de la mentalité d’un individu peu à peu dévorée par une idée, une tentation, une obsession.
p. 546 : « Comme c’est beau de voir trancher la tête d’un homme ! Le sang a jailli comme un flot, comme un flot ! Oh ! Si j’avais pu, j’aurais voulu me baigner dedans. Quelle ivresse de me coucher là-dessous, de recevoir cela dans mes cheveux, sur mon visage, et de me relever tout rouge, tout rouge ! Ah ! Si on savait ! »
Tribunaux rustiques ***
Mme Bascule a élevé le jeune Isidore pour ses plaisirs. Mais ce dernier l’a laissée et s’est marié, donnant en guise de dot à sa jeune femme, les terres qu’il avait reçues de Mme Bascule.
Reprise de « Autres temps ».
La situation est une inversion de ces comédies de mariage de Molière où un vieux riche élève et se garde précieusement une jeune fille pour la marier… On regrettera le peu d’action dramatique. On applaudit en revanche à la magnificence de la langue normande.
p. 390 : « LE JUGE DE PAIX, riant : Quels ont été vos rapports avec Mme Bascule, ici présente ?
ISIDORE : A m’a servi de traînée.
(Rires dans l’auditoire)
LE JUGE : Modérez vos expressions. Vous voulez dire que vos relations n’ont pas été aussi pures qu’elle le prétend.
LE PERE PATURON, prenant la parole : I n’avait point quinze ans, point quinze ans, m’sieu l’Juge, quand a m’la débouché…
LE JUGE : Vous voulez dire débauché ? »
L’Épingle ****
Notre conteur, en voyage dans un pays exotique, trouve refuge pour la nuit chez un Français bien installé dans le pays depuis dix ans, très enrichi à force de travail acharné. L’homme regrette pourtant Paris et conserve une mystérieuse épingle, sur « un carré de satin blanc encadré d’or » suspendu dans sa chambre (p. 521), en souvenir d’une parisienne.
Conte de la possession d’un homme par une femme qui ne lui convient pas (qu’on retrouve bien entendu dans Du côté de chez Swann, partie « Un amour de Swann »). Thème de l’emballement disproportionné du cœur qui prend ici une tournure de « monomanie » dans le fétichisme de l’homme qui a gardé jusqu’au symbole de son plus malheur. Attachement malsain, masochiste, pour une femme qui le trompe et le maltraite…
Ce qui ressort d’une manière particulièrement actuelle, c’est que plus la femme est femme, libre, affirmée, plus l’attachement est fort mais plus son caractère devient détestable à l’homme qui n’arrive à la posséder, à la maîtriser. Le femme libérée, ce sont tous ses défauts et qualités sublimés, quand ils sont en sourdine dans la femme traditionnelle, étranglée dans son corset de femme-poupée (cf. Une Maison de poupées). D’où, devant la femme moderne, l’homme douloureusement amoureux et misogyne à la fois. masculiniste pathétique. C’est un thème que développera également Notre cœur. Il y a dans la confession de ce personnage quelque chose de proche et de familier avec ces hommes déçus d’eux-mêmes, que sont les narrateurs neurasthéniques et inarrêtables des Carnets du sous-sol de Dostoïevski, du Bavard de des Forêts ou de La Chute de Camus. Personnages frappés d’un complexe d’infériorité/supériorité, s’apitoyant sur eux-mêmes de manière à s’autoriser le mépris…
p. 522 : « Il doit exister un amour simple, fait du double élan de deux cœurs et de deux âmes ; mais il existe assurément un amour atroce, cruellement torturant, fait de l’invincible enlacement de deux êtres disparates qui se détestent en s’adorant. »
p. 523 : « Quand je la regardais… je sentais un besoin furieux d’ouvrir les bras, de l’étreindre et de l’étrangler. Il y avait en elle, derrière ses yeux, quelque chose de perfide et d’insaisissable qui me faisait l’exécrer ; et c’est peut-être à cause de cela que je l’aimais tant. En elle, le Féminin, l’odieux et affolant Féminin était plus puissant qu’en aucune autre femme. Elle en était chargée, surchargée comme d’un fluide grisant et vénéneux. Elle était Femme, plus qu’on ne l’a jamais été.
Et tenez, quand je sortais avec elle, elle posait son œil sur tous les hommes d’une telle façon, qu’elle semblait se donner à chacun, d’un seul regard. »
Les Bécasses ***
Notre conteur explique à sa chère amie pourquoi il ne rentre pas à Paris. La période des bécasses est arrivée et il part chasser avec les frères d’Orgemol, deux grands colosses normands. Au détour d’un chemin, ils aperçoivent Gargan, le berger sourd-muet. Maître Picot, qui les loge et les accompagne, a dû le défendre devant le juge, car il a étranglé sa femme, une pauvre gueuse, surnommée la Goutte en raison de son fort penchant à l’eau de vie.
Dans ce texte, on retrouve l’ambiance légère des farces normandes. La chasse est décrite comme une vraie bouffée d’air. Le récit central est en revanche à rapprocher des contes tels que « Coco« , « L’Aveugle », « Le Gueux« , et autres récits de « boulets » de la société. Ici, bien qu’on lui ait trouvé une place, et même une femme, il reste à part, et les paysans s’amusent cruellement à le faire cocu. Mais le drame montre que « l’infirme » a les mêmes réactions, les mêmes sentiments que n’importe quel autre, simplement silencieux et donc pathétiquement impuissants à crier.
p. 566 : « Car nous ne chassons pas la bécasse, mais le lapin. Nous sommes convaincus qu’il ne faut paschercher la bécasse, mais la trouver. On tombe dessus et on la tue, voilà. Quand on veut spécialement en rencontrer, on ne les pince jamais. C’est vraiment une chose belle et curieuse que d’entendre dans l’air frais du matin, la détonation brève du fusil, puis la voix formidable de Gaspard emplir l’horizon et hurler : « Bécasse. – Elle y est. »
Moi je suis sournois. Quand j’ai tué une bécasse, je crie : « Lapin ! » et je triomphe avec excès lorsqu’on sort les pièces du carnier, au déjeuner de midi. »
En wagon ***
L’abbé Lecuir est chargé d’aller chercher les fils de ses dames, à Paris, et de les escorter jusqu’à leur mère pour les vacances. Il doit veiller sur eux et empêcher qu’ils partagent leur wagon avec des filles de Paris, qui, paraît-il, arpentent les grandes lignes pendant l’été. Il trouve un wagon occupé par une fille très bien mais un peu pâle.
Dans le prolongement des aventures de voyage en train, des « Soeurs Rondoli » bien-sûr, différents degrés pour voir ce conte : la simple farce ; l’éducation saugrenue des enfants laissés dans l’insouciance (thèse de Sade ou Schopenhauer) ; l’abbé avec la sexualité et le bébé interdits.
Évidemment la dernière parole vient provoquer tout un imaginaire par rapport à l’abbé.
p. 482 : « L’abbé tenait dans ses mains un enfant tout nu. Il le regardait avec des yeux effarés ; il semblait content et désolé, prêt à rire et prêt à pleurer ; on l’aurait cru fou, tant sa figure exprimait de choses par le jeu rapide des yeux, des lèvres et des joues. »
Ça ira ***
Notre conteur, au hasard d’un voyage dans une ville ennuyeuse du nom de Barviller, entre dans un bureau de tabac pour s’acheter un cigare et reconnaît la patronne : c’était « Ça ira », une fille insignifiante qui s’était accrochée à la bande de canotiers dont il faisait partie, étant jeune. Elle, avait été surnommée « Ça ira », parce qu’elle se plaignait tout le temps de son sort.
L’ancienne fille lui raconta son histoire. Ancienne modiste, elle complétait son maigre revenu par « deux ou trois amants habitués qui donnaient un peu », et par quelques coups de débrouilles avec ses amies. Un étudiant oisif finit par la mettre enceinte.
Le conte renvoie aux temps de canotage de Maupassant sur la Seine, vers 1876, avant son entrée dans le monde du journalisme. L’histoire de la fille devenue quelqu’un, vient montrer que la réussite s’accomplit au prix d’une certaine perte de la liberté. Même la fille pauvre et sans importance, regrette d’une certaine façon, cette existence un peu folle de la jeunesse. Son histoire est à la fois touchante et drôle, à l’image de la transformation de son surnom : Ça ira > Zaïra > Zara > Sarah > La Juive.
p. 578 : « La marchande de tabac allait toujours, vidant d’un seul coup tous ses souvenirs amassés depuis si longtemps dans son cœur fermé de débitante officielle. Tout l’autrefois pauvre et drôle remuait son âme. Elle regrettait cette vie galante et bohème du trottoir parisien, faite de privations et de caresses payées, de rire et de misère, de ruses et d’amour vrai par moments. »
Découverte ****
Notre conteur croise un vieil ami, Henri Sidoine, qui semble en haine contre les Anglais. Il a lui-même épousé une Anglaise, tombé sous le charme d’un accent, de sa mauvaise prononciation exotique, qui finit par disparaître.
Ce conte est un exemple flagrant de la thèse du piège selon l’étude de Micheline Besnard-Coursodon. L’homme est piégé par un artifice exotique. C’est aussi le piège de la nature selon Schopenhauer, la cristallisation de Swann pour Odette (dans Du côté de chez Swann). Cependant, le comique est provoqué par la conséquence inverse de l’effet attendu des efforts d’instruction de la pauvre femme… Un effet comparable à celui décrit dans La Maison du chat-qui-pelote par Balzac où la jeune femme de catégorie sociale inférieure s’instruisant pour comprendre son mari peintre perd le côté charmant de sa naïveté innocente et n’arrive qu’à être une piètre admiratrice d’art… Mais outre ce piège qui offre une vision négative de l’amour, on retrouve une vision acerbe de l’éducation puritaine des Anglais, assez à la mode alors, prolongation de « Miss Harriet ».
p. 317 : « Je l’épousai ! Je l’aimais follement comme on peut aimer un Rêve. Car les vrais amants n’adorent jamais qu’un rêve qui a pris forme de femme.
[…]
Eh bien, mon cher, le seul tort que j’ai eu, ç’a été de donner à ma femme un professeur de Français.
Tant qu’elle a martyrisé le dictionnaire et supplicié la grammaire, je l’ai chérie. »
Solitude ****
Pendant une promenade d’un soir, un ami exprime l’ampleur de sa conscience de la solitude.
Magnifique étude auto-analytique de la solitude avec incessantes prises de recul. Maupassant semble ici avoir cherché à exprimer le plus directement – sans presque de détour par la fiction – d’une dépression existentielle chronique et grandissante depuis Bel-Ami.
p. 1257 : « Gustave Flaubert, un des plus grands malheureux de ce monde, parce qu’il était un des grands lucides, n’écrivit-il pas à une amie cette phrase désespérante : « Nous sommes tous dans un désert. Personne ne comprend personne. »
[…]
Sais-tu quelque chose de plus affreux que ce constant frôlement des êtres que nous ne pouvons pénétrer ! Nous nous aimons les uns les autres comme si nous étions enchaînés, tout près, les bras tendus, sans parvenir à nous joindre. Un torturant besoin d’union nous travaille, mais tous nos efforts restent stériles, nos abandons inutiles, nos confidences infructueuses, nos étreintes impuissantes, nos caresses vaines. Quand nous voulons nous mêler, nos élans l’un vers l’autre ne font que nous heurter l’un à l’autre. »
p. 1259 : « Quant à moi, maintenant, j’ai fermé mon âme. Je ne dis plus à personne ce que je crois, ce que je pense et ce que j’aime. Me sachant condamné à l’horrible solitude, je regarde les choses sans jamais émettre mon avis. Que m’importe les opinions, les querelles, les plaisirs, les croyances ! Ne pouvant rien partager avec personne, je me suis désintéressé de tout. Ma pensée invisible demeure inexplorée. J’ai des phrases banales pour répondre aux interrogations de chaque jour, et un sourire qui dit : « oui », quand je ne veux même pas prendre la peine de parler.
Me comprends-tu ? »
Au bord du lit ****
Une femme se refuse à son époux, qui, il y a encore peu, ne voulait plus d’elle et lui préférait des cocottes. Elle veut maintenant qu’il la paye comme il a payé les autres.
Une comédie en deux actes fut tirée de ce conte : « La Paix du ménage » (ou « Un duel au canif »). Composé comme une saynète, ce petit conte de ménage mêle les thèmes ambigus du mariage libéré du XVIIIe et du statut de la prostituée.
p. 1043 : « Quand on est à jeun, on a faim, et quand on a faim, on se décide à manger des choses qu’on aimerait point à un autre moment. Je suis le plat… négligé jadis que vous ne seriez pas fâché de vous mettre sous la dent… ce soir. »
Le Petit Soldat ****
Deux tout jeunes soldats ont trouvé un coin de campagne qui leur rappelle leur village breton. Ils y vont tous les dimanches et regardent passer la fille à la vache, avec laquelle ils finissent par sympathiser, à partager un peu de lait.
Entrelacs de thèmes : militaire, liberté, jeunesse, timidité, amour, mort. Les deux nouvelles recrues recréent leur village perdu, pendant leur repos du dimanche : un coin de campagne, une fermière, un ami, un repas. Mais cette idylle à trois finit par se rompre. Une amitié qui rejoint d’une certaine manière celle des « Deux amis« , qui ne retrouvent humanité qu’en s’éloignant de la ville, de la caserne, amitié tout autant gâchée… La solidarité de l’amitié est pour ces deux jeunes hommes le remède à la brutalité de l’arrachement au pays natal, à la douleur du déracinement.
p. 489 : « Le dimanche suivant, elle s’assit à côté d’eux pour deviser plus longtemps, et tous trois, côte à côte, les yeux perdus au loin, les genoux enfermés dans leurs mains croisées, ils racontèrent des menus faits et des menus détails des villages où ils étaient nés, tandis que la vache, là-bas, voyant arrêtée en route la servante, tendait vers elle sa lourde tête aux naseaux humides, et mugissait longuement pour l’appeler.
La fille accepta bientôt de manger un morceau avec eux et de boire un petit coup de vin. Souvent, elle leur apportait des prunes dans sa poche ; car la saison des prunes était venue. Sa présence dégourdissait les deux petits soldats bretons qui bavardaient comme deux oiseaux. »
2 commentaires sur « Ramasse tes lettres : Monsieur Parent (recueil), de Maupassant »