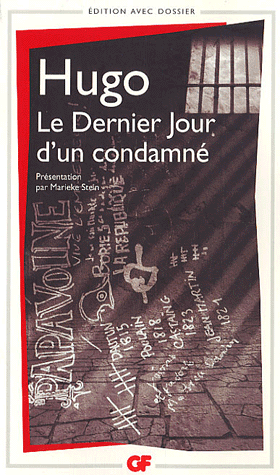
BROUILLON
Hugo (Victor) 1823, Le Dernier Jour d’un condamné, éd. GF, 2007
Résumé
On a retrouvé un paquet de feuilles noircies par les mains d’un ancien prisonnier, condamné pour meurtre puis exécuté. On lui avait autorisé papier, plume et encre. L’homme raconte comment il attend l’heure fatale de la place de la Grève, s’interroge, écrit sans trop savoir pourquoi. Décrire l’horreur de la condamnation fatale pour soutenir l’abolition ? envoyer quelques mots à sa fille qui grandira sans le connaître ? simplement détourner son esprit de l’horreur insensée ? laisser une dernière trace avant la mort ?
Ces feuilles ont été réunies et éditées. Le lecteur avance donc dans l’horreur de cette condamnation, avec le condamné.
Commentaires
Le récit de Victor Hugo adopte la forme du journal intime (bien qu’on relève aisément quelques incohérences hésitations entre récit sur le vif au présent et le fait que le prisonnier ne peut écrire que dans sa cellule). En même temps qu’une rhétorique amenant des arguments contre la peine de mort, finement mêlée au récit, apparaît déjà un intérêt pour l’argot, lié à la vie des prisonniers, qu’on retrouvera dans Les Misérables. La personne qui s’exprime n’a pas de nom et on ne connaît pratiquement rien de son crime (il ne clame pas son innocence). Hugo évite absolument tout ce qui pourrait détourner le lecteur de la question de la peine de mort, il le met ainsi dans l’espace restreint du condamné qui ne pense plus qu’à ça. On accompagne donc ce « je » dans ses dernières étapes, depuis sa sentence jusqu’aux derniers instants dans la pièce de l’Hôtel de ville – avec l’étrangeté d’écouter la voix de quelqu’un qui va mourir presque l’instant d’après. Sans qu’on sente la moindre connotation chrétienne dans le récit, l’attente du condamné a quelque chose du chemin de croix, tant d’allers et venues, changement de garde, visite du prêtre, de la fille, rêves éveillés, toilette du condamné… Il porte inutilement sa condition de mort encore en vie. Se dessine un contraste entre les préoccupations terrestres et chaleureuses des hommes libres et ce condamné qui ne sait plus le pourquoi de son souffle mais craint tout de même ce moment où tout va finir. Le décalage entre condamnation et exécution constitue une torture.
La voix de ce personnage semble parfois peu accordée aux préoccupations d’un condamné, manquant du cruel emportement d’une âme prise de panique. C’est que le projet est autre que réaliste. Cette voix soignée réactualisée par le lecteur – qui en l’oralisant silencieusement se prend au « je » – lui fait voir ce que serait son calvaire s’il était condamné. Cette coquille de personnage peu déterminé a le potentiel de devenir n’importe quel lecteur. La voix familière emmène le lecteur dans les endroits secrets et cachés que seuls connaissent les condamnés et ceux qui les condamnent (peut-être plus sûrement le personnel de prison ; il est peu probable que les juges et avocats connaissent vraiment bien les lieux). Le texte fait ressentir au lecteur que lui aussi, bien qu’il n’ait pas participé au procès, fait partie de ceux qui condamnent, en donnant son assentiment à une société de sévérité… sans même s’être jamais représenté en quoi consistait une condamnation à mort. Pour rendre plus réel son récit, Victor Hugo s’est très certainement documenté (lectures, visites, rencontres…?), menant une enquête à la manière d’un journaliste ou de ce que fera Zola pour préparer ses oeuvres naturalistes (cf. cahiers préparatoire, Germinal par exemple).
Il serait aisé de montrer qu’un criminel coupable n’aurait pas mieux, pour l’époque, défendu sa cause dans le but de casser sa condamnation. Plutôt que de contester une justice fière et méprisante pour les criminels, plutôt que d’essayer par tous les moyens d’expliquer son crime, de se justifier, de se dédouaner, le condamné raconte juste, avec la voix raffinée d’une personne bien éduquée et la simplicité d’un innocent, l’horreur de ses moments d’attente cruelle, de ce cheminement absurde (il y a quelque chose du Procès de Kafka), de cette justice qui en punissant se plaît à faire mal (un sadisme qu’Albert Londres explique dans son livre-reportage Au bagne comme proportionnel au besoin non-dit de la société de s’acheter une innocence). Récit littéraire ne cachant pas vraiment sa cause, Le Dernier Jour d’un condamné a cependant des chances de convaincre, parce qu’il ne s’oppose pas, de front, aux préconceptions du lecteur, mais le met à sa place discrètement, progressivement, dans ses conditions de déshumanisation, en lui démontrant, la preuve par le style, appartenir à la même communauté de langage, d’éducation, de conceptions et de valeurs, de sensibilité… d’humanité que n’importe quel condamné. L’indéfinition du personnage permet l’universalité de ses sentiments.
Passages retenus
Préface de 1832, p. 29
Il y a deux manières de se rendre compte de l’existence de ce livre. Ou il y a eu, en effet, une liasse de papiers jaunes et inégaux sur lesquels on a trouvé, enregistrées une à une, les dernières pensées d’un misérable ; ou il s’est rencontré un homme, un rêveur occupé à observer la nature au profit de l’art, un philosophe, un poète, que sais-je ? dont cette idée a été la fantaisie, qui l’a prise, ou plutôt s’est laissé prendre par elle, et n’a pu s’en débarrasser qu’en la jetant dans un livre.
De ces deux explications, le lecteur choisira celle qu’il voudra.
Une comédie à propos d’une tragédie, p. 60
LE GROS MONSIEUR : On a pas le droit de faire éprouver à son lecteur des souffrances physiques. Quand je vois des tragédies, on se tue, eh bien ! cela ne me fait rien. Mais ce roman, il vous fait dresser les cheveux sur la tête, il vous fait venir la chair de poule, il vous donne de mauvais rêves. J’ai été deux jours au lit pour l’avoir lu.
[… p. 65]
LE MONSIEUR MAIGRE (Le juge) : Maintenant on veut abolir la peine de mort, et pour cela on fait des romans cruels, immoraux et de mauvais goût, Le Dernier Jour d’un condamné, que sais-je ?
p. 93
J’étais là, ma tête pesante et embrasée dans mes deux mains, qui en avaient plus qu’elles n’en pouvaient porter, mes coudes sur mes genoux, les pieds sur les barreaux de ma chaise ; car l’abattement fait que je me courbe et me replie sur moi-même comme si je n’avais plus ni os dans les membres ni muscles dans la chair.
p. 100
Un moyen de fuir, mon Dieu ! un moyen quelconque ! Il faut que je m’évade ! il le faut ! sur-le-champ ! par les portes, par les fenêtres, par la charpente du toit ! quand même je devrais laisser de ma chair après les poutres !
Ô rage ! démons ! malédiction ! Il faudrait des mois pour percer ce mur avec de bons outils, et je n’ai ni un clou, ni une heure !
p. 106
Tant que j’ai marché dans les galeries publiques du Palais de justice, je me suis senti presque libre et à l’aise ; mais toute ma résolution m’a abandonné quand on a ouvert devant moi des portes basses, des escaliers secrets, des couloirs intérieurs, de longs corridors étouffés et sourds, où il n’entre que ceux qui condamnent ou ceux qui sont condamnés.
p. 113
Oh ! est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour ? Est-il bien vrai que c’est moi ? Ce bruit sourd de cris que j’entends au-dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s’apprêtent dans leurs casernes, ce prêtre en robe noire, cet autre homme aux mains rouges, c’est pour moi ! c’est moi qui vais mourir ! moi, le même qui est ici, qui vit, qui se meurt, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table, et pourrait bien être ailleurs ; moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens, et dont le vêtement fait les plis que voilà !
p. 117
C’est mon souffle de condamné qui gâte et flétrit tout.
p. 122
J’avais le paradis dans le cœur.
p. 125
Il est une heure et quart.
Voici ce que j’éprouve maintenant :
Une violente douleur de tête, les reins froids, le front brûlant. Chaque fois que je me lève ou que je me penche, il me semble qu’il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau, et qui fait battre ma cervelle contre les parois du crâne.
J’ai des tressaillements convulsifs, et de temps en temps la plume tombe de mes mains comme par une secousse galvanique.
Les yeux me cuisent comme si j’étais dans la fumée.
J’ai mal dans les coudes.
Encore deux heures et quarante-cinq minutes, et je serai guéri.
p. 137 : Ils mettent de l’humanité là-dedans.
2 commentaires sur « Ramasse tes lettres : Le Dernier Jour d’un condamné, Victor Hugo »