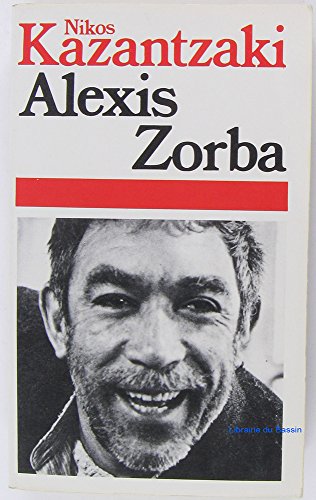
Un homme de passage
Kazantzakis (Nikos) 1946, Alexis Zorba, Plon, coll. Pocket, 1977
Traduit du grec par Yvonne Gauthier (Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά = « Vie et moeurs d’Alexè Zorba »).
Résumé
Sur le point de s’embarquer pour la Crête avec l’idée d’investir dans une mine de Lignite, celui qui sera « le patron », un jeune intellectuel, rencontre Alexis Zorba, un homme d’âge mûr qui le surprend par sa singularité, son franc-parler. Il sera son bras.
Sur l’île, ils embauchent quelques locaux, et les deux hommes se consacrent chacun à son ouvrage : la pioche pour l’un, la lecture-méditation pour l’autre. Le soir, ils se retrouvent, partagent le repas, bavardent. Zorba joue du santouri et danse. Au village, une vieille coquette est séduite par le bonhomme. Zorba répond à son amour et la surnomme affectueusement « ma Bouboulina ». Une jeune veuve farouche, désirée de tous les hommes du village, passe le long du café…
L’auteur : Nikos Kazantzakis (1883-1957)
Né à Héraklion en Crète (sous domination Ottomane). Il étudie le français et l’italien à l’École commerciale française de l’île de Naxos, puis le droit à l’université d’Athènes. Docteur en droit en 1906, il publie son premier roman, sous forme d’un journal, Le Lys et le Serpent. Il se rend à Paris pour suivre des études de philosophie, suivant les cours de Bergson et consacre sa thèse à « Nietzsche dans la philosophie du droit et de la cité ».
Il écrit pour divers journaux, traduit des œuvres philosophiques, contracte un premier mariage… En 1912, il s’engage dans les guerres balkaniques. Il fait deux années de pèlerinage au Mont Athos avec le poète Angelos Sikelianos, puis rencontre Georgos Zorbas avec lequel il va exploiter une mine de lignite au sud du Péloponnèse, expérience qui inspirera son célèbre roman.
Missionné par le ministère grec puis correspondant pour différents journaux, Kazantzakis voyage dans toute l’Europe, en U.R.S.S., en Palestine, en Égypte, au Soudan, en Chine et au Japon… Il écrit des scénarios de film et des récits de voyage, publie son Odyssée, grande œuvre poétique. Pendant la Seconde Guerre, il se consacre à l’écriture d’Alexis Zorba qui obtient un immense succès en 1946. Il crée le parti d’Union socialiste ouvrière.
Commentaires
Caractère solaire. Un Jésus ou un Socrate à l’état brut, sans décorum exégétique, sans abstraction ni idéologie, sans texte, sans ambition de meneur. Un prophète de la vie, de l’action libérée de la raison, du rire et du bien-être. Un corps dansant, chantant, mangeant, buvant, fumant, caressant. Un corps travaillant dur, éprouvant plaisir à sa fatigue. Une parole rustre, sans procédés de style ni précautions oratoires, droit au but mais surtout incarnée de tête en pied dans l’action (d’une efficacité comparable à celle décrite par Labov dans son Parler ordinaire dans les ghettos). Elle traverse les tortillages socials, résonne de coeur à coeur comme la pioche dans la pierre, au risque d’un coup de grisou… À vie physique, danger physique.
Le narrateur, jeune homme cultivé cherchant le sens du monde dans les livres de philosophie et de religion, est au contraire pur esprit. Qui n’a d’ailleurs pas de nom. Illustration du retrait du monde de Bouddha (thème de ses lectures), il n’agit pas. Il y a ainsi complémentarité autant que complicité entre les deux personnages, corps et esprit, comme si ils étaient les deux faces d’une humanité divisée cherchant à se réconcilier (à l’image du mythe de l’amour d’Aristophane dans Le Banquet de Platon : ces anciens êtres qui avaient quatre bras, deux têtes et qui ont été scindés et cherchent au monde à se rejoindre). Les deux âmes s’accordent et se superposent quasiment, ou semblent danser l’une près de l’autre, s’admirer et se repousser une seconde, se rire l’une de l’autre. Cependant, l’esprit est malade. Reniant son corps, le patron est non impliqué dans le monde à part par son estomac et par une parole réservée, peu accessible. Tandis que Zorba, corps assumé, accepte l’amour et peut donc le rendre et le propager, le patron renie et snobe l’amour – sachant par avance que le désir ne peut pas être pur esprit, sera donc dénué de la splendeur des hauteurs spirituelles de ses recherches. Ainsi il rejette l’autre, lui refuse sa protection, le bien qu’il peut apporter au monde. Qui donc est le sage ?
Sagesse du vieillard-enfant. Celui qui découvre un monde neuf à chaque réveil, ne le parasite pas de sa pensée d’analyse qui découpe, de son intelligence qui recouvre de liens, de sa raison qui désenchante, mais au contraire chante et sourit avec lui. Zorba incarne la vraie sagesse de Jésus. Celui-ci répondait à ses disciples à propos des conditions d’accès au paradis : devenir un nouveau-né (Évangile de Matthieu, 18, Évangile de Thomas, logia 22-37). Il ne s’agit pas de se tenir sage pour une récompense, ni d’agir sans réfléchir. Mais de travailler sur soi, son être au monde, être humble, retrouver un œil pur de tout préjugés, un coeur dépourvu de toute dualité (action, parole, pensée, unies), agir suivant les valeurs du bien que l’on s’est constituées… Autrement l’exprime Nietsche : « La maturité de l’homme, c’est d’avoir retrouvé le sérieux qu’on avait au jeu quand on était enfant. » (Maxime n°94, Par delà bien et mal).
Zorba est comme le Socrate vieux moche dans l’agora en face de beaux et jeunes éphèbes qui parlent politique avec de grands mots. Inculte culturellement, il a lui aussi la modestie d’un « je sais que je ne sais rien », mais c’est par une attention passionnée pour le monde et la vie qu’il révèle d’un trait les supercheries de l’esprit qui bavarde au monde, agit peu ou en contradiction avec ce qu’il prêche… Il s’exprime avec quelque bon mot déconcertant, un proverbe ramassé qu’il a su remâché avec sa vieille dent. Il est l’incarnation de la sagesse populaire. Un Sancho Pança parvenu à la maîtrise de son art. Zorba agit au monde avec un coeur qui sait combien accomplir son oeuvre avec le coeur pleinement engagé permet justement d’avoir le coeur en paix, l’âme délivrée des obsessions du corps. Son amitié est amour. Zorba a pris dans le monde la place de l’employé mais c’est lui qui enseigne à son « patron » la folie de l’amour de la vie.
Passages retenus
Géographie, allégorie du style et de Zorba, p. 41
Ce paysage crétois ressemblait, me parut-il, à la bonne prose : bien travaillé, sobre, exempt de richesses superflues, puissant et retenu. Il exprimait l’essentiel avec les plus simples moyens. Il ne badinait pas, refusait d’utiliser le moindre artifice. Il disait ce qu’il avait à dire avec une virile austérité. Mais entre les lignes sévères on distinguait une sensibilité et une tendresse imprévues ; dans les creux abrités, les citronniers et les orangers embaumaient, et plus loin, de la mer infinie, émanait une inépuisable poésie.
– La Crète, murmurais-je, la Crète… et mon cœur battait.
Genèse par la puissance du fantasme, p. 114
Tous les regards suivirent le sien. À cet instant précis, sa jupe noire retroussée jusqu’aux genoux, les cheveux répandus sur les épaules, une femme passait en courant. Bien en chair, onduleuse, ses vêtements lui collaient à la peau révélant un corps provocant et ferme.
Je sursautai. Quelle bête fauve est-ce là ? Pensais-je. Elle me parut souple, dangereuse, une dévoreuse d’hommes.
La femme tourna un instant la tête et jeta un regard étincelant et furtif dans le café.
– Sainte Vierge ! Murmura un tendron avec un duvet de barbe, assis près de la vitre.
– Maudite sois-tu, allumeuse ! Rugit Manolakas, le garde champêtre. Le feu que tu allumes, tu ne l’éteins pas.
Le jeune homme qui était près de la vitre se mit à chantonner, doucement d’abord, hésitant ; peu à peu sa voix se fit rauque :
L’oreiller de la veuve a une odeur de coings.
Moi aussi je l’ai sentie et ne peux plus dormir.
– La ferme ! cria Mavrandoni brandissant le tuyau de son narguilé.
Le jeune homme se tint coi. Un vieillard se pencha sur Manolakas, le garde champêtre.
– Voilà ton oncle qui se fâche, dit-il à voix basse. S’il pouvait, il la couperait en petits morceaux, la malheureuse ! Dieu la protège !
– Eh ! Père Androuli, fit Manolakas, à ce que je crois, tu es aussi accroché au jupon de la veuve. Tu n’as pas honte, toi, le bedeau.
– Eh non ! Je te le répète : Dieu la protège ! Tu n’as peut-être pas vu les enfants qui naissent dans notre village depuis quelques temps ? Ils sont beaux comme des anges. Tu peux me dire pourquoi ? Eh bien, c’est grâce à la veuve ! Elle est comme qui dirait la maîtresse de tout le village : tu éteins la lumière et tu te figures que ce n’est pas ta femme que tu tiens dans tes bras, mais la veuve. Et c’est pour ça, tu vois, que notre village met bas de si beaux enfants.
Le père Androuli se tut un moment, puis :
– Heureuses les cuisses qui la serrent ! murmura-t-il. Ah ! mon vieux, si j’avais vingt ans comme le fils à Mavrandoni !
Le coeur source pour les morts-aimés, p. 139
Les jours passaient. Je crânais, je faisais le brave, mais dans les replis de mon coeur je me sentais triste. Toute cette semaine de fêtes, les souvenirs étaient montés, emplissaient ma poitrine de musique lointaine et d’êtres aimés. Une fois de plus, m’apparaissait la justesse de l’antique légende : le coeur de l’homme est une fosse remplie de sang ; sur les bords de cette fosse les morts bien-aimés se jettent à plat ventre pour boire le sang et se ranimer ; et plus ils vous sont chers, plus ils vous boivent de sang.
Les cathédrales des coquillages, p. 232
Le jour se levait. On entendait la simandre. Je me penchai à la petite fenêtre. Aux premières lueurs de l’aube, je vis un moine maigre, un long voile noir sur la tête, faire lentement le tour de la cour en frappant avec un petit marteau une longue planche de bois merveilleusement mélodieuse. Pleine de douceur, d’harmonie et d’appel, la voix de la simandre se répandit dans l’air matinal. Le rossignol s’était tu et, dans les arbres, les premiers oiseaux commençaient à pépier.
J’écoutais, charmé, la douce et suggestive mélodie de la simandre. Comme, même dans sa déchéance, pensai-je, un rythme de vie élevé peut conserver toute sa forme extérieure, imposante et pleine de noblesse ! L’âme s’enfuit, mais elle laisse intacte sa demeure que, depuis tant de siècles, pareille au coquillage, elle façonnait, vaste, compliquée, pour s’y loger à son aise.
Ce sont de telles coquilles vides, pensai-je, les merveilleuses cathédrales que l’on rencontre dans les grandes villes bruyantes et athées. Des monstres préhistoriques dont il ne reste que le squelette, rongé par les pluies et le soleil.
p. 241
Il fumait lentement et soufflait la fumée par les narines en regardant la mer.
– Demain on aura du sirocco, dit-il. Le temps a tourné. Les arbres vont se gonfler, les seins des jeunes filles aussi, ils ne tiendront plus dans leurs corsages. Coquin de printemps, va, invention du diable !
Il se tut. Puis, au bout d’un moment :
– Tout ce qu’il y a de bon dans ce monde est une invention du diable : les jolies femmes, le printemps, le cochon rôti, le vin, tout ça, c’est le diable qui l’a fait. Et le bon Dieu, lui, a fait les moines, les jeûnes, l’infusion de camomille et les femmes laides, pouah !
Un avis sur « Ramasse tes lettres : Alexis Zorba, de Nikos Kazantzakis »