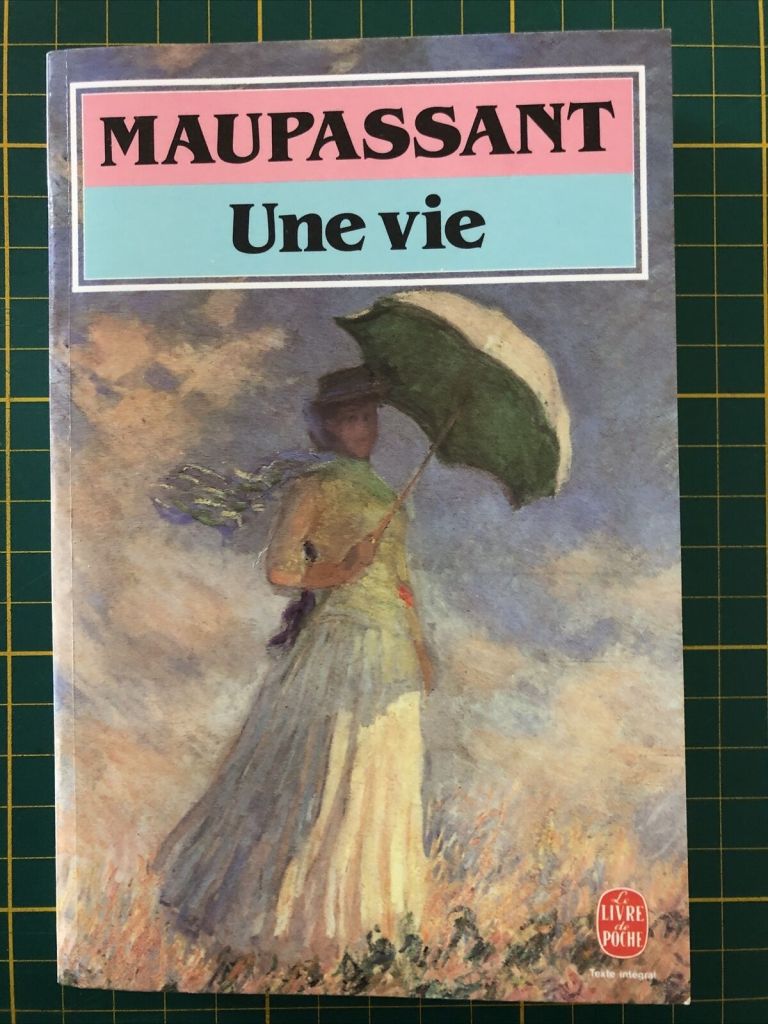
Conte cauchemardesque par la main de l’homme.
Maupassant (Guy de) 1883, Une vie, Albin Michel, coll. « Le Livre de Poche », 1983
Résumé
Jeanne est retirée du couvent dans lequel ses parents lui avaient fait donner une éducation convenable. Elle habite maintenant une grande propriété familiale près de Rouen, et élabore de grands rêves de voyages ensoleillés sous les longues journées froides et pluvieuses de Normandie. Julien Delamarre, beau jeune homme, invité de la famille, finit par l’attirer sous un arbre pendant une promenade. Il la demande en mariage puis l’emmène en Corse.
Mais le bon parti cède bientôt sa place à un mari autoritaire, brutal, économe jusqu’à l’avarice, infidèle. Jeanne attend désormais tout de son enfant.
Commentaires
Clairement inspiré du modèle Flaubertien (le maître et ami, mort trois ans plus tôt, en a très certainement supervisé les premières ébauches), ce roman est à rapprocher autant de Madame Bovary et d’Un cœur simple (quant à la méticuleuse analyse de la vie d’une femme prisonnière de sa condition), que de L’Éducation sentimentale (roman d’apprentissage déceptif). Il décrit le vide et la vie ratée d’une femme, en développant un thème cher à Maupassant (qu’il a notamment observé chez Sade) : l’effet dévastateur de l’éducation stricte, de la préservation de l’innocence (ou plutôt de la naïveté qui fera de l’enfant garçon ou fille une proie facile pour les autres mais aussi pour lui-même, sacrifiant son bonheur pour respecter sa morale). Plus les illusions sur la vie étaient grandes plus le sera la déception (en cela, Jeanne est une sœur de l’héroïne de La Joie de vivre, publié l’année suivante par Zola). Il y a quelque chose du renversement du conte pour jeunes filles, qui annonce bonheur à terme en échange de docilité, docilité qui ici mène à l’accumulation d’échecs…
La noirceur et le pathétique parviennent vite à leur comble et paraîtraient presque comme un acharnement du narrateur contre son personnage féminin (qui fera d’autant plus contraste avec la réussite effrontée du Bel-Ami). On sent la forte influence de Sade et de Schopenhauer dans ce regard surplombant, impitoyable jusqu’à la perversion, jusqu’à la dérision, cachant pudiquement un profond élan de pitié, de révolte, d’impuissance jusqu’à la larme, devant la condition faite à la Femme. Les autres figures de femme, comme la vieille tante, tendent à montrer que cette vie spécifique, pleine d’accidents malencontreux, n’est en fait pas très loin d’une vie prototypique de femme, quand bien même d’une élite sociale, baladée de droite à gauche, de son enfance à l’âge adulte, de ses parents à son mari, dominée même par son fils… une vie qui ne peut échapper au malheur, destiné depuis le berceau par le conte cauchemardesque que lui ont écrit les hommes (qui, pas forcément si négatifs d’abord le deviennent par le fait même de l’emprise qu’ils ont sur la femme…).
La lente maturation du sujet par l’écriture quotidienne de contes et d’articles a permis à Maupassant de trouver ce style concis et incisif qui le caractérise. Les images sont vives, fortes. Un peu à la manière des biographies de personnages imaginées par Zola dans ses Carnets, non repris dans le roman final, mais qui enrichissent et épaississent les personnages d’une existence hors-texte, derrière nombreux éléments de l’intrigue, descriptions ou scènes, on peut reconnaître des morceaux d’un ancien conte qui préparaient plus amplement la matière. En revanche, la focalisation reste ambigüe (ici proche de celle de Zola), le narrateur décrit tous les détails sans les faire passer par le filtre émotif d’un personnage ni laisser vraiment de place à l’implicite qui aura une plus grande importance dans Bel-Ami et dans la suite de son œuvre.
Passages retenus
Malheur silencieux d’une vieille femme, p. 59 :
Et ils continuèrent à rêver, à marcher lentement, à s’aimer.
Mais la rosée couvrait l’herbe, ils eurent un petit frisson de fraîcheur.
— Rentrons maintenant, dit-elle.
Et ils revinrent.
Lorsqu’ils pénétrèrent dans le salon, tante Lison s’était remise à tricoter ; elle avait le front penché sur son travail ; et ses doigts maigres tremblaient un peu, comme s’ils eussent été très fatigués.
Jeanne s’approcha :
— Tante, on va dormir, à présent.
La vieille fille tourna les yeux ; ils étaient rouges comme si elle eût pleuré. Les amoureux n’y prirent point garde ; mais le jeune homme aperçut soudain les fins souliers de la jeune fille tout couverts d’eau. Il fut saisi d’inquiétude et demanda tendrement : « N’avez-vous point froid à vos chers petits pieds ? »
Et tout à coup les doigts de la tante furent secoués d’un tremblement si fort que son ouvrage s’en échappa ; la pelote de laine roula au loin sur le parquet ; et, cachant brusquement sa figure dans ses mains, elle se mit à pleurer par grands sanglots convulsifs.
Les deux fiancés la regardaient stupéfaits, immobiles. Jeanne brusquement se mit à ses genoux, écarta ses bras, bouleversée, répétant :
— Mais qu’as-tu, mais qu’as-tu, tante Lison ?
Alors la pauvre femme, balbutiant, avec la voix toute mouillée de larmes, et le corps crispé de chagrin, répondit :
— C’est quand il t’a demandé… N’avez-vous pas froid à… à… à vos chers petits pieds ?… on ne m’a jamais dit de ces choses-là… à moi… jamais… jamais…
Jeanne, surprise, apitoyée, eut cependant envie de rire à la pensée d’un amoureux débitant des tendresses à Lison ; et le vicomte s’était retourné pour cacher sa gaieté.
Mais la tante se leva soudain, laissa sa laine à terre et son tricot sur le fauteuil, et elle se sauva sans lumière dans l’escalier sombre, cherchant sa chambre à tâtons.
Restés seuls, les deux jeunes gens se regardèrent, égayés et attendris. Jeanne murmura : « Cette pauvre tante !… » Julien reprit : « Elle doit être un peu folle, ce soir. »
Ils se tenaient les mains sans se décider à se séparer, et doucement, tout doucement, ils échangèrent leur premier baiser devant le siège vide que venait de quitter tante Lison.
Ils ne pensaient plus guère, le lendemain, aux larmes de la vieille fille.
L’Éducation contre-nature, p. 214 :
Ils arrivaient alors auprès du groupe des enfants ; et le curé s’approcha pour voir ce qui les intéressait ainsi. C’était la chienne qui mettait bas. Devant sa niche cinq petits grouillaient déjà autour de la mère qui les léchait avec tendresse, étendue sur le flanc, tout endolorie. Au moment où le prêtre se penchait, la bête crispée s’allongea et un sixième petit toutou parut. Tous les galopins alors, saisis de joie, se mirent à crier en battant des mains : « En v’là encore un, en v’là encore un ! » C’était un jeu pour eux, un jeu naturel où rien d’impur n’entrait. Ils contemplaient cette naissance comme ils auraient regardé tomber des pommes.
L’abbé Tolbiac demeura d’abord stupéfait, puis, saisi d’une fureur irrésistible, il leva son grand parapluie et se mit à frapper dans le tas des enfants sur les têtes, de toute sa force. Les galopins effarés s’enfuirent à toutes jambes ; et il se trouva subitement en face de la chienne en gésine qui s’efforçait de se lever. Mais il ne la laissa pas même se dresser sur ses pattes, et, la tête perdue, il commença à l’assommer à tour de bras. Enchaînée, elle ne pouvait s’enfuir, et gémissait affreusement en se débattant sous les coups. Il cassa son parapluie. Alors, les mains vides, il monta dessus, la piétinant avec frénésie, la pilant, l’écrasant. Il lui fit mettre au monde un dernier petit qui jaillit sous la pression ; et il acheva, d’un talon forcené, le corps saignant qui remuait encore au milieu des nouveau-nés piaulants, aveugles et lourds, cherchant déjà les mamelles.
7 commentaires sur « Ramasse tes lettres : Une vie, de Maupassant »