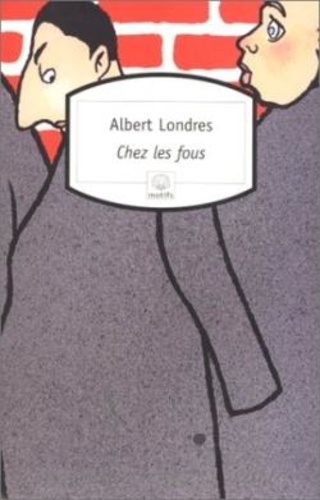
Du droit d’être librement fou.
Londres (Albert) 1925, Chez les fous, Le Serpent à plumes, coll. Motifs, 2006
Résumé
Usant de diplomatie ou de ruse, Albert Londres s’introduit dans quelques asiles français, parfois se faisant passer pour infirmier, patient… Il visite, discute avec les directeurs, les employés et bien-sûr les patients. Rapporte ce qu’il voit, ce qu’on lui dit. Les mauvais traitements infligés par manque de moyens, la non-personnalisation des traitements selon le type de folie et son stade, la toute puissance du docteur-psychiatre, les objets-encombrants pour jeunes filles et vieux indésirables, la dialectique kafkaïenne des lois pour traiter de la criminalité des fous, de la proximité entre addiction et folie, l’impossible sortie et réintégration sociale… Rares sont les exceptions où le fou est traité en humain comme chez le docteur Dide qui leur confie des responsabilités (précurseur en quelque sorte de la psychothérapie institutionnelle…).
Commentaires
Fouille-merde reconnu, spécialiste des lieux de privation de liberté, par ses reportages en Guyane (Au bagne, 1923) et dans les colonies d’Afrique du Nord (Dante n’avait rien vu, 1924), Albert Londres ouvre ce reportage en rapportant les ruses qu’il a dû employer pour s’introduire dans les asiles de France, soufflant qu’il y a déjà quelque chose de louche qu’on préfère cacher au grand public (pas juste un isolement de sécurité), que ce sont comme les bagnes des zones de non respect du droit… En paraphrasant Diderot dans son pamphlet contre les couvents (dans La Religieuse), nous pourrions dire que l’asile « en est une [de prison] mille fois plus affreuse » car il n’y a pas l’excuse de la punition pour justifier des traitements infligés… La maltraitance est essentiellement causée par le manque de moyens humains et matériels, et par le manque de formation (comme aujourd’hui dans les EHPAD). Mais comme dans les couvents, elle est justifiée rétrospectivement par une justice divine infernale : si Dieu t’a frappé de déraison, c’est que tu l’as mérité, donc tu mérites encore un coup… ; et, comme pour les bagnes, cette dégradation morale se double d’une transfiguration du malade en bouc émissaire : en le voyant souffrir, on frappe par procuration la folie qui nous menace et notre propre peur… pour également marquer une frontière nette entre la folie et nous (constat bien proche de celui que fera Michel Foucaut dans son Histoire de la folie en 1961). Or, les limites entre folie et raison sont dans les faits bien plus floues, la raison perméable à la déraison : il y a continuum, le fou n’est pas fou en continu, il n’y a pas de repères satisfaisants pour distinguer entrée dans la folie et guérison, nombreux sont les symptômes de folie qui se retrouvent dans des circonstances de la vie ordinaire : dépression, obsessions, traumatisme, addiction… La limite est dès lors arbitraire et décrétée par l’expertise-jugement d’un directeur/docteur/psychiatre/patron de l’asile. Et les questions de symptômes et d’enfermement dominent celles du traitement ou celle de la vie humaine à rendre possible pour un « fou »…
Albert Londres mêle ainsi restitution d’éléments descriptifs, conversations et insertions subjectives, commentaires littéraires à portée évaluative. D’une manière similaire à Au Bagne, sa présence se renforce à mesure de l’avancée du reportage, d’abord par de petites touches caustiques provoquant un comique de répétition (mettant en évidence des récurrences, une convergence d’indices), puis comme l’évidence du jugement critique qui s’affirme face à l’évidence des faits observés. D’abord dans une simple attitude observante, on le voit s’impliquer de plus en plus et prendre des risques, s’engager, dans son enquête, comme dans le compte-rendu de celle-ci. De la surprise amusée de la première rencontre, du silence devant la complexité, de la perplexité face aux contradictions, du choc devant l’absurde, de la révolte face à l’injustice, de l’admiration devant l’humain et ses résistances… Le littéraire surgit comme expression de l’humanité révoltée. S’exprime parce que l’observation neutre n’est plus possible… la langue se poétise car ne trouve plus d’expression régulière convenable pour exprimer le choc.
Qu’est-ce qu’un reportage ? Se rendre sur un terrain, interroger et noter ses observations ressemble au travail de l’enquêteur sociologique ou anthropologique. Restituer la parole, décrire les visages, les lieux, c’est donner matière, objet pouvant être manipulé et non plus un concept éternellement manipulé par les aprioris. Mais l’impératif du métier de journaliste/reporteur n’est-il pas d’outrepasser la transparence de la démarche, de recourir à des moyens détournés – c’est le côté sale des tabloids, qui ne peut devenir propre qu’à condition de se faire pour une cause supérieure, le bien commun, et non pour la sensation… – afin de pénétrer les secrets et tabous, car il y a urgence ? Le journaliste piège, comme l’inspecteur Maigret de Simenon, par des questions anodines ; il ruse comme le renard pour faire tomber les camemberts… Les faits rapportés seront de toute façon contestés, la valeur du reportage ne peut se fonder que sur la confiance du lecteur, donc sur la réputation d’intégrité du reporteur et du journal. De plus, les révélations « volées » – contraires à l’éthique de l’enquête judiciaire, de l’enquête sociologique et contraires à la loi – n’ont pas pour but de faire scandale en soi, mais de forcer les autorités à des enquêtes approfondies, de déclencher procès et révisions des lois… Le vrai journalisme aurait ainsi quelque chose de la désobéissance civile…
Passages retenus
Individualisme et folie, p. 27
Le fou est individualiste. Chacun agit à sa guise. Il ne s’occupe pas de son voisin. Il fait son geste, il pousse son cri en toute indépendance. Quand plusieurs vous parlent à la fois, l’homme sain est seul à s’apercevoir que tous beuglent en même temps. Eux ne se rendent pas compte.
L’un se suiciderait lentement au milieu de cette cour qu’aucun ne songerait à intervenir.
Ils sont des rois solitaires.
Le corps que nous leur voyons n’est qu’une doublure cachant une seconde personnalité invisible aux profanes que nous sommes, mais qui habite en eux. Quand le malade vous semble un être ordinaire, c’est que sa seconde personnalité est sortie faire un tour. Elle reviendra au logis. Ils l’attendent.
Si leur conversation paraît incohérente, ce n’est que pour nous ; eux se comprennent. La rapidité de leur pensée est telle qu’elle dépasse les capacités de traduction de la langue.
Ils laissent des mots en route, comme on saute deux marches de l’escalier à la fois quand on est jeune et que l’on a du souffle. Les poètes, partis dans le cercle lumineux de leur inspiration, inventent des termes, les fous forgent leur vocabulaire. Les conventions séculaires, qui font qu’un même peuple s’entend parce que les individus de ce peuple accordent aux mots une signification définie, ne jouent pas pour eux. Les fous parlent en dehors des règles établies. Il n’y a pas un peuple de fous : chaque fou forme à lui-seul un propre peuple.
Tableau de torture, p. 40
Au fond est la Salle de Pitié. C’était inattendu et incompréhensible. Juchées sur une estrade, onze chaises étaient accrochées au mur. Onze femmes ficelées sur onze chaises. Pour quel entrepreneur d’épouvante étaient-elles « en montre » ? Cela pleurait ! Cela hurlait ! Leur buste se balançait de droite à gauche, et, métronome en mouvement, semblait battre une mesure funèbre. On aurait dit de ces poupées mécaniques que les ventriloques amènent sur la scène des music-halls. Les cheveux ne tenaient plus. Les nez coulaient… La bave huilait les mentons. Des « étangs » se formaient sous les sièges. Dans quel musée préhistorique et animé étais-je tombé ? L’odeur, la vue, les cris vous mettaient le fiel aux lèvres.
Ce sont les grandes gâteuses qui ne savent plus se conduire.
Qu’on les laisse au lit !
On les attache parce que les asiles manquent de personnel.
Tout de même !
Coincé entre criminalité et aliénation, p. 122
Eh bien ! à quoi peut aboutir, ad-mi-nis-tra-ti-ve-ment la grande misère des fous criminels ? A des vaudevilles.
Ces vaudevilles ont deux auteurs.
Ces auteurs n’ont pas la réputation qu’ils méritent.
Je réclame, pour ces éminents humoristes, deux fauteuils jumelés à l’Académie française, la cravate de la Légion d’honneur, puis, leur mort venue, une statue sur le toit du Palais-Royal.
L’un s’appelle : l’article 64 ; l’autre : la loi de 38.
Ils se valent. S’ils ne partagent pas équitablement les droits d’auteur, c’est que l’un vole l’autre.
L’article 64 fait bénéficier d’un non-lieu ou fait acquitter le personnage principal de la pièce, lequel porte toujours le nom d' »aliéné criminel ».
Aussitôt, la loi de 38 s’empare du monsieur. Elle le déshabille, elle le palpe, elle le retourne, puis, haussant les épaules, s’écrie : « Criminel si tu veux, mon vieux collaborateur, cela ne me regarde pas. Mais, aliéné ? Holà ! Ton homme, je le relâche. »
Le personnage retrouve sa liberté. Le rideau tombe. C’est l’entracte.
Le personnage profite de l’entracte, non pas, comme vous pourriez le supposer, pour acheter des oranges, pastilles à la menthe, bonbons acidulés, mais pour recommencer son petit métier, qui est de voler, de pirater, d’assassiner.
On tape les trois coups : second acte.
Le gendarme introduit une nouvelle fois le personnage au palais de justice.
– Quoi ? fait l’article 64, c’est toi ? La loi de 38 t’a mis à la porte ?
– La loi de 38 dit que je ne suis pas un aliéné.
– Elle dit cela ? Attend !
L’article 64 ouvre son tiroir et débouche le pot à colle. – Tourne-toi, dit-elle au personnage. Sur son dos, elle placarde une affiche où se lit : « Aliéné dit criminel » Signé : Article 64.
– Reconduisez cet homme à la loi de 38, dit l’article au gendarme.
Rideau. Entracte.