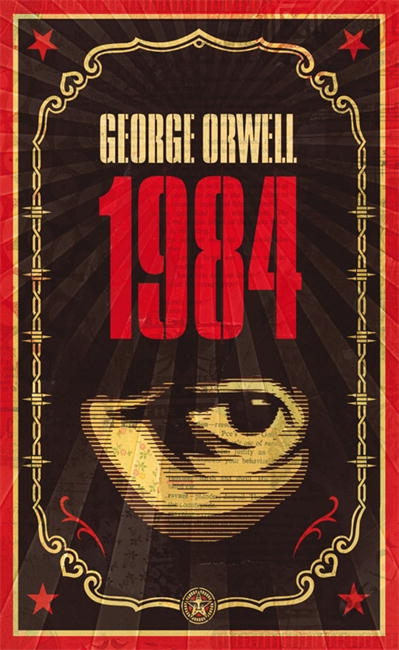
Ce fascisme qui vous veut du bien
Orwell (George) 1949, 1984, éd. Penguin Books, 2008
Résumé
Depuis quelques temps, Winston Smith commet un grave délit : il écrit dans un cahier, avec un stylo. Il y avoue clairement ce qui peut lui valoir la mort et qu’il a même encore du mal à oser formuler dans sa pensée : il déteste Big Brother. Tous les jours, il continue son travail de retouche du passé pour le Ministère de la Vérité, afin que les archives du passé soient toujours en accord avec les décisions actuelles du gouvernement. Il craint à tout moment que son visage ne trahisse sa pensée. Une jeune employée zélée le regarde d’ailleurs étrangement… Et voilà qu’un jour, elle lui glisse discrètement un petit mot dans la main…
WAR IS PEACE
Axiomes de Big Brother
FREEDOM IS SLAVERY
IGNORANCE IS STRENGTH
Commentaires
Après avoir illustré la dérive du communisme au fascisme stalinien par le décalage de la fable dans La Ferme des animaux en 1945, Orwell projette la mécanique fasciste dans le monde futuriste que permet la science-fiction. Les inventions imaginées par Orwell permettent une compréhension simple et ramassée des procédés de contrôle et de propagande ayant eu cours de manières variées dans les régimes nazi, mussolinien, stalinien… La machine à réécrire l’histoire modifiant d’un geste les sources accessibles « machinise » la propagande fasciste historique qui diffusait de nouveaux discours en rendant inaccessibles, censurés ou interdits d’anciennes publications… Le telescreen illustre bien le fameux « œil de Moscou », ce camarade sympathique qui s’introduit dans votre entourage et guette vos agissements depuis sa fenêtre pour le compte du pouvoir central… La science-fiction peut ainsi être considérée comme la conception mécanique d’une métaphore.
La date de 1984 est dépassée de près de quarante années et pourtant le slogan « Big Brother is watching you » n’a jamais été aussi pertinent pour caractériser le monde dit connecté dans lequel nous commençons seulement à vivre et que nous promettent de systématiser les prophètes de la Silicon Valley et du commerce numérique. À l’image du telescreen d’Orwell (télé connectée avant l’heure qu’on retrouve dans Fahrenheit 451 quatre ans plus tard), chaque innovation, tout en proposant une hausse de confort, de sécurité ou de divertissement, a permis un accroissement de la surveillance (données numériques, géo-localisation, réputation en ligne…), et en conséquence une réduction des libertés individuelles. Plus que de nous connecter au monde extérieur, les appareils connectés installés dans notre foyer et dans notre poche introduisent le regard du monde sur notre intimité… Cette technologie remplit ainsi bien les deux sens du verbe « to watch » et la double fonction du grand frère : prendre soin de nous et nous surveiller très étroitement…
La liberté fondamentale de l’homme, son libre-arbitre, c’est celle de ne pas faire ce qui semble nécessaire ou utile, c’est celle de la Cigale de La Fontaine de fainéanter, de chanter ; c’est donc la poésie, l’art, l’humour, la nostalgie et même l’amour… qui sont totalement bannis du monde de Big Brother (comme l’art pour l’art était proscrit en U.R.S.S. ; la reproduction eugénique mise en place dans les jeunesses hitlériennes), que Winston ne peut retrouver que dans l’illégalité. La liberté, c’est donc aussi par essence la possibilité de faire quelque chose de « mauvais » (non considéré comme bon par la société)… Contrairement à la vision réductrice du fascisme comme mal absolu (l’Empire du Mal), les régimes fascistes ont toujours comme but premier de replacer le bien au cœur de la société et de forcer tout le monde à le respecter rigoureusement (qu’on pense à l’idéal communiste ou au concept d’aryen – noble – chez les Nazis). Le fascisme germe ainsi merveilleusement dans une société où domine l’impression ou la crainte de décadence et de désordre. Le problème étant bien entendu de savoir qui va déterminer ce « bien »…
Grâce à la liberté d’écriture de la réalité que permet la science-fiction, Orwell pousse le fantasme fasciste de société sous contrôle, et tel le procédé de l’ironie socratique, l’étend jusqu’à ce qu’il révèle ses contradictions (comme les axiomes en lettres majuscules de Big Brother). La violence militaire a laissé place – en apparence – à un monde d’ordre, de stabilité, de respect (comme le super État communiste qui devait à terme disparaître)… Mais le résultat tient davantage de l’absurde du Procès de Kafka que de l’utopie : une chose décrétée interdite aussi anodine qu’écrire sur un carnet devient presque aussi grave qu’un meurtre, car toute infraction à une loi édictée par un pouvoir sectaire est une attaque contre son idéologie même, donc un crime de lèse-majesté. Et dans un régime de susceptibilité absolue, le soupçon a valeur de preuve. Chacun subissant la pression constante de la surveillance, afficher sa sévérité à l’égard de la moindre faute – ou suspicion de faute – c’est échapper un temps à cette pression en faisant preuve d’une exigence morale trop haute pour être suspecté… Le jugement populaire fonctionne ensuite à la manière d’une lapidation, la première pierre lancée inspire et légitime la seconde, dans une séance de défoulement collectif, aboutissant à l’indifférence devant la vie de l’individu ainsi sali (un accusé défiguré a une bonne tête de coupable), que le gouvernement peut ainsi faire disparaître sans procès ou dans un procès factice.
Winston Smith, individu lambda, vit en continu avec un fantôme, celui de Big Brother, personnification de la surveillance qui, comme son affiche donnant le malaise d’être toujours en train de fixer la personne qui le regarde, semble être partout, grâce aux technologies donc (ce que permet si bien le téléphone portable connecté aujourd’hui), mais aussi par le regard de chaque autre, passant, voisin, ami, famille… Le but est bien que chacun se transforme en Big Brother (comme chaque utilisateur d’une application 2.0 est aussi acteur et modérateur), que chacun ait à se méfier de chacun, jusqu’à sa femme et ses enfants (qu’on pense au héros stalinien Pavlik Morozov qui aurait dénoncé son propre père… invention de toute pièce de la propagande…). Le fantôme est omniprésent jusqu’à donner l’impression qu’il est même à l’intérieur de soi, à surveiller ses pensées comme le dieu des monothéismes… « doublethink », point culminant du contrôle fasciste : que chacun devienne son propre Big Brother, son auto-censeur, qu’il se punisse lui-même de ses pensées impures (à la manière d’un certain christianisme dépravé en masochisme…), qu’il se refuse le sens critique, qu’il s’auto-mutile de son humanité au nom d’une idéologie du bien sacrée placée au-dessus de toute autre considération annexe.
Le Newspeak d’Orwell s’inspire du fonctionnement des régimes fascistes qui emploient le langage d’une manière particulière : innovations identitaires marquées, glissement de sens, surcharge morale des enveloppes lexicales… Le langage est un terrain de lutte et si les mots qu’il est possible d’employer sont toujours chargés du sens imposé par l’adversaire, alors il devient impossible de s’exprimer hors du paradigme bien/mal ami/ennemi défini par celui-ci. Le newspeak tel qu’il est décrit est un mélange de politiquement correct sublimé et de dystopie linguistique scientifique. De tous temps, certains intellectuels ont nourri le fantasme d’un langage parfait et immobile, sans exceptions, dans lequel un mot ne représenterait qu’une réalité et une seule (à l’image du langage qu’ils utilisent pour le raisonnement logique ou pour la nomenclature), résolvant facilement l’ambiguïté du langage, le jeu entre les mots et les lignes, le double discours (autant d’enjeux littéraires qui apparaissent souvent comme des jeux à leurs yeux)… Cet idéal absurde est l’inverse d’une langue vivante car elle empêche toute appropriation, toute souplesse, toute charge affective du langage. Elle bloque des fonctions fondamentales du schéma de Jakobson. L’importance accordée aux abréviations et à un langage poli, neutre ou vide de sens, fait énormément penser au politiquement correct et au globish management rubbish language qui privilégient euphémismes, anglicismes et technicismes obscurs ou vides. Langage de carton recouvrant l’ordure. En limitant la possibilités du langage d’exprimer nuances et radicalités, on empêche la pensée de se préciser et le débat d’avoir libre cours… Le fascisme, c’est toujours cette tentation de contrôler ce que nous ne comprenons pas, ce qui nous échappe…
En cachant les armes, en maintenant l’illusion de liberté, cette société fasciste ultime ne prend-elle pas les allures d’une tendance évidente de nos systèmes supposés plus libéraux ? Le contrôle par la sévérité de l’opinion publique est-il si loin du système de notations dans les réseaux sociaux (comme dans l’épisode « Nosedive » de Black Mirror où les notes constituent un vrai système de punition des comportements déviants) ? Le fascisme serait ainsi présent dans les mentalités de tout un chacun, tentation d’imposer son bien à autrui, tentation au contraire de se laisser imposer et dicter son comportement, davantage que dans le spectre d’une dictature (tel que dans le Discours sur la servitude volontaire, c’est la société qui aspire à la dictature). Et c’est bien une véritable « matrice » capitaliste au sens de Jean Baudrillard qu’imagine Orwell en imaginant ce fascisme du futur : les ennemis, les contre-pouvoirs, deviennent des instruments pensés de raffermissement du pouvoir, jusqu’à être pensés et organisés par le pouvoir lui-même pour occuper, orienter, surveiller et canaliser le mécontentement. La révolution y est devenue un loisir très réaliste, comme le paintball…
Passages retenus
Gymnastique cynique avec la vérité, p. 37 :
If all others accepted the lie which the Party imposed –if all records told the same tale– then the lie passed into history and became truth. ‘Who controls the past’, ran the Party slogan, ‘controls the future: who controls the present controls the past.’ And yet the past, though of its nature alterable, never had been altered. Whatever was true now was true from everlasting to everlasting. It was quite simple. All that was needed was an unending series of victories over your own memory. ‘Reality control’, they called it: in Newspeak, ‘doublethink’.
[…]
His mind slid away into the labyrinthine world of doublethink. To know and not to know, to be conscious of complete truthfulness while telling carefully constructed lies, to hold simultaneously two opinions which cancelled out, knowing them to be contradictory and believing in both of them; to use logic against logic, to repudiate morality while laying claim to it, to believe that democracy was impossible and that the Pary was the guardian of democracy; to forget whatever it was necessary to forget, then to draw it back into memory again at the moment when it needed, and then promptly to forget it again: and above all, to apply the same process to the process itself. That was the ultimate subtlety: consciously to induce unconsciousness, and then, once again, to become uncounscious of the act of hypnosis you had just performed. Even to understand the word ‘doublethink’ involved the use of doublethink.
La crise existentielle est une révolte, p. 62 :
He meditated resentfully on the physical texture of life. Had it always been like this ? Had food always tasted like this ? He looked round the canteen. A low-ceilinged, crowded room, its walls grimy from the contact of innumerable bodies; battered metal tables and chairs, placed so close together that you sat with elbows touching; bent spoons, dented trays, coarse white mugs; all surface greasy, grime in every crack; and a sourish, composite smell of bad gin and bad coffee and metallic stew and dirty clothes. Always in your stomach and in your skin there was a sort of protest, a feeling that you had been cheated of something that you had a right to.
La nature animale contre la dénaturation par la raison, p. 132
‘Listen. The more men you’ve had, the more I love you. Do you understand that?’
‘Yes, perfectly.’
‘I hate purity, I hate goodness! I don’t want any virtue to exist anywhere. I want everyone to be corrupt to the bones.’
‘Well then, I ought to suit you, dear. I’m corrupt to the bones.’
‘You like doing this? I don’t mean simply me: I mean the thing in itself?’
‘I adore it.’
That was above all what he wanted to hear. Not merely the love of one person, but the animal instinct, the simple undifferentiated desire: that was the force that would tear the party to pieces.