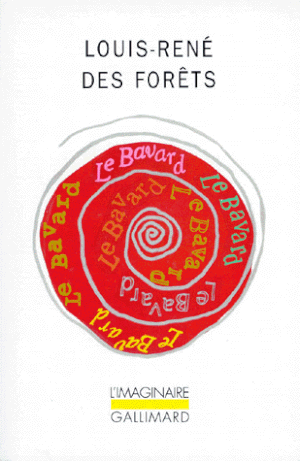
Autocritique du littérateur menteur
Des Forêts (René-Louis) 1946, Stratégie pour deux jambons, éd. Gallimard, coll. L’Imaginaire, 1978
Résumé
Le narrateur nous entretient sur ce qu’il considère comme son « mal ». Remontant aux origines de celui-ci, il se présente comme un homme réservé, qui lors d’un moment d’exaltation fut pris d’une crise d’envie de parler. Cette crise explose lors d’une soirée arrosée, lorsqu’il s’ouvre à une belle espagnole qu’il avait invitée à danser…
Commentaires
Le genre du récit monologué et l’anecdote comico-pitoyable, incomplète et peu fiable, rappellent inévitablement les Carnets du sous-sol de Dostoïevski, et caractérisent à merveille cet alter-égo de l’écrivain, le bavard. Du pathétique perdant magnifique au prophète de sa propre défaite existentielle, le bavard n’est-il pas un écrivain raté ? Ou tout simplement la caricature d’un écrivain : un fanfaron prêt à toutes les acrobaties de langage, tous les mensonges (l’un des sens étymologiques de « jongleur »), pour garder l’attention de son lecteur ? Le roman de des Forêts relèverait donc de l’autodérision, ou de la parodie du genre littéraire de l’autobiographie (ou l’autofiction). Le discours de confession ne semble plus être ici que comédie pathologique, se donnant comme séance de psychanalyse, dans laquelle l’égotisme est développé jusqu’à envahir la totalité de l’espace-temps. Et c’est le lecteur qui paie la séance de l’auteur… Dans Les Confessions, Rousseau racontait les hontes de sa vie ; dans Le Bavard, Des Forêts confesse, montre, sa honte d’écrivain : je raconte ma vie pour vendre. Dix ans plus tard, dans La Chute, Albert Camus poussera cette dérive du littéraire jusqu’à son comble autodestructeur : le cynisme.
Parole qui s’étend sans-cesse, s’auto-génère, se reprend, s’autocritique jusqu’à l’effet de remplissage, écriture du retour incessant sur soi, autoanalytique, défoulement offert par le spectacle de sa propre parole, dans laquelle l’on peut étaler sa mauvaise foi sans retenue, sans contradicteur. Jacqueline Authier-Revuz analyse en 1996 dans Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles réflexives et non-coïncidences du dire, une caractéristique stylistique spectaculaire de la littérature de la fin du XXe siècle qui correspond si bien à cette littérature de bavardage : la modalisation autonymique. Le discours se prend pour son propre objet de discours (ex : ou pour mieux dire, objet de discussion, sujet de conversation… le discours rectifie ce qu’il vient de dire, laisse apparaître son hésitation, son évolution de pensée plutôt que d’en donner le résultat sec et concis). Cette « boucle » du langage sur lui-même crée un enfermement verbal interminable et malsain qu’on trouve de manière symptomatique chez Céline : derrière la voix « à prendre ou à laisser » du pilier de comptoir se cache une haine pathologique, de soi, du langage direct… Le bavardage caractérise ainsi un certain style littéraire moderne, opposé du classicisme (clair et concis), une littérature post-décadente en mal d’objet, croyant avoir perdu son projet intellectuel, capturé par les sciences (Zola se voyait en sociologue dans son Roman expérimental). L’homme non-spécialiste est privé du droit de parler de tout sujet (Proust dans cette perspective serait le dernier, s’exprimant avec une précision phénoménologique et psychologique, sur l’analyse des mouvements du cerveau). Le littérateur se voit privé de son rôle social, blessé dans son égo de grand Homme. La littérature, son objet fictionnel et sa langue spécifique, sont soupçonnées de mythomanie. Un malaise qu’on trouve quelque peu décrit dans Les Fleurs de Tarbes de Jean Paulhan lequel parle volontiers de terreur dans les lettres, de misologie.
Passages retenus
Bien qu’il me paraît nécessaire pour entretenir l’état agréable où je me trouvais de conserver intacte toute ma lucidité, j’avais une connaissance assez éprouvée de ma faiblesse pour prévoir avec certitude qu’aucune considération de ce genre ne me retiendrait de céder à la tentation absurde et immédiate de vider ce verre qui brillait devant moi ; et je crois même que c’est la certitude d’une chute prochaine qui m’entraînait à en avancer l’échéance.
p. 28
Je bus quatre verres consécutifs, c’était bien agréable aussi. La meilleure justification à ma faiblesse me semblait résider dans le fait que ma sensibilité, au lieu de se brouiller, devenait à la fois plus nette et plus réceptive, et je me sentais plein de sympathie, une sympathie formidable, pour tous ces gens agités. Qu’ils avaient raison de rire, de danser, de boire, de se préparer par des mots et des gestes à faire l’amour ! Quel passe-temps utile ! Dans le spectacle de ces gens emplis d’espoir ou de désespoir qui s’aiment ou cherchent l’amour, dans ce bruit de rafale, dans cette odeur chaude et confinée, consiste tout le secret de la vie, me disais-je en soulevant mon verre. Vivre c’est sentir, donc boire, danser et rire c’est sentir, donc boire, danser et rire c’est cela vivre et sur ce plaisant syllogisme je vidais mon verre.
3 commentaires sur « Ramasse tes lettres : Le Bavard, de René-Louis des Forêts »